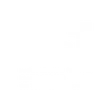Géopolitique climatique : le marqueur insulaire
14/06/2019

Par Timothée Ourbak, professeur à l’ILERI au sein du MPI Coopération internationale des outre-mer et environnement.
Les scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le GIEC, ont publié leur dernier rapport en octobre 2018 (IPCC, 2018). Ce rapport traite d’un monde qui connaîtrait un réchauffement climatique de + 1,5°C par rapport à l’ère pré industrielle. Le rapport dit que même si l’augmentation de la température moyenne du globe terrestre ne venait à augmenter « que » de + 1,5°C (le réchauffement climatique est déjà de + de 1°C; et, si les trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre actuelles ne sont pas infléchies, la terre devrait se réchauffer bien au-delà de ce seuil), les impacts seraient multiples pour toutes les régions du monde, certaines étant néanmoins plus vulnérables que d’autres.
Ce rapport dit aussi que, si rester sous la barre de +1,5°C d’augmentation des températures est toujours possible, la fenêtre d’opportunité se réduit et les transformations profondes qui s’imposent minimiser les impacts des changements climatiques doivent être prises rapidement.
Ce rapport a été demandé aux scientifiques du GIEC lors de la COP21, en 2015, et les Etats insulaires y ont été pour beaucoup.
En effet, pour les Etats insulaires, la lutte contre les changements climatiques, « la plus grande des menaces », touche en effet à leur existence même.
Intéressons-nous ainsi à ces territoires considérés comme « particulièrement vulnérables » (au sens de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la CCNUCC) aux aléas climatiques et à leurs impacts, à ce que le Guardian n’hésite plus à appeler une « crise climatique ». Les territoires insulaires, et donc les populations, économies et écosystèmes qui les composent, subissent les multiples conséquences des dérèglements climatiques : augmentation des températures (température de l’air comme température océanique – avec un impact parfois forts sur les écosystèmes marins côtiers qui composent la majorité des moyens de subsistance des populations, on pense aux îles tropicales et au blanchissement des coraux par exemple), augmentation du niveau de la mer, érosion des zones littorales et salinisation des nappes phréatiques induites, inondations, sécheresses, acidification des océans, cyclones et tempêtes, etc.
Au-delà des impacts sectoriels ; on pense au tourisme, à l’agriculture ou à la pêche, ce sont des économies entières qui sont menacées comme ce fut le cas avec l’ouragan Pam en 2015 à l’origine d’une perte de 64 % du PIB annuel du Vanuatu, dans le Pacifique ; ou de Maria en 2017 qui a causé des dégâts d’une valeur de 224 % du PIB de l’île de la Dominique, dans les Caraïbes (Sources : Banque asiatique de développement et Banque Mondiale).
Indirectement (la corrélation est loin d’être simple et les relations de causes à effet non linéaires), ces mutations profondes de l’environnement immédiat des insulaires peut être une des causes ou un facteur aggravant des situations entraînant des déplacements et des migrations liées. Devant l’ampleur des impacts, les populations et leurs décideurs politiques commencent à chercher où trouver asile. Citons l’exemple de l’île de Tuvalu ou de Napuka dans l’archipel des Tuamotu (Polynésie Française), dans le Pacifique. Le gouvernement néo-zélandais a ainsi récemment innové en étudiant la possibilité d’accueillir sous statut et visa spécial lié à la « migration climatique dans le Pacifique ».
Pourtant les Etats et territoires insulaires ne représentent que quelques dixièmes de pour cent des émissions de gaz à effet de serre, émissions qui sont la cause des dérèglements climatiques que les scientifiques du GIEC observent, et que la population ressent.
Néanmoins, les îles ont réussi, au regard de leur poids géopolitique, à occuper une place importante au sein de la diplomatie multilatérale onusienne. Prenons l’exemple de la préparation de la COP21, la 21 ème conférence des Partie membres de la « convention climat » précédemment citée. En 2014 et 2015, les Etats insulaires ont établi des positions de négociation commune et ont mis en place, grâce à des leaders charismatiques, une stratégie qui leur a permis de gagner en visibilité et force de pression en amont de la COP21. Au sein de l’Alliance des Petits Etats Insulaires en Développement, les leaders politiques représentants les insulaires ont donné une visibilité internationale importante à la situation de leurs territoires, et « d’exister dans le rapport de force des négociations ».
De nombreuses déclarations ont ainsi mis en avant de la vulnérabilité de ces territoires, et l’engagement des insulaires à prendre leur part dans les stratégies de réduction de gaz à effets de serre au niveau mondial, envoyant un fort signal politique et symbolique : si des petits Etats peuvent mettre en œuvre la transition énergétique, les grandes puissances responsables des émissions mondiales et ainsi du dérèglement à l’œuvre le peuvent aussi! Ce fut le cas pour tous les océans, et que ce soit dans les Caraïbes, l’Océanie ou l’Indien, la mobilisation fut forte.
Cette attitude positive n’est pas nouvelle, et les leaders comme la société civile insulaire a ainsi mis en avant la situation depuis longtemps, pour preuve la cérémonie d’un conseil des ministres des îles Maldives, qui s’est déroulée à près de 10 mètres de profondeur, afin d’alerter sur l’imminence et les conséquences de la montée des eaux. Ils ont d’ailleurs été parmi les plus actifs pour la création de la Convention climat, en 1992. Comparativement à leurs poids démographiques et économiques, les insulaires ont joué, jouent et continueront probablement de jouer un rôle majeur sur le plan de la diplomatie climatique. Symboliquement et comme territoires pilotes des enjeux de transition énergétique et écologique, démonstrateurs de ce que développement bas-carbone et résilient peut vouloir dire.
Les scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le GIEC, ont publié leur dernier rapport en octobre 2018 (IPCC, 2018). Ce rapport traite d’un monde qui connaîtrait un réchauffement climatique de + 1,5°C par rapport à l’ère pré industrielle. Le rapport dit que même si l’augmentation de la température moyenne du globe terrestre ne venait à augmenter « que » de + 1,5°C (le réchauffement climatique est déjà de + de 1°C; et, si les trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre actuelles ne sont pas infléchies, la terre devrait se réchauffer bien au-delà de ce seuil), les impacts seraient multiples pour toutes les régions du monde, certaines étant néanmoins plus vulnérables que d’autres.
Ce rapport dit aussi que, si rester sous la barre de +1,5°C d’augmentation des températures est toujours possible, la fenêtre d’opportunité se réduit et les transformations profondes qui s’imposent minimiser les impacts des changements climatiques doivent être prises rapidement.
Ce rapport a été demandé aux scientifiques du GIEC lors de la COP21, en 2015, et les Etats insulaires y ont été pour beaucoup.
En effet, pour les Etats insulaires, la lutte contre les changements climatiques, « la plus grande des menaces », touche en effet à leur existence même.
Intéressons-nous ainsi à ces territoires considérés comme « particulièrement vulnérables » (au sens de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la CCNUCC) aux aléas climatiques et à leurs impacts, à ce que le Guardian n’hésite plus à appeler une « crise climatique ». Les territoires insulaires, et donc les populations, économies et écosystèmes qui les composent, subissent les multiples conséquences des dérèglements climatiques : augmentation des températures (température de l’air comme température océanique – avec un impact parfois forts sur les écosystèmes marins côtiers qui composent la majorité des moyens de subsistance des populations, on pense aux îles tropicales et au blanchissement des coraux par exemple), augmentation du niveau de la mer, érosion des zones littorales et salinisation des nappes phréatiques induites, inondations, sécheresses, acidification des océans, cyclones et tempêtes, etc.
Au-delà des impacts sectoriels ; on pense au tourisme, à l’agriculture ou à la pêche, ce sont des économies entières qui sont menacées comme ce fut le cas avec l’ouragan Pam en 2015 à l’origine d’une perte de 64 % du PIB annuel du Vanuatu, dans le Pacifique ; ou de Maria en 2017 qui a causé des dégâts d’une valeur de 224 % du PIB de l’île de la Dominique, dans les Caraïbes (Sources : Banque asiatique de développement et Banque Mondiale).
Indirectement (la corrélation est loin d’être simple et les relations de causes à effet non linéaires), ces mutations profondes de l’environnement immédiat des insulaires peut être une des causes ou un facteur aggravant des situations entraînant des déplacements et des migrations liées. Devant l’ampleur des impacts, les populations et leurs décideurs politiques commencent à chercher où trouver asile. Citons l’exemple de l’île de Tuvalu ou de Napuka dans l’archipel des Tuamotu (Polynésie Française), dans le Pacifique. Le gouvernement néo-zélandais a ainsi récemment innové en étudiant la possibilité d’accueillir sous statut et visa spécial lié à la « migration climatique dans le Pacifique ».
Pourtant les Etats et territoires insulaires ne représentent que quelques dixièmes de pour cent des émissions de gaz à effet de serre, émissions qui sont la cause des dérèglements climatiques que les scientifiques du GIEC observent, et que la population ressent.
Néanmoins, les îles ont réussi, au regard de leur poids géopolitique, à occuper une place importante au sein de la diplomatie multilatérale onusienne. Prenons l’exemple de la préparation de la COP21, la 21 ème conférence des Partie membres de la « convention climat » précédemment citée. En 2014 et 2015, les Etats insulaires ont établi des positions de négociation commune et ont mis en place, grâce à des leaders charismatiques, une stratégie qui leur a permis de gagner en visibilité et force de pression en amont de la COP21. Au sein de l’Alliance des Petits Etats Insulaires en Développement, les leaders politiques représentants les insulaires ont donné une visibilité internationale importante à la situation de leurs territoires, et « d’exister dans le rapport de force des négociations ».
De nombreuses déclarations ont ainsi mis en avant de la vulnérabilité de ces territoires, et l’engagement des insulaires à prendre leur part dans les stratégies de réduction de gaz à effets de serre au niveau mondial, envoyant un fort signal politique et symbolique : si des petits Etats peuvent mettre en œuvre la transition énergétique, les grandes puissances responsables des émissions mondiales et ainsi du dérèglement à l’œuvre le peuvent aussi! Ce fut le cas pour tous les océans, et que ce soit dans les Caraïbes, l’Océanie ou l’Indien, la mobilisation fut forte.
Cette attitude positive n’est pas nouvelle, et les leaders comme la société civile insulaire a ainsi mis en avant la situation depuis longtemps, pour preuve la cérémonie d’un conseil des ministres des îles Maldives, qui s’est déroulée à près de 10 mètres de profondeur, afin d’alerter sur l’imminence et les conséquences de la montée des eaux. Ils ont d’ailleurs été parmi les plus actifs pour la création de la Convention climat, en 1992. Comparativement à leurs poids démographiques et économiques, les insulaires ont joué, jouent et continueront probablement de jouer un rôle majeur sur le plan de la diplomatie climatique. Symboliquement et comme territoires pilotes des enjeux de transition énergétique et écologique, démonstrateurs de ce que développement bas-carbone et résilient peut vouloir dire.
Quelles sont les conséquences de l’implication des états insulaires au sein des négociations climat ? on peut en citer plusieurs.
Les Etats insulaires ont porté leurs positions qui sont désormais intégrées au sein de l’accord de Paris : objectif de long terme de +1.5°C d’augmentation des températures et « l’ambition climat », le sujet des « pertes et préjudices», celui des financements notamment. Ils ont aussi impulsé, et continuent d’impulser, une dynamique nouvelle pour aborder des sujets comme l’Océan, (porté par le « peuple de la pirogue » de l’Océanie), les questions de justice climatique, de lien entre sécurité et climat, etc. (cf. Ourbak et Magnan, 2018, pour plus de détails).
Forts de ce succès, les insulaires continuent de montrer la voie et poursuivent leurs efforts diplomatiques et politiques. Ils ont ainsi été parmi les premiers à ratifier l’accord de Paris, permettant d’entrainer d’autres nations et ainsi d’obtenir une entrée en vigueur précoce de l’accord de Paris le 4 novembre 2016. La présidence fidjienne de la COP23 en 2017 -une première dans le monde onusien peu habitué qu’un pays insulaire préside une COP au sein des négociations climat – continue de porter haut le
momentum
politique insulaire.
Particulièrement vulnérable, la communauté internationale en convient, mais les insulaires sont soumis à des contraintes énergétiques et leur « activisme » a permis à de nombreuses îles d’entamer des transitions vers des économies bas carbone, les rendant le plus indépendant énergétiquement possible, en s’appuyant sur leur potentiel en énergies renouvelables.
L’enjeu pour les insulaires est ainsi aussi celui d’une transition énergétique, un enjeu majeur pour ces territoires ayant un mix énergétique souvent totalement ou très fortement gouverné par les énergies fossiles, et de la recherche de soutien financier de la communauté internationale pour réaliser cette transition. L’enjeu est enfin celui du soutien à l’adaptation aux impacts déjà ressentis des changements climatiques, considérée comme une question de survie, et le corollaire des pertes et préjudices subis et à venir. Et les résultats de cette mobilisation paient, l’accès à la finance climat internationale comme le Fonds Vert pour le climat par exemple, relativement à leur poids démographique, est important.
Si l’insularité exacerbe les enjeux liés aux changements climatiques, les rend plus visibles et concrets, elle permet aussi de tester et de mettre en œuvre des solutions efficaces et économiquement performantes pour réduire les émissions comme pour s’adapter.
Reste à savoir si l’effet démonstrateur produira son effet au-delà des seules îles. Pour cela, les scientifiques du GIEC sont clairs : la fenêtre d’opportunité se réduit et il ne reste que très peu de temps pour agir.
Bibliographie
IPCC, 2018: Global warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H. O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J. B. R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M. I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, T. Waterfield (eds.)]. In Press.
OURBAK Timothée et Alexandre K, MAGNAN, 2018. The Paris Agreement and climate change negotiations: Small Islands, big players. Regional and Environmental Change 18: 2201. https://doi.org/10.1007/s10113-017-1247-9
Forts de ce succès, les insulaires continuent de montrer la voie et poursuivent leurs efforts diplomatiques et politiques. Ils ont ainsi été parmi les premiers à ratifier l’accord de Paris, permettant d’entrainer d’autres nations et ainsi d’obtenir une entrée en vigueur précoce de l’accord de Paris le 4 novembre 2016. La présidence fidjienne de la COP23 en 2017 -une première dans le monde onusien peu habitué qu’un pays insulaire préside une COP au sein des négociations climat – continue de porter haut le
momentum
politique insulaire.
Particulièrement vulnérable, la communauté internationale en convient, mais les insulaires sont soumis à des contraintes énergétiques et leur « activisme » a permis à de nombreuses îles d’entamer des transitions vers des économies bas carbone, les rendant le plus indépendant énergétiquement possible, en s’appuyant sur leur potentiel en énergies renouvelables.
L’enjeu pour les insulaires est ainsi aussi celui d’une transition énergétique, un enjeu majeur pour ces territoires ayant un mix énergétique souvent totalement ou très fortement gouverné par les énergies fossiles, et de la recherche de soutien financier de la communauté internationale pour réaliser cette transition. L’enjeu est enfin celui du soutien à l’adaptation aux impacts déjà ressentis des changements climatiques, considérée comme une question de survie, et le corollaire des pertes et préjudices subis et à venir. Et les résultats de cette mobilisation paient, l’accès à la finance climat internationale comme le Fonds Vert pour le climat par exemple, relativement à leur poids démographique, est important.
Si l’insularité exacerbe les enjeux liés aux changements climatiques, les rend plus visibles et concrets, elle permet aussi de tester et de mettre en œuvre des solutions efficaces et économiquement performantes pour réduire les émissions comme pour s’adapter.
Reste à savoir si l’effet démonstrateur produira son effet au-delà des seules îles. Pour cela, les scientifiques du GIEC sont clairs : la fenêtre d’opportunité se réduit et il ne reste que très peu de temps pour agir.
Bibliographie
IPCC, 2018: Global warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H. O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J. B. R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M. I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, T. Waterfield (eds.)]. In Press.
OURBAK Timothée et Alexandre K, MAGNAN, 2018. The Paris Agreement and climate change negotiations: Small Islands, big players. Regional and Environmental Change 18: 2201. https://doi.org/10.1007/s10113-017-1247-9