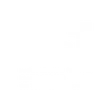Point veille semaine du 24 mars 2025
ILERI - Campus de Lyon Leclair
24/03/2025

CRISE A L’EST DE LA RDC : VERS UNE RELANCE DIPLOMATIQUE SOUS EGIDE REGIONALE ET QATARIE
Face à la persistance du conflit dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC), la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) et le Qatar ont réactivé les dynamiques de médiation régionales et internationales. Le sommet conjoint du 24 mars 2025 a marqué une inflexion stratégique avec la nomination d’un panel élargi de cinq facilitateurs, destiné à restaurer un processus de paix fragile entre Kinshasa et Kigali.
Lors d’un sommet virtuel réunissant les chefs d’État de la SADC et de l’EAC, trois nouveaux médiateurs ont rejoint « Olusegun Obasanjo (Nigeria) et Uhuru Kenyatta (Kenya) : Sahle-Work Zewde (Éthiopie), Kgalema Motlanthe (Afrique du Sud) et Catherine Samba-Panza (Centrafrique) »1. Ces nominations répondent à plusieurs critiques : manque de diversité régionale, faible représentation féminine, et absence de voix francophones. Cette recomposition vise à apaiser les tensions, notamment après le retrait du médiateur éthiopien Hailemariam Desalegn, jugé trop proche de Kigali par Kinshasa.
La feuille de route adoptée par le panel prévoit, dans les 30 jours, trois priorités : l’obtention d’un engagement politique clair des parties prenantes (RDC, Rwanda, M23), la mise en place d’un engagement militaire pour éviter une reprise des hostilités, et la création d’un mécanisme de vérification indépendant chargé de contrôler l’application du cessez-le-feu.
Parallèlement, le Qatar s’impose comme un nouvel acteur central. Le 18 mars à Doha, l’émir Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani a accueilli une rencontre inédite entre les présidents Félix Tshisekedi (RDC) et Paul Kagame (Rwanda). Cette rencontre a débouché sur une déclaration commune de cessez-le-feu « immédiat et inconditionnel »2, en référence aux engagements pris à Dar es-Salaam le 8 février. Toutefois, l’ambiguïté demeure sur le rôle et l’implication réelle du M23, dont les liens supposés avec Kigali sont au cœur des accusations congolaises.
Ce regain diplomatique survient dans un climat tendu. Le Rwanda a rompu ses relations diplomatiques avec la Belgique, en réaction aux sanctions de l’Union européenne contre des responsables militaires rwandais impliqués dans le soutien présumé au M23. Cette rupture complique davantage la recherche d’un consensus international.
1 | RFI. (2025, 25 mars). Est de la RDC: la SADC et l’EAC annoncent de nouveaux facilitateurs pour relancer le processus de paix. https://www.rfi.fr/fr/afrique/20250325-est-de-la-rdc-la-sadc-et-l-eac-annoncent-de-nouveaux-facilitateurs-pour-relancer-le-processus-de-paix
2 | Latour, V. (2025, 19 mars). Est de la RDC : Kagame et Tshisekedi annoncent un cessez-le-feu à Doha. Le Point. https://www.lepoint.fr/afrique/est-de-la-rdc-kagame-et-tshisekedi-annoncent-un-cessez-le-feu-a-doha-19-03-2025-2585115_3826.php#11
Lors d’un sommet virtuel réunissant les chefs d’État de la SADC et de l’EAC, trois nouveaux médiateurs ont rejoint « Olusegun Obasanjo (Nigeria) et Uhuru Kenyatta (Kenya) : Sahle-Work Zewde (Éthiopie), Kgalema Motlanthe (Afrique du Sud) et Catherine Samba-Panza (Centrafrique) »1. Ces nominations répondent à plusieurs critiques : manque de diversité régionale, faible représentation féminine, et absence de voix francophones. Cette recomposition vise à apaiser les tensions, notamment après le retrait du médiateur éthiopien Hailemariam Desalegn, jugé trop proche de Kigali par Kinshasa.
La feuille de route adoptée par le panel prévoit, dans les 30 jours, trois priorités : l’obtention d’un engagement politique clair des parties prenantes (RDC, Rwanda, M23), la mise en place d’un engagement militaire pour éviter une reprise des hostilités, et la création d’un mécanisme de vérification indépendant chargé de contrôler l’application du cessez-le-feu.
Parallèlement, le Qatar s’impose comme un nouvel acteur central. Le 18 mars à Doha, l’émir Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani a accueilli une rencontre inédite entre les présidents Félix Tshisekedi (RDC) et Paul Kagame (Rwanda). Cette rencontre a débouché sur une déclaration commune de cessez-le-feu « immédiat et inconditionnel »2, en référence aux engagements pris à Dar es-Salaam le 8 février. Toutefois, l’ambiguïté demeure sur le rôle et l’implication réelle du M23, dont les liens supposés avec Kigali sont au cœur des accusations congolaises.
Ce regain diplomatique survient dans un climat tendu. Le Rwanda a rompu ses relations diplomatiques avec la Belgique, en réaction aux sanctions de l’Union européenne contre des responsables militaires rwandais impliqués dans le soutien présumé au M23. Cette rupture complique davantage la recherche d’un consensus international.
1 | RFI. (2025, 25 mars). Est de la RDC: la SADC et l’EAC annoncent de nouveaux facilitateurs pour relancer le processus de paix. https://www.rfi.fr/fr/afrique/20250325-est-de-la-rdc-la-sadc-et-l-eac-annoncent-de-nouveaux-facilitateurs-pour-relancer-le-processus-de-paix
2 | Latour, V. (2025, 19 mars). Est de la RDC : Kagame et Tshisekedi annoncent un cessez-le-feu à Doha. Le Point. https://www.lepoint.fr/afrique/est-de-la-rdc-kagame-et-tshisekedi-annoncent-un-cessez-le-feu-a-doha-19-03-2025-2585115_3826.php#11

TEMPETE POLITIQUE EN TURQUIE : L’ARRESTATION DU MAIRE D’ISTANBUL EMBRASE LE PAYS
Des centaines de milliers de Turcs manifestent depuis une semaine après l’incarcération pour corruption d’Ekrem Imamoglu, principal opposant à Recep Tayyip Erdogan. Le pouvoir est accusé de dérive autoritaire.
L’incarcération d’Ekrem Imamoglu, maire d’Istanbul et figure majeure de l’opposition, a déclenché une vague de manifestations sans précédent en Turquie depuis les protestations de Gezi en 2013. Arrêté le 19 mars et placé en détention provisoire le 23 mars pour corruption, l’accusation de terrorisme ayant été rejetée l’édile a également été suspendu de ses fonctions.
Dès les premières heures, des rassemblements massifs ont gagné les grandes villes du pays, Istanbul en tête, où des dizaines de milliers de citoyens se pressent chaque soir devant l’hôtel de ville. Malgré la répression policière et l’interdiction des rassemblements, la contestation s’étend désormais à plus de 55 des 81 provinces turques.
Le Parti républicain du peuple (CHP), formation de M. Imamoglu, dénonce un "coup d’État politique" orchestré par le pouvoir en place. L’homme, vu comme le principal rival du président Erdogan pour la présidentielle de 2028, devait être investi candidat par son parti le jour même de son incarcération.
Le scrutin symbolique maintenu par le CHP a d’ailleurs tourné au plébiscite : 15 millions de personnes, bien au-delà du cercle des adhérents, ont voté en sa faveur. « Ekrem est en route vers la prison, mais aussi vers la présidence »3, a déclaré le leader du parti, Özgür Özel.
Dans les rues, les slogans fusent : "Droit, loi, justice", "Les dictateurs sont des lâches". La riposte du pouvoir ne s’est pas fait attendre : arrestations, restrictions d’accès à la ville, suspension du conseil de l’ordre des avocats d’Istanbul, fermeture de comptes sur les réseaux sociaux.
À l’international, la France et l’Allemagne ont exprimé leur préoccupation. Le maire d’Istanbul, de son côté, a déclaré par la voix de ses avocats : "Nous ferons échec à cette tache noire sur notre démocratie".
3 | Bourcier, N. (2025, 24 mars). En Turquie, le maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, incarcéré et « suspendu de ses fonctions », appelle à faire échec « à cette tache noire sur notre démocratie ». Le Monde. https://www.lemonde.fr/international/article/2025/03/24/en-turquie-le-maire-d-istanbul-ikrem-imamoglu-incarcere-et-suspendu-de-ses-fonctions-appelle-a-faire-echec-a-cette-tache-noire-sur-notre-democratie_6584940_3211.html
L’incarcération d’Ekrem Imamoglu, maire d’Istanbul et figure majeure de l’opposition, a déclenché une vague de manifestations sans précédent en Turquie depuis les protestations de Gezi en 2013. Arrêté le 19 mars et placé en détention provisoire le 23 mars pour corruption, l’accusation de terrorisme ayant été rejetée l’édile a également été suspendu de ses fonctions.
Dès les premières heures, des rassemblements massifs ont gagné les grandes villes du pays, Istanbul en tête, où des dizaines de milliers de citoyens se pressent chaque soir devant l’hôtel de ville. Malgré la répression policière et l’interdiction des rassemblements, la contestation s’étend désormais à plus de 55 des 81 provinces turques.
Le Parti républicain du peuple (CHP), formation de M. Imamoglu, dénonce un "coup d’État politique" orchestré par le pouvoir en place. L’homme, vu comme le principal rival du président Erdogan pour la présidentielle de 2028, devait être investi candidat par son parti le jour même de son incarcération.
Le scrutin symbolique maintenu par le CHP a d’ailleurs tourné au plébiscite : 15 millions de personnes, bien au-delà du cercle des adhérents, ont voté en sa faveur. « Ekrem est en route vers la prison, mais aussi vers la présidence »3, a déclaré le leader du parti, Özgür Özel.
Dans les rues, les slogans fusent : "Droit, loi, justice", "Les dictateurs sont des lâches". La riposte du pouvoir ne s’est pas fait attendre : arrestations, restrictions d’accès à la ville, suspension du conseil de l’ordre des avocats d’Istanbul, fermeture de comptes sur les réseaux sociaux.
À l’international, la France et l’Allemagne ont exprimé leur préoccupation. Le maire d’Istanbul, de son côté, a déclaré par la voix de ses avocats : "Nous ferons échec à cette tache noire sur notre démocratie".
3 | Bourcier, N. (2025, 24 mars). En Turquie, le maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, incarcéré et « suspendu de ses fonctions », appelle à faire échec « à cette tache noire sur notre démocratie ». Le Monde. https://www.lemonde.fr/international/article/2025/03/24/en-turquie-le-maire-d-istanbul-ikrem-imamoglu-incarcere-et-suspendu-de-ses-fonctions-appelle-a-faire-echec-a-cette-tache-noire-sur-notre-democratie_6584940_3211.html

LE MALI QUITTE A SON TOUR LA FRANCOPHONIE, UN NOUVEAU REVERS POUR L’INFLUENCE FRANÇAISE EN AFRIQUE
Après le Burkina Faso et le Niger, le Mali annonce son retrait de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF). Ce triple départ des pays sahéliens dirigés par des juntes militaires fragilise davantage le rayonnement culturel et diplomatique de la France dans la région.
Le Mali a annoncé, mardi 18 mars, son retrait de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), une décision qui survient au lendemain d’annonces similaires faites par le Burkina Faso et le Niger. Tous trois réunis au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES) et gouvernés par des régimes militaires, ces pays franchissent un nouveau pas dans leur rupture avec les institutions perçues comme proches de la France.
Dans une lettre adressée à l’OIF, le ministère malien des affaires étrangères justifie ce départ par « les agissements incompatibles avec les principes constitutionnels »4 de l’État malien, insistant sur la nécessité de préserver la souveraineté nationale. Cette décision entérine une dynamique de désengagement vis-à-vis des structures multilatérales jugées trop alignées sur les intérêts occidentaux.
« Le Mali, suspendu de l’OIF depuis août 2020 après le coup d’État ayant renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta »5, rejoint ainsi ses deux voisins dans une stratégie de repli souverainiste. L’organisation avait alors exigé un retour rapide à un pouvoir civil, tout en maintenant certaines actions de coopération à destination des populations.
Pour la Francophonie, et plus largement pour la France, ce triple retrait représente un coup dur en matière de soft power. L’OIF, fondée en 1970 et basée à Paris, incarne depuis plusieurs décennies un outil de rayonnement culturel et diplomatique, notamment en Afrique subsaharienne. La promotion du français, la défense de la diversité culturelle et le soutien aux droits humains figurent parmi ses principales missions.
La sortie coordonnée de trois États sahéliens francophones met en lumière un recul tangible de cette influence, dans un contexte où d’autres puissances, comme la Russie ou la Chine, renforcent leur présence diplomatique, militaire et économique dans la région. Ce basculement illustre un changement de paradigme : les anciennes alliances héritées de la période post-coloniale cèdent le pas à de nouvelles formes de partenariat, souvent fondées sur des rapports perçus comme plus égalitaires ou pragmatiques.
Si les conséquences immédiates de ce retrait sont avant tout symboliques, elles n’en sont pas moins significatives pour l’avenir de la Francophonie et de la place de la France sur le continent africain.
La perte de terrain dans ces pays stratégiques remet en question l’efficacité des instruments traditionnels d’influence, et appelle à une redéfinition des relations culturelles et diplomatiques.
4 | Le Monde. (2025, mars 18). Le Mali se retire à son tour de l’Organisation internationale de la francophonie. Le Monde. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2025/03/18/le-mali-se-retire-a-son-tour-de-l-organisation-internationale-de-la-francophonie_6583309_3212.html
5 | Ouest-France. (2025, mars 18). Le Mali quitte la Francophonie, après ses alliés nigérien et burkinabé. https://www.ouest-france.fr/monde/mali/le-mali-quitte-la-francophonie-apres-ses-allies-nigerien-et-burkinabe-855011ea-044c-11f0-a7a0-db29bf98805a
Le Mali a annoncé, mardi 18 mars, son retrait de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), une décision qui survient au lendemain d’annonces similaires faites par le Burkina Faso et le Niger. Tous trois réunis au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES) et gouvernés par des régimes militaires, ces pays franchissent un nouveau pas dans leur rupture avec les institutions perçues comme proches de la France.
Dans une lettre adressée à l’OIF, le ministère malien des affaires étrangères justifie ce départ par « les agissements incompatibles avec les principes constitutionnels »4 de l’État malien, insistant sur la nécessité de préserver la souveraineté nationale. Cette décision entérine une dynamique de désengagement vis-à-vis des structures multilatérales jugées trop alignées sur les intérêts occidentaux.
« Le Mali, suspendu de l’OIF depuis août 2020 après le coup d’État ayant renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta »5, rejoint ainsi ses deux voisins dans une stratégie de repli souverainiste. L’organisation avait alors exigé un retour rapide à un pouvoir civil, tout en maintenant certaines actions de coopération à destination des populations.
Pour la Francophonie, et plus largement pour la France, ce triple retrait représente un coup dur en matière de soft power. L’OIF, fondée en 1970 et basée à Paris, incarne depuis plusieurs décennies un outil de rayonnement culturel et diplomatique, notamment en Afrique subsaharienne. La promotion du français, la défense de la diversité culturelle et le soutien aux droits humains figurent parmi ses principales missions.
La sortie coordonnée de trois États sahéliens francophones met en lumière un recul tangible de cette influence, dans un contexte où d’autres puissances, comme la Russie ou la Chine, renforcent leur présence diplomatique, militaire et économique dans la région. Ce basculement illustre un changement de paradigme : les anciennes alliances héritées de la période post-coloniale cèdent le pas à de nouvelles formes de partenariat, souvent fondées sur des rapports perçus comme plus égalitaires ou pragmatiques.
Si les conséquences immédiates de ce retrait sont avant tout symboliques, elles n’en sont pas moins significatives pour l’avenir de la Francophonie et de la place de la France sur le continent africain.
La perte de terrain dans ces pays stratégiques remet en question l’efficacité des instruments traditionnels d’influence, et appelle à une redéfinition des relations culturelles et diplomatiques.
4 | Le Monde. (2025, mars 18). Le Mali se retire à son tour de l’Organisation internationale de la francophonie. Le Monde. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2025/03/18/le-mali-se-retire-a-son-tour-de-l-organisation-internationale-de-la-francophonie_6583309_3212.html
5 | Ouest-France. (2025, mars 18). Le Mali quitte la Francophonie, après ses alliés nigérien et burkinabé. https://www.ouest-france.fr/monde/mali/le-mali-quitte-la-francophonie-apres-ses-allies-nigerien-et-burkinabe-855011ea-044c-11f0-a7a0-db29bf98805a

Articles rédigés par Seydou Abass Traoré.