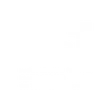Point veille semaine du 31 mars 2025
ILERI - Campus de Lyon Leclair
31/03/2025

L’UE envisage un processus de réarmement ?
L’Union européenne, à travers la Commission européenne, a démontré une certaine réalisation du contexte géopolitique tendu dans lequel nous vivons. La Commission européenne a publié début mars 2025 un livre blanc pour la défense européenne “Readiness 2030”[1]. Ce dernier met en lumière une vision de réarmement de l’Europe en s’assurant que l’industrie européenne de la Défense puisse produire à la vitesse demandée et le volume nécessaire et en facilitant le déploiement rapide de troupes et d’équipements militaires sur le territoire de l’Union européenne. En addition au livre blanc, la Commission européenne a publié un plan de réarmement “ReArm Europe Plan”. Il libère 800 milliards d'euros pour booster les dépenses du secteur de la défense des Etats membres. Le plan met en place un instrument, le Security Action for Europe (SAFE), de 150 milliards d’euros de prêt aux Etats membres sur présentation de plan d’action de leur part. Le plan comprend aussi 650 milliards d’euros en marge de manœuvre fiscale sur 4 ans en déclenchant une clause spéciale du Pacte Stabilité et Croissance, la “national escape clause”. Cela signifie que les Etats membres peuvent dépenser jusqu’à 1.5% de leur PIB dans des dépenses militaires sans craindre d’enfreindre les règles budgétaires qui encadrent les déficits publics. Enfin, le but est aussi de soutenir la Banque européenne d’Investissement (BEI) en l’aidant à élargir ses possibilités d’investissement dans des projets de défense et sécurité et en accélérant la mobilisation privée de capitaux via l’Union de l’Investissement et de l'Épargne[2].
Ce plan de réarmement tombe en plein milieu d’un conflit sur le sol européen, ce qui n’avait pas eu lieu depuis la Seconde Guerre mondiale. L’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 et les élections présidentielles américaines de novembre 2024 ont relancé les dés. En effet, Donald Trump ayant été élu 47ème Président des Etats-Unis s’est rapproché de Vladimir Poutine en s’écartant de ses alliés européens car le Président Trump ne voit pas les relations avec la Russie et la situation en Ukraine du même œil que les Européens. C’est l’une des premières fois qu’un Président américain remet en cause le système de défense de l’OTAN, et annonce que les Européens doivent dépenser plus pour leur propre défense. Selon Donald Trump, ce n’est plus aux contribuables étasuniens de payer pour la défense des autres, entendez les Européens.
Les réactions des chefs d’Etats et Ministres des Etats membres à ce plan de réarmement sont diverses et assez mitigées pour certains. Le ministre polonais de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz juge que des subventions auraient été une meilleure option, que ça aurait été “plus effectif”. La ministre allemande des Affaires étrangères Analena Bearbock a décrit le plan comme “une première étape importante”, jouant sur le fait qu’il faille en faire plus. Le Premier Ministre grecque Kyriakos Mitsotakis a salué les propositions de la Commission européenne mais a ajouté vouloir travailler sur les détails pour que tous les Etats membres en bénéficient, peu importe leurs dépenses dans le secteur de la défense. La BEI a réagi en précisant que, même si les possibilités d’investissement dans le secteur de la défense sont élargies, le financement d’armes à feu et de munitions est interdit. La Commission a aussi annoncé que les dépenses dans le secteur de la défense seront exemptées des limites imposées par l’Union européenne sur la dette des Etats membres[3]. Le Monde cite une “menace russe” à laquelle il faudrait faire face et un désengagement américain[4]. Selon Die Zeit, à la fois la population, le parti au pouvoir et l’opposition en Italie et en Espagne ne sont pas à l’aise avec le terme “ReArm Europe“. L’Italie de Giorgia Meloni dit beaucoup de choses, donne son soutien, mais ne fait pas grand chose de substantiel. Elle n’a presque rien produit de concret en trois ans de guerre avec la Russie. De plus, les partis Lega et Forza Italia agissent plutôt de manière amicale envers la Russie de Poutine. L’Espagne, comme l’Italie, ne donne que peu de ressources financières à l’Ukraine, environ 1.5% de leur PIB respectif, notamment car l’augmentation des dépenses pour la défense ne sont pas très populaires. En outre, le fait que la France et la Grande-Bretagne aient proposé des armistices sans consulter d’autres pays européens, n’est pas bien passé à l’échelle européenne[5].
[1] Joint White Paper for European Defense Readiness 2030, The European Commission through the High Representative for the Union for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas, 19 mars 2025.
[2] Acting on Defense to Protect Europeans, the European Commission. Future of European defence - European Commission
[3] Europe Proposes Borrowing 150 Billion Euros in Big Rearmament Push, Jan Strewprczewski et Andrew Gray, Reuters, le 4 mars 2025.
[4] L’Union européenne lance le processus de son réarmement, Le Monde avec AFP, 19 mars 2025.
[5] EU-Gipfel: Koalition der Unwilligen, Eine Analyse von Ulrich Ladurner, Die Zeit ONLINE, 21 mars 2025.
Ce plan de réarmement tombe en plein milieu d’un conflit sur le sol européen, ce qui n’avait pas eu lieu depuis la Seconde Guerre mondiale. L’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 et les élections présidentielles américaines de novembre 2024 ont relancé les dés. En effet, Donald Trump ayant été élu 47ème Président des Etats-Unis s’est rapproché de Vladimir Poutine en s’écartant de ses alliés européens car le Président Trump ne voit pas les relations avec la Russie et la situation en Ukraine du même œil que les Européens. C’est l’une des premières fois qu’un Président américain remet en cause le système de défense de l’OTAN, et annonce que les Européens doivent dépenser plus pour leur propre défense. Selon Donald Trump, ce n’est plus aux contribuables étasuniens de payer pour la défense des autres, entendez les Européens.
Les réactions des chefs d’Etats et Ministres des Etats membres à ce plan de réarmement sont diverses et assez mitigées pour certains. Le ministre polonais de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz juge que des subventions auraient été une meilleure option, que ça aurait été “plus effectif”. La ministre allemande des Affaires étrangères Analena Bearbock a décrit le plan comme “une première étape importante”, jouant sur le fait qu’il faille en faire plus. Le Premier Ministre grecque Kyriakos Mitsotakis a salué les propositions de la Commission européenne mais a ajouté vouloir travailler sur les détails pour que tous les Etats membres en bénéficient, peu importe leurs dépenses dans le secteur de la défense. La BEI a réagi en précisant que, même si les possibilités d’investissement dans le secteur de la défense sont élargies, le financement d’armes à feu et de munitions est interdit. La Commission a aussi annoncé que les dépenses dans le secteur de la défense seront exemptées des limites imposées par l’Union européenne sur la dette des Etats membres[3]. Le Monde cite une “menace russe” à laquelle il faudrait faire face et un désengagement américain[4]. Selon Die Zeit, à la fois la population, le parti au pouvoir et l’opposition en Italie et en Espagne ne sont pas à l’aise avec le terme “ReArm Europe“. L’Italie de Giorgia Meloni dit beaucoup de choses, donne son soutien, mais ne fait pas grand chose de substantiel. Elle n’a presque rien produit de concret en trois ans de guerre avec la Russie. De plus, les partis Lega et Forza Italia agissent plutôt de manière amicale envers la Russie de Poutine. L’Espagne, comme l’Italie, ne donne que peu de ressources financières à l’Ukraine, environ 1.5% de leur PIB respectif, notamment car l’augmentation des dépenses pour la défense ne sont pas très populaires. En outre, le fait que la France et la Grande-Bretagne aient proposé des armistices sans consulter d’autres pays européens, n’est pas bien passé à l’échelle européenne[5].
[1] Joint White Paper for European Defense Readiness 2030, The European Commission through the High Representative for the Union for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas, 19 mars 2025.
[2] Acting on Defense to Protect Europeans, the European Commission. Future of European defence - European Commission
[3] Europe Proposes Borrowing 150 Billion Euros in Big Rearmament Push, Jan Strewprczewski et Andrew Gray, Reuters, le 4 mars 2025.
[4] L’Union européenne lance le processus de son réarmement, Le Monde avec AFP, 19 mars 2025.
[5] EU-Gipfel: Koalition der Unwilligen, Eine Analyse von Ulrich Ladurner, Die Zeit ONLINE, 21 mars 2025.

La montée de l’influence de la Chine en Asie du Sud-Est
« L’Asie aux Asiatiques ! » : ce mot d’ordre lancé par Xi Jinping illustre la vision stratégique que la Chine entend imposer à son voisinage régional. Forte de son poids économique, de sa modernisation militaire et de sa diplomatie active, la République populaire s’impose désormais comme une puissance incontournable en Asie – et en particulier en Asie du Sud-Est, où elle étend son influence à un rythme soutenu.
Pékin cherche à bâtir une forme d’hégémonie douce, mais structurante, au sein de l’ASEAN. Les outils de cette influence sont multiples : le développement massif d’infrastructures via les « nouvelles routes de la soie », l’expansion du commerce bilatéral, les investissements directs et les projets de connectivité, comme le train à grande vitesse entre Bangkok et Nakhon Ratchasima en Thaïlande. Le Cambodge et le Laos, totalement intégrés aux circuits économiques et diplomatiques chinois, apparaissent même aujourd’hui comme de véritables États tributaires. À cela s’ajoute une présence militaire discrète mais croissante, comme le montre le rôle stratégique joué par le port de Gwadar au Pakistan ou encore les installations portuaires sri-lankaises d’Hambantota, cédées à la Chine sur 99 ans.
Cette montée en puissance se manifeste également sur le plan maritime. En mer de Chine méridionale, Pékin revendique une souveraineté quasi exclusive sur près de 90 % de la zone, selon la fameuse ligne en neuf traits. Pour y asseoir sa présence, la Chine a construit et militarisé plusieurs îles artificielles dans l’archipel des Spratleys, en y déployant missiles, radars, et pistes d’atterrissage. Elle y impose sa propre lecture du droit maritime international, souvent en contradiction avec les décisions arbitrales internationales, notamment celle de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye en 2016, qu’elle refuse d’appliquer.
Pour autant, cette influence croissante n’est pas sans susciter de vives inquiétudes chez ses voisins. Plusieurs États de la région – comme l’Indonésie, Singapour ou encore le Vietnam – cherchent à contrebalancer l’emprise chinoise en resserrant leurs liens stratégiques avec les États-Unis ou en développant de nouvelles formes de coopération régionale. Même la Corée du Nord, historiquement dépendante de Pékin, a manifesté à certaines périodes sa volonté de s’émanciper partiellement de l’influence chinoise, notamment dans le cadre de ses pourparlers avec les États-Unis.
Ainsi, l’Asie du Sud-Est devient le théâtre d’une recomposition géopolitique majeure, où la Chine tente d’imposer une nouvelle équation de puissance, fondée sur une domination économique appuyée par des leviers diplomatiques, militaires et culturels[1].
Symbole à la fois géographique et stratégique, le Mékong est devenu l’un des principaux laboratoires de l’influence chinoise en Asie du Sud-Est. En investissant massivement dans les infrastructures, en tissant des liens diplomatiques privilégiés avec certains gouvernements, et en mobilisant les ressorts de la coopération régionale, Pékin cherche à verrouiller cette zone clé, essentielle à sa sécurité et à sa projection de puissance.
Le projet de canal Funan Techo au Cambodge incarne parfaitement cette dynamique. Officiellement conçu pour relier Phnom Penh à Sihanoukville sans dépendre des ports vietnamiens, ce projet de 1,7 milliard de dollars soulève de nombreuses interrogations quant à ses réelles finalités. Derrière les discours sur le développement et la souveraineté économique, les observateurs relèvent l’implication directe d’acteurs chinois, notamment le géant public China Road and Bridge Corporation, proche du pouvoir à Pékin. À travers le canal, la Chine pourrait bénéficier d’un accès stratégique à la partie inférieure du Mékong, renforçant ainsi sa présence dans une région historiquement disputée et limitrophe du Vietnam.
Outre le Cambodge, Pékin multiplie ses initiatives d’influence dans les pays riverains du Mékong, via la Lancang-Mekong Cooperation (LMC). Créé en 2016, ce mécanisme diplomatique réunit les six pays traversés par le fleuve – de la Chine au Vietnam – et fonctionne comme un outil de coordination économique et sécuritaire sous direction chinoise. Derrière ce soft power affiché, la Chine contrôle le débit du fleuve via onze barrages situés sur sa portion tibétaine, ce qui lui permet d'exercer une pression indirecte mais décisive sur ses voisins.
Cette emprise passe aussi par l’installation de zones économiques spéciales, notamment au Laos, en Birmanie et au Cambodge, souvent cédées pour de longues durées à des entreprises chinoises. Ces enclaves, bâties sur le modèle « Build Operate Transfer », sont perçues comme autant de leviers de contrôle, voire de points d’appui logistique, certains observateurs soupçonnant des usages potentiels à double vocation : civile et militaire.
Le cas de la base navale de Ream au Cambodge cristallise ces craintes. Modernisée avec l’aide de la Chine, elle pourrait servir à terme de soutien logistique aux opérations navales chinoises en mer de Chine méridionale. Cette présence stratégique dans un pays membre de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) est perçue par plusieurs capitales, notamment Hanoï et Washington, comme une tentative de contournement des équilibres régionaux.
Enfin, l’activisme chinois sur le Mékong n’échappe pas aux résistances locales et régionales. Le Vietnam, historiquement méfiant vis-à-vis de Pékin, s’inquiète des répercussions géopolitiques et environnementales de ces projets. En Thaïlande, les populations locales et les ONG ont su bloquer certains projets, comme celui du dynamitage des rapides de Chiang Khong, perçus comme une menace directe à l’écosystème et à la souveraineté fluviale.
Ainsi, autour du Mékong, se joue une partie complexe mêlant ambitions économiques, stratégies d’influence, rivalités de puissances et réactions locales. Loin d’être une simple vitrine de coopération régionale, la stratégie chinoise sur le fleuve révèle une volonté plus profonde : celle d’inscrire durablement la Chine comme puissance structurante de l’Asie continentale[2].
[1] La Chine : puissance hégémonique en Asie, Jean-Pierre Cabestan, Vie Publique, 29 juillet 2019.
[2] Le Mekong, un fleuve sous l’emprise de la Chine, Brice Pedroletti, Le Monde, 10 novembre 2024.
Pékin cherche à bâtir une forme d’hégémonie douce, mais structurante, au sein de l’ASEAN. Les outils de cette influence sont multiples : le développement massif d’infrastructures via les « nouvelles routes de la soie », l’expansion du commerce bilatéral, les investissements directs et les projets de connectivité, comme le train à grande vitesse entre Bangkok et Nakhon Ratchasima en Thaïlande. Le Cambodge et le Laos, totalement intégrés aux circuits économiques et diplomatiques chinois, apparaissent même aujourd’hui comme de véritables États tributaires. À cela s’ajoute une présence militaire discrète mais croissante, comme le montre le rôle stratégique joué par le port de Gwadar au Pakistan ou encore les installations portuaires sri-lankaises d’Hambantota, cédées à la Chine sur 99 ans.
Cette montée en puissance se manifeste également sur le plan maritime. En mer de Chine méridionale, Pékin revendique une souveraineté quasi exclusive sur près de 90 % de la zone, selon la fameuse ligne en neuf traits. Pour y asseoir sa présence, la Chine a construit et militarisé plusieurs îles artificielles dans l’archipel des Spratleys, en y déployant missiles, radars, et pistes d’atterrissage. Elle y impose sa propre lecture du droit maritime international, souvent en contradiction avec les décisions arbitrales internationales, notamment celle de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye en 2016, qu’elle refuse d’appliquer.
Pour autant, cette influence croissante n’est pas sans susciter de vives inquiétudes chez ses voisins. Plusieurs États de la région – comme l’Indonésie, Singapour ou encore le Vietnam – cherchent à contrebalancer l’emprise chinoise en resserrant leurs liens stratégiques avec les États-Unis ou en développant de nouvelles formes de coopération régionale. Même la Corée du Nord, historiquement dépendante de Pékin, a manifesté à certaines périodes sa volonté de s’émanciper partiellement de l’influence chinoise, notamment dans le cadre de ses pourparlers avec les États-Unis.
Ainsi, l’Asie du Sud-Est devient le théâtre d’une recomposition géopolitique majeure, où la Chine tente d’imposer une nouvelle équation de puissance, fondée sur une domination économique appuyée par des leviers diplomatiques, militaires et culturels[1].
Symbole à la fois géographique et stratégique, le Mékong est devenu l’un des principaux laboratoires de l’influence chinoise en Asie du Sud-Est. En investissant massivement dans les infrastructures, en tissant des liens diplomatiques privilégiés avec certains gouvernements, et en mobilisant les ressorts de la coopération régionale, Pékin cherche à verrouiller cette zone clé, essentielle à sa sécurité et à sa projection de puissance.
Le projet de canal Funan Techo au Cambodge incarne parfaitement cette dynamique. Officiellement conçu pour relier Phnom Penh à Sihanoukville sans dépendre des ports vietnamiens, ce projet de 1,7 milliard de dollars soulève de nombreuses interrogations quant à ses réelles finalités. Derrière les discours sur le développement et la souveraineté économique, les observateurs relèvent l’implication directe d’acteurs chinois, notamment le géant public China Road and Bridge Corporation, proche du pouvoir à Pékin. À travers le canal, la Chine pourrait bénéficier d’un accès stratégique à la partie inférieure du Mékong, renforçant ainsi sa présence dans une région historiquement disputée et limitrophe du Vietnam.
Outre le Cambodge, Pékin multiplie ses initiatives d’influence dans les pays riverains du Mékong, via la Lancang-Mekong Cooperation (LMC). Créé en 2016, ce mécanisme diplomatique réunit les six pays traversés par le fleuve – de la Chine au Vietnam – et fonctionne comme un outil de coordination économique et sécuritaire sous direction chinoise. Derrière ce soft power affiché, la Chine contrôle le débit du fleuve via onze barrages situés sur sa portion tibétaine, ce qui lui permet d'exercer une pression indirecte mais décisive sur ses voisins.
Cette emprise passe aussi par l’installation de zones économiques spéciales, notamment au Laos, en Birmanie et au Cambodge, souvent cédées pour de longues durées à des entreprises chinoises. Ces enclaves, bâties sur le modèle « Build Operate Transfer », sont perçues comme autant de leviers de contrôle, voire de points d’appui logistique, certains observateurs soupçonnant des usages potentiels à double vocation : civile et militaire.
Le cas de la base navale de Ream au Cambodge cristallise ces craintes. Modernisée avec l’aide de la Chine, elle pourrait servir à terme de soutien logistique aux opérations navales chinoises en mer de Chine méridionale. Cette présence stratégique dans un pays membre de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) est perçue par plusieurs capitales, notamment Hanoï et Washington, comme une tentative de contournement des équilibres régionaux.
Enfin, l’activisme chinois sur le Mékong n’échappe pas aux résistances locales et régionales. Le Vietnam, historiquement méfiant vis-à-vis de Pékin, s’inquiète des répercussions géopolitiques et environnementales de ces projets. En Thaïlande, les populations locales et les ONG ont su bloquer certains projets, comme celui du dynamitage des rapides de Chiang Khong, perçus comme une menace directe à l’écosystème et à la souveraineté fluviale.
Ainsi, autour du Mékong, se joue une partie complexe mêlant ambitions économiques, stratégies d’influence, rivalités de puissances et réactions locales. Loin d’être une simple vitrine de coopération régionale, la stratégie chinoise sur le fleuve révèle une volonté plus profonde : celle d’inscrire durablement la Chine comme puissance structurante de l’Asie continentale[2].
[1] La Chine : puissance hégémonique en Asie, Jean-Pierre Cabestan, Vie Publique, 29 juillet 2019.
[2] Le Mekong, un fleuve sous l’emprise de la Chine, Brice Pedroletti, Le Monde, 10 novembre 2024.

La reprise des attaques israéliennes sur la bande de Gaza et pas que…
Un cessez-le-feu avait commencé le 19 janvier 2025, une importante première étape qui a redonné de l’espoir au monde. Le plan était structuré en trois phases, la première phase a consisté en la libération d’otages détenus par le Hamas et Israël. 25 prisonniers et les dépouilles de 8 autres otages détenus par le Hamas ont été échangés avec 1800 prisonniers détenus sur le sol israelien. Les forces armées israéliennes se sont retirées des zones habitées, permettant aux habitants de retourner chez eux. Dans la deuxième phase, les négociations devaient commencer le 4 février mais n’ont jamais eu lieu. Cette deuxième phase devait permettre un cessez-le-feu permanent, le retrait total des troupes israéliennes de Gaza et la libération des derniers otages des deux camps. La troisième phase devrait permettre la récupération des dépouilles, et commencer la confection des plans de la reconstruction de Gaza. En revanche, le 47ème Président des Etats-Unis Donald J. Trump avait formulé une nouvelle proposition de prolongation du cessez-le-feu. Ceci a amené Israël a arrêté toute aide humanitaire qui souhaitait rentrer dans la bande de Gaza à partir du 2 mars. Trump voulait libérer les otages en deux fois, une première moitié au début du cessez-le-feu, puis le reste à la fin.
Les forces israéliennes ont mené de nouvelles frappes meurtrières depuis le cessez-le-feu du 19 janvier 2025. La journée du 22 mars a été la plus meurtrière depuis le 7 octobre 2023 et la guerre qui en suivit. Le cessez-le-feu n’est pas officiellement terminé, certains pensent qu’Israël a repris les frappes pour essayer de faire pression sur le Hamas pour qu’il accepte la nouvelle proposition de cessez-le-feu par Trump, exprimant le refus “à plusieurs reprises” du Hamas des propositions d’Israël quant au calendrier de la libération des otages et le retrait des troupes israéliennes. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que “Israël agira contre le Hamas avec une intensité militaire croissante”. Ce même personnage a aussi déclaré que le Hamas avait à plusieurs reprises décliné leurs propositions et qu’il n’y avait donc “pas d’autres choix”. Ce même porte-parole a aussi déclaré à la BBC que le cessez-le-feu était terminé[1].
Le 28 mars, Israël a mené une frappe aérienne sur un quartier du sud de Beyrouth, marquant une rupture dans le cessez-le-feu conclu en novembre dernier avec le Hezbollah. Le président français Emmanuel Macron a dénoncé une attaque « unilatérale » sans preuve de provocation, appelant au respect de l’accord, qui prévoyait le retrait israélien et le déploiement de l’armée libanaise au sud du pays.
Depuis plusieurs semaines, les accusations de violations se multiplient entre les deux camps. Cette nouvelle frappe israélienne intervient dans un contexte régional déjà tendu, alors que les opérations militaires se poursuivent à Gaza. En ciblant le Liban, Israël entend réaffirmer sa ligne rouge sécuritaire, au risque d’amplifier encore l’instabilité au Proche-Orient[2].
L’attaque du 28 mars est la première attaque de cette ampleur sur la capitale libanaise depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, négocié avec l’aide de la France et des États-Unis.
L’intervention israélienne fait suite à des tirs de roquettes depuis le territoire libanais – l’une ayant été interceptée, l’autre tombée au sol – que le Hezbollah a immédiatement démenti avoir lancés. En réponse, Israël a mené d’autres frappes ciblées au sud du Liban, tout en avertissant la population civile proche des infrastructures du Hezbollah de s’éloigner. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a déclaré qu’aucune attaque ne serait tolérée contre le territoire israélien et qu’Israël se réserve le droit de frapper « partout au Liban » si sa sécurité est menacée.
Ces incidents révèlent la fragilité extrême du cessez-le-feu. Depuis le début de la guerre à Gaza en octobre, le Hezbollah affirme soutenir le Hamas par des actions à la frontière nord d’Israël, tandis que Tsahal multiplie les frappes de représailles. Si l’implication directe du Hezbollah semble contenue pour le moment, le risque d’une extension du conflit reste élevé dans cette région déjà sous tension[3].
[1] Qu’est-il devenu du cessez-le-feu à Gaza ?, Daniel Wittenberg & Lana Owen, Reuteurs, 22 mars 2025
[2] Israel’s attacks on Lebanon ‘unjustified’, Macron says as he plans call with Trump, Reuters, 28 mars 2025.
[3] Erster israelischer Luftangriff bei Berut seit November, Die ZEIT, 28 mars 2025
Les forces israéliennes ont mené de nouvelles frappes meurtrières depuis le cessez-le-feu du 19 janvier 2025. La journée du 22 mars a été la plus meurtrière depuis le 7 octobre 2023 et la guerre qui en suivit. Le cessez-le-feu n’est pas officiellement terminé, certains pensent qu’Israël a repris les frappes pour essayer de faire pression sur le Hamas pour qu’il accepte la nouvelle proposition de cessez-le-feu par Trump, exprimant le refus “à plusieurs reprises” du Hamas des propositions d’Israël quant au calendrier de la libération des otages et le retrait des troupes israéliennes. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que “Israël agira contre le Hamas avec une intensité militaire croissante”. Ce même personnage a aussi déclaré que le Hamas avait à plusieurs reprises décliné leurs propositions et qu’il n’y avait donc “pas d’autres choix”. Ce même porte-parole a aussi déclaré à la BBC que le cessez-le-feu était terminé[1].
Le 28 mars, Israël a mené une frappe aérienne sur un quartier du sud de Beyrouth, marquant une rupture dans le cessez-le-feu conclu en novembre dernier avec le Hezbollah. Le président français Emmanuel Macron a dénoncé une attaque « unilatérale » sans preuve de provocation, appelant au respect de l’accord, qui prévoyait le retrait israélien et le déploiement de l’armée libanaise au sud du pays.
Depuis plusieurs semaines, les accusations de violations se multiplient entre les deux camps. Cette nouvelle frappe israélienne intervient dans un contexte régional déjà tendu, alors que les opérations militaires se poursuivent à Gaza. En ciblant le Liban, Israël entend réaffirmer sa ligne rouge sécuritaire, au risque d’amplifier encore l’instabilité au Proche-Orient[2].
L’attaque du 28 mars est la première attaque de cette ampleur sur la capitale libanaise depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, négocié avec l’aide de la France et des États-Unis.
L’intervention israélienne fait suite à des tirs de roquettes depuis le territoire libanais – l’une ayant été interceptée, l’autre tombée au sol – que le Hezbollah a immédiatement démenti avoir lancés. En réponse, Israël a mené d’autres frappes ciblées au sud du Liban, tout en avertissant la population civile proche des infrastructures du Hezbollah de s’éloigner. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a déclaré qu’aucune attaque ne serait tolérée contre le territoire israélien et qu’Israël se réserve le droit de frapper « partout au Liban » si sa sécurité est menacée.
Ces incidents révèlent la fragilité extrême du cessez-le-feu. Depuis le début de la guerre à Gaza en octobre, le Hezbollah affirme soutenir le Hamas par des actions à la frontière nord d’Israël, tandis que Tsahal multiplie les frappes de représailles. Si l’implication directe du Hezbollah semble contenue pour le moment, le risque d’une extension du conflit reste élevé dans cette région déjà sous tension[3].
[1] Qu’est-il devenu du cessez-le-feu à Gaza ?, Daniel Wittenberg & Lana Owen, Reuteurs, 22 mars 2025
[2] Israel’s attacks on Lebanon ‘unjustified’, Macron says as he plans call with Trump, Reuters, 28 mars 2025.
[3] Erster israelischer Luftangriff bei Berut seit November, Die ZEIT, 28 mars 2025

Articles rédigés par Jay Thénot-Wrobel