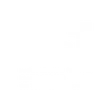Ressorts et effets de la crise sanitaire : vers un « régime global de colère » ?
31/07/2020

Par Myriam Benraad, professeur à l’ILERI
La pandémie de COVID-19 se poursuit inexorablement en cet été 2020, charriant dans son sillage un flot ininterrompu de colère parmi les États, acteurs politiques et sociétés civiles. Cette colère se veut tout aussi réactionnelle et immédiate dans ses expressions qu’inscrite dans la durée. Chaque manifestation, chaque effet mesurable et chaque conséquence concrète de cette crise inédite se traduit en effet, au plan des émotions, par des élans colériques qui ont tous pour point commun une défiance face au présent et une crainte partagée face à l’avenir proche ou plus lointain. Le drame humain suscité par le nouveau coronavirus a-t-il d’ores et déjà muté en un « régime global de colère » (1) ?
La pandémie de COVID-19 se poursuit inexorablement en cet été 2020, charriant dans son sillage un flot ininterrompu de colère parmi les États, acteurs politiques et sociétés civiles. Cette colère se veut tout aussi réactionnelle et immédiate dans ses expressions qu’inscrite dans la durée. Chaque manifestation, chaque effet mesurable et chaque conséquence concrète de cette crise inédite se traduit en effet, au plan des émotions, par des élans colériques qui ont tous pour point commun une défiance face au présent et une crainte partagée face à l’avenir proche ou plus lointain. Le drame humain suscité par le nouveau coronavirus a-t-il d’ores et déjà muté en un « régime global de colère » (1) ?
Pandémie et colère : la consécration d’un paradigme affectuel
Soulèvements populaires, contestations sociales transnationales, insurrections et terrorismes, surenchères populistes et retour des nationalismes, reflux de l’autoritarisme politique, guerres civiles et conflits gelés dans le temps, rancœurs nouvelles comme plus anciennes, hostilités numériques : jamais la colère n’a semblé plus vive et intimement liée aux transformations géopolitiques qu’exacerbe le contexte pandémique. Jour après jour ainsi, cette colère globale se trouve amplifiée par un déluge d’événements qui se succèdent depuis les premiers cas d’infection au SARS-COV-2 recensés à Wuhan, dans la province chinoise du Hubei, au cours de l’hiver 2019 (2).
Circulant sur tous les territoires, et dans tous les espaces, le virus et l’échauffement qu’il cause, au sens propre comme figuré, rebattent en profondeur les rapports de force sociaux, politiques, économiques, identitaires et culturels. Depuis la fin du confinement, cette émotion primordiale ne s’est d’ailleurs guère tarie dans un pays comme la France mais, au contraire, étendue de manière exponentielle (3). Elle s’exprime tantôt au grand jour (colère noire des médecins et soignants, des travailleurs, des syndicats), tantôt de façon plus discrète, dans les entrefilets d’une actualité constamment bousculée. « Rage mondiale », « ressentiment global », « haine généralisée » : les formules qui tentent de déchiffrer ce tumulte sont légion. Si elle avait certes déjà fait son retour à l’aube du nouveau millénaire, la colère menace à présent de terrasser le monde.
À plus d’un titre, la crise fait figure d’« envers » d’une globalisation qui n’est plus si heureuse qu’il n’y paraissait (4). À en croire ses plus farouches détracteurs, le coronavirus dévoilerait d’ailleurs la réalité d’un système international fondé sur la prédation, lequel, en supplantant la primauté des États-nations et leur souveraineté dès la décennie 1990, n’aurait généré qu’ire et ressentiment parmi les peuples. Par l’érosion des cultures, des traditions et des solidarités, ce système aurait favorisé l’émergence d’oligarchies plus préoccupées par le maintien de leurs privilèges que par la sauvegarde de l’intérêt collectif. Il aurait généralisé le consumérisme en creusant inégalités et injustices, et paradoxalement accéléré le morcellement de la géographie sous une apparente uniformité.
Circulant sur tous les territoires, et dans tous les espaces, le virus et l’échauffement qu’il cause, au sens propre comme figuré, rebattent en profondeur les rapports de force sociaux, politiques, économiques, identitaires et culturels. Depuis la fin du confinement, cette émotion primordiale ne s’est d’ailleurs guère tarie dans un pays comme la France mais, au contraire, étendue de manière exponentielle (3). Elle s’exprime tantôt au grand jour (colère noire des médecins et soignants, des travailleurs, des syndicats), tantôt de façon plus discrète, dans les entrefilets d’une actualité constamment bousculée. « Rage mondiale », « ressentiment global », « haine généralisée » : les formules qui tentent de déchiffrer ce tumulte sont légion. Si elle avait certes déjà fait son retour à l’aube du nouveau millénaire, la colère menace à présent de terrasser le monde.
À plus d’un titre, la crise fait figure d’« envers » d’une globalisation qui n’est plus si heureuse qu’il n’y paraissait (4). À en croire ses plus farouches détracteurs, le coronavirus dévoilerait d’ailleurs la réalité d’un système international fondé sur la prédation, lequel, en supplantant la primauté des États-nations et leur souveraineté dès la décennie 1990, n’aurait généré qu’ire et ressentiment parmi les peuples. Par l’érosion des cultures, des traditions et des solidarités, ce système aurait favorisé l’émergence d’oligarchies plus préoccupées par le maintien de leurs privilèges que par la sauvegarde de l’intérêt collectif. Il aurait généralisé le consumérisme en creusant inégalités et injustices, et paradoxalement accéléré le morcellement de la géographie sous une apparente uniformité.
Disposition courroucée des États et désaveu de la négociation
En 2011, le chercheur Todd H. Hall posait la question : « Qu’est-ce qu’un État en colère ? » (5), revenue à l’avant-plan des débats dans le contexte d’un virus pesant distinctement de tout son poids sur la disposition des acteurs à l’agressivité et au conflit. Cette tendance n’a rien de nouveau mais elle s’accélère de manière inquiétante depuis le choc sanitaire, avec une montée des pulsions coléreuses et réflexes véhéments qui s’y réfèrent. Non maîtrisées, ces pulsions sont susceptibles de favoriser une escalade des tensions entre États, tangibles entre membres de l’Union européenne par exemple, voire l’éclatement de nouvelles conflictualités.
Donald Trump, à l’instar d’autres dirigeants tel le Brésilien Jair Bolsonaro, est à l’avant-garde de cette « diplomatie de la colère », multipliant les accès furieux, notamment contre la Chine tenue seule responsable de cette situation. Son populisme acariâtre s’appuie sur un leadership aujourd’hui lourdement contesté mais qui continue de se présenter comme la seule alternative aux partis traditionnels. Trump procède par messages simplistes en prétendant s’adresser à la majorité des mécontents et des oubliés. Avec le coronavirus, l’hôte de la Maison Blanche n’a fait qu’accentuer cette manipulation de la colère des Américains face aux crises domestiques et étrangères essuyées à répétition. Prêt pour un second mandat, Trump a exploité la colère à son profit et l’a fortifiée par une rhétorique incendiaire et acrimonieuse (6). Relevons que la nébuleuse médiatique, en quête permanente de conflits et scandales, sert paradoxalement de caisse de résonance à cette hargne.
Expressions publiques de déplaisir face aux accusations de Washington, actions punitives sur un certain nombre de dossiers, menaces d’autres dangers à venir, dénégations et inculpations, attaques personnelles contre des diplomates, scientifiques, militants et journalistes : la Chine n’est pas en reste dans ce concert colérique (7). Clairement, Pékin profite de la pandémie pour accroître sa marge de manœuvre économique, promouvoir ses intérêts et affirmer sa primauté géopolitique. Dès 2004, le ministère des Affaires étrangères chinois créait un département de diplomatie publique doté d’une kyrielle d’instruments (médias, réseaux sociaux) et d’acteurs pour véhiculer les positions du parti et glorifier l’image du pays contre ses opposants. Dans le conflit multidimensionnel qui l’oppose aux États-Unis, sur fond de guerre commerciale, Pékin a radicalisé sa posture, qualifiant ses ennemis tantôt de « combattants de la Guerre froide », tantôt de « voyous » (8).
Donald Trump, à l’instar d’autres dirigeants tel le Brésilien Jair Bolsonaro, est à l’avant-garde de cette « diplomatie de la colère », multipliant les accès furieux, notamment contre la Chine tenue seule responsable de cette situation. Son populisme acariâtre s’appuie sur un leadership aujourd’hui lourdement contesté mais qui continue de se présenter comme la seule alternative aux partis traditionnels. Trump procède par messages simplistes en prétendant s’adresser à la majorité des mécontents et des oubliés. Avec le coronavirus, l’hôte de la Maison Blanche n’a fait qu’accentuer cette manipulation de la colère des Américains face aux crises domestiques et étrangères essuyées à répétition. Prêt pour un second mandat, Trump a exploité la colère à son profit et l’a fortifiée par une rhétorique incendiaire et acrimonieuse (6). Relevons que la nébuleuse médiatique, en quête permanente de conflits et scandales, sert paradoxalement de caisse de résonance à cette hargne.
Expressions publiques de déplaisir face aux accusations de Washington, actions punitives sur un certain nombre de dossiers, menaces d’autres dangers à venir, dénégations et inculpations, attaques personnelles contre des diplomates, scientifiques, militants et journalistes : la Chine n’est pas en reste dans ce concert colérique (7). Clairement, Pékin profite de la pandémie pour accroître sa marge de manœuvre économique, promouvoir ses intérêts et affirmer sa primauté géopolitique. Dès 2004, le ministère des Affaires étrangères chinois créait un département de diplomatie publique doté d’une kyrielle d’instruments (médias, réseaux sociaux) et d’acteurs pour véhiculer les positions du parti et glorifier l’image du pays contre ses opposants. Dans le conflit multidimensionnel qui l’oppose aux États-Unis, sur fond de guerre commerciale, Pékin a radicalisé sa posture, qualifiant ses ennemis tantôt de « combattants de la Guerre froide », tantôt de « voyous » (8).
Entre abandon du multilatéralisme et ressentiments populaires
Au-delà des États, la pandémie fait écho à la crise historique des institutions multilatérales nées de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des organisations comme l’OMS font l’objet de critiques encore jamais vues (9). Une approche individualiste et unilatérale suivant l’adage « Notre pays avant tout » semble avoir pris le pas à l’échelle planétaire, encouragée par des gouvernements qui n’hésitent pas à rejeter leurs fautes et leurs responsabilités sur le reste du monde en lieu et place de les assumer. Donald Trump est l’emblème par excellence de cette dynamique qui entame les fondations d’une coopération internationale sur le coronavirus et bien d’autres thèmes (10). Les menaces contre le système multilatéral sont toutes sérieuses et participent d’un vaste climat de colère parmi les opinions publiques. Des pays en situation de sous-développement perçoivent enfin d’un mauvais œil les évolutions actuelles, en particulier ceux devant faire face à la guerre et à l’urgence humanitaire
Aux quatre coins du globe, la crise exaspère l’indignation des populations, affect étroitement associé à la colère (11) et qui n’est que la réponse douloureuse et sans doute inévitable aux rebondissements dramatiques éprouvés par beaucoup. Appréhendée au prisme de la colère, l’indignation est une passion omniprésente dans la géopolitique ; c’est elle qui ancre l’action de nombreux mouvements sociaux (12) et se veut une réplique aux résultats délétères et aux dérives d’une économie de marché mondialisée dont la pandémie est venue révéler l’ampleur (chômage, inégalités de revenus, d’opportunités…). Les révoltes de l’année 2019 qui avaient précédé le COVID-19 démontrèrent la réalité de cette « bile ». Les protestations violentes se multiplièrent partout alors, du Soudan à l’Algérie, en passant par l’Égypte, le Liban et l’Irak, pour ce qui est du monde arabo-musulman, de même qu’à Hong Kong où l’onde de colère fut initialement le fruit d’un projet de loi autorisant des extraditions vers la Chine continentale et qui culmina ensuite dans une répression aveugle et extrême, et dans le passage d’une loi sur la sécurité nationale remettant en question l’autonomie de l’ancienne colonie britannique (13). Autrement dit, le coronavirus n’a fait que prolonger et approfondir des impasses sociétales et politiques sans issue.
De la Syrie au Sahel, du Yémen à la Libye, au conflit israélo-palestinien ou au Vénézuela, la colère se situe enfin au cœur de la compréhension d’une large gamme de conflits armés. Les uns sont héréditaires, les autres récents, mais tous illustrent quel peut être le pouvoir ravageur de cette émotion quant aux modalités de déclenchement et d’entretien de la violence (14). Il est rare, en effet, que la colère façonne des comportements tournés vers la négociation, la coopération et la conciliation ; en règle générale, elle entretient davantage les malentendus et les antagonismes entre groupes et communautés, conduisant à tous types de provocations et d’agressions au long cours. Le coronavirus est clairement venu durcir ces tendances.
Aux quatre coins du globe, la crise exaspère l’indignation des populations, affect étroitement associé à la colère (11) et qui n’est que la réponse douloureuse et sans doute inévitable aux rebondissements dramatiques éprouvés par beaucoup. Appréhendée au prisme de la colère, l’indignation est une passion omniprésente dans la géopolitique ; c’est elle qui ancre l’action de nombreux mouvements sociaux (12) et se veut une réplique aux résultats délétères et aux dérives d’une économie de marché mondialisée dont la pandémie est venue révéler l’ampleur (chômage, inégalités de revenus, d’opportunités…). Les révoltes de l’année 2019 qui avaient précédé le COVID-19 démontrèrent la réalité de cette « bile ». Les protestations violentes se multiplièrent partout alors, du Soudan à l’Algérie, en passant par l’Égypte, le Liban et l’Irak, pour ce qui est du monde arabo-musulman, de même qu’à Hong Kong où l’onde de colère fut initialement le fruit d’un projet de loi autorisant des extraditions vers la Chine continentale et qui culmina ensuite dans une répression aveugle et extrême, et dans le passage d’une loi sur la sécurité nationale remettant en question l’autonomie de l’ancienne colonie britannique (13). Autrement dit, le coronavirus n’a fait que prolonger et approfondir des impasses sociétales et politiques sans issue.
De la Syrie au Sahel, du Yémen à la Libye, au conflit israélo-palestinien ou au Vénézuela, la colère se situe enfin au cœur de la compréhension d’une large gamme de conflits armés. Les uns sont héréditaires, les autres récents, mais tous illustrent quel peut être le pouvoir ravageur de cette émotion quant aux modalités de déclenchement et d’entretien de la violence (14). Il est rare, en effet, que la colère façonne des comportements tournés vers la négociation, la coopération et la conciliation ; en règle générale, elle entretient davantage les malentendus et les antagonismes entre groupes et communautés, conduisant à tous types de provocations et d’agressions au long cours. Le coronavirus est clairement venu durcir ces tendances.
En guise de conclusion…
Depuis les débuts de la crise sanitaire, la colère inonde la géopolitique mondiale. Il est acquis, de ce point de vue, qu’elle n’est plus ce grand refoulé d’antan mais, au contraire, un sentiment pleinement évacué, assumé et qui brise le statu quo. Le défi consiste ici à s’interroger sur son devenir : n’est-elle que passagère ou appelée à s’étendre ? Après tout, les siècles passés furent emplis de cycles rageurs, lesquels plongeaient déjà leurs racines dans l’oubli de catastrophes antérieures. Comme le fait remarquer la philosophe américaine Martha Nussbaum, c’est d’une transition de ce « régime global de colère » vers une pensée plus soucieuse de bienveillance, d’équité, de justice, de générosité mais aussi de pardon dont la globalisation a le plus besoin (15). Or, ceci suppose une prise de conscience parmi les États, les sociétés et les citoyens, qui n’est pas encore survenue et dépendra des rééquilibrages effectués et des décisions prises dans les mois et les années à venir.
Bibliographie
(1) De l’auteure, Géopolitique de la colère. De la globalisation heureuse au grand courroux, Paris, Le Cavalier Bleu, 2020.
(2) Chris Buckley et Amy Qin, « Coronavirus Anger Boils Over in China and Doctors Plead for Supplies », The New York Times, 30 janvier 2020.
(3) Matthieu Goar, « Coronavirus : la défiance et la colère envers la gestion du gouvernement s’installent », Le Monde, 21 avril 2020.
(4) Colin H. Kahl et Ariana Berengaut, « Aftershocks: The Coronavirus Pandemic and the New World Disorder », War on the Rocks, 10 avril 2020.
(5) Todd H. Hall, « We Will Not Swallow This Bitter Fruit: Theorizing a Diplomacy of Anger », Security Studies, vol. 20, n° 4, 2011, pp. 521-555.
(6) Mary E. Stucker, « American Elections and the Rhetoric of Political Change: Hyperbole, Anger, and Hope in U.S. Politics », Rhetoric & Public Affairs, vol. 20, n° 4, 2017, pp. 667-694.
(7) Sabine Oelze, « China angry over coronavirus cartoon in Danish newspaper », Deutsche Welle, 30 janvier 2020.
(8) Ben Blanchard, « China turns its anger on ‘Cold War warrior’ Pompeo », Reuters, 14 juin 2019.
(9) Michael Peel, Anna Gross et Clive Cookson, « WHO struggles to prove itself in the face of Covid-19 », Financial Times, 11 juillet 2020.
(10) « Coronavirus : Donald Trump est ‘de plus en plus en colère’ contre la Chine», La Dépêche/AFP, 1er juillet 2020.
(11) Pierre Zaoui, « Colère et indignation », Vacarme, vol. 37, n° 4, 2006, pp. 66-68.
(12) James Jasper, « Constructing Indignation: Anger Dynamics in Protest Movements », Emotion Review, vol. 6, n° 3, 2014, pp. 208-213.
(13) Martine Bulard, « Colère à Hongkong, poudrière géopolitique », Le Monde diplomatique, septembre 2019.
(14) ByIsaura Manso Neto et Mario David, « Dealing with Conflicts, Rage, Anger, and Aggression in Group Analysis », in Gila Ofer (dir.), A Bridge Over Troubled Water: Conflicts and Reconciliation in Groups and Society, Karnac Books, 2017.
(15) Martha Nussbaum, Anger and Forgiveness: Resentment, Generosity, Justice, New York/Oxford, Presses universitaires d’Oxford, 2016.
(2) Chris Buckley et Amy Qin, « Coronavirus Anger Boils Over in China and Doctors Plead for Supplies », The New York Times, 30 janvier 2020.
(3) Matthieu Goar, « Coronavirus : la défiance et la colère envers la gestion du gouvernement s’installent », Le Monde, 21 avril 2020.
(4) Colin H. Kahl et Ariana Berengaut, « Aftershocks: The Coronavirus Pandemic and the New World Disorder », War on the Rocks, 10 avril 2020.
(5) Todd H. Hall, « We Will Not Swallow This Bitter Fruit: Theorizing a Diplomacy of Anger », Security Studies, vol. 20, n° 4, 2011, pp. 521-555.
(6) Mary E. Stucker, « American Elections and the Rhetoric of Political Change: Hyperbole, Anger, and Hope in U.S. Politics », Rhetoric & Public Affairs, vol. 20, n° 4, 2017, pp. 667-694.
(7) Sabine Oelze, « China angry over coronavirus cartoon in Danish newspaper », Deutsche Welle, 30 janvier 2020.
(8) Ben Blanchard, « China turns its anger on ‘Cold War warrior’ Pompeo », Reuters, 14 juin 2019.
(9) Michael Peel, Anna Gross et Clive Cookson, « WHO struggles to prove itself in the face of Covid-19 », Financial Times, 11 juillet 2020.
(10) « Coronavirus : Donald Trump est ‘de plus en plus en colère’ contre la Chine», La Dépêche/AFP, 1er juillet 2020.
(11) Pierre Zaoui, « Colère et indignation », Vacarme, vol. 37, n° 4, 2006, pp. 66-68.
(12) James Jasper, « Constructing Indignation: Anger Dynamics in Protest Movements », Emotion Review, vol. 6, n° 3, 2014, pp. 208-213.
(13) Martine Bulard, « Colère à Hongkong, poudrière géopolitique », Le Monde diplomatique, septembre 2019.
(14) ByIsaura Manso Neto et Mario David, « Dealing with Conflicts, Rage, Anger, and Aggression in Group Analysis », in Gila Ofer (dir.), A Bridge Over Troubled Water: Conflicts and Reconciliation in Groups and Society, Karnac Books, 2017.
(15) Martha Nussbaum, Anger and Forgiveness: Resentment, Generosity, Justice, New York/Oxford, Presses universitaires d’Oxford, 2016.