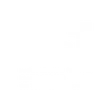Coronavirus et migrations
11/09/2020

Le Coronavirus a fait environ 545 000 victimes (juillet 2020) dans le monde, dont près de 30 000 en France. Un chiffre important, sans doute sous-évalué, mais très inférieur aux grandes pandémies du passé. Comparé aux autres pandémies historiques, le bilan du nombre de morts est limité car la peste noire (40 millions de morts entre 1347 et 1352) et la grippe espagnole (50 millions entre 1918 et 1919) avaient fait beaucoup plus de victimes. Des écrivains, des philosophes, des géopoliticiens se sont essayé à en décrypter le sens, en appelant aux changements civilisationnels nécessaires pour conjurer la crise : en finir avec la course à la rentabilité dans l’immédiat, selon Edgar Morin, la paix avec la Terre pour Mireille Delmas-Marty, l’interdépendance humaine pour Enrico Letta, une histoire qui ne continuera pas comme avant, selon Etienne Balibar, une illustration de la fin de la toute-puissance de l’Occident et de la nécessité du multilatéralisme des prises de décision, selon Pascal Boniface.
De fait, le COVID 19 a eu peu d’impact sur les migrations au tout début de la crise, mais au fur et à mesure que celle-ci s’est déployée dans le monde, la pandémie a montré combien il pouvait être révélateur des interdépendances du monde. Ses conséquences humanitaires, économiques, politiques sont considérables, révélant la faiblesse du monde occidental et notamment de l’Europe face à des décisions prises unilatéralement par les Etats et l’interdépendance des économies, en même temps que la précarisation accrue des migrants à statuts précaires.
De fait, le COVID 19 a eu peu d’impact sur les migrations au tout début de la crise, mais au fur et à mesure que celle-ci s’est déployée dans le monde, la pandémie a montré combien il pouvait être révélateur des interdépendances du monde. Ses conséquences humanitaires, économiques, politiques sont considérables, révélant la faiblesse du monde occidental et notamment de l’Europe face à des décisions prises unilatéralement par les Etats et l’interdépendance des économies, en même temps que la précarisation accrue des migrants à statuts précaires.
Fermeture des frontières
En quelques semaines avant le confinement, des millions de personnes ont cherché à regagner leur région d’origine, comme en Inde, ou leur pays comme les Vénézuéliens réfugiés en Colombie ou encore les Ukrainiens travaillant en Pologne, d’autres ont quitté les villes comme Paris ou Milan. Des migrants se sont retrouvés sur les routes ou mis à la rue faute d’infrastructures d’accueil, d’autres ont cherché le rapatriement. En Inde, le COVID 19, mettant au chômage des centaines de milliers de travailleurs indiens dans le nord du pays s’est traduit par des migrations internes massives du nord au sud du pays chez les plus démunis, dans des conditions sanitaires parmi les plus précaires.
La fermeture des frontières nationales a été l’une des premières mesures adoptées par de nombreux pays européens pour limiter la propagation du coronavirus. D’autres pays ont ensuite emboîté le pas (aux Etats-Unis, en Asie, au Maghreb, en Afrique sub-saharienne, en Australie et dans le Golfe), révélant aux migrants du Nord que les frontières n’étaient plus ouvertes à tous et qu’ils devenaient indésirables au sud et aux migrants du sud qu’ils n’avaient plus rien à faire chez eux. Le 17 mars l’Union européenne a d’abord annoncé une fermeture des frontières extérieures pour une durée de 30 jours puis le 8 avril cette décision a été prolongée jusqu’au 15 mai. Plusieurs États européens avaient déjà commencé à fermer leurs frontières avec leurs voisins, suivis par les pays situés de l’autre côté de la Méditerranée (Maroc, Algérie, Tunisie). Le moment de leur réouverture s’étale dans le temps, d’abord avec la réouverture progressive des frontières internes dans l’Union européenne notamment dans les pays de tourisme (Italie, Espagne, Portugal, Grèce).
Pour les migrants extra-européens, l’Organisation mondiale des migrations (OIM) a observé une baisse importante du trafic en méditerranée centrale, de la Libye à l’Italie ou vers la Grèce, qui a repris depuis. L’Europe n’est plus devenue attractive pour les réfugiés ou les migrants économiques, du fait de la fermeture des frontières et des risques sanitaires puisque le continent a été particulièrement touché par la pandémie. L’Agence européenne aux frontières,Frontex, a arrêté 4 650 personnes au mois de mars, soit moitié moins que le mois précédent. Face à la fermeture des ports et la possibilité de rester bloqué durablement en mer, des navires humanitaires ont aussi été à l’arrêt, comme l’Ocean Viking, affrété par l’ONG SOS Méditerranée, immobilisé à Marseille depuis la mi-avril.
L’épidémie a suspendu les arrivées de migrants en Europe et leur circulation entre les pays membres qui ont fermé leurs portes. L’exercice du droit d’asile s’est arrêté avec la fermeture des guichets pour les demandeurs d’asile.
La nouvelle Commission européenne invite à reprendre les enregistrements et le traitement des demandes d’asile, les transferts de « dublinés » (renvoyés vers le premier européen où ils sont entrés en Europe) et les politiques de retour volontaires ou forcées.
Le confinement s’est aussi concrétisé au-delà des frontières de l’Europe, mettant en sourdine les diplomaties migratoires avec les pays tiers. Alors qu’à la veille du confinement, les projecteurs étaient portés sur la décision turque d’ouvrir ses frontières aux candidats à l’asile les invitant à se déplacer vers la frontière grecque, les autorités turques ont transféré environ 4 000 personnes à l’intérieur des frontières turques pour qu’elles restent en quarantaine, temporairement, le temps de l’épidémie.
Ailleurs comme en Libye, des migrants restent « confinés » dans les centres de rétention en attendant d’être reconduits dans leur pays d’origine. D’autres demeurent dans des centres d’accueil de demandeurs d’asile, à haute densité de population. Les plus précaires ont vu leur situation se dégrader face à la raréfaction des distributions alimentaires et des services de santé.
Au sud, le COVID s’est poursuivi de façon accélérée comme en Asie du sud qui compte le quart de la population mondiale (Inde, 4ème pays le plus touché au monde, Pakistan, Corée du sud, Singapour), mais aussi en Algérie, à Djibouti et en Arabie saoudite, révélant par là même la précarité des ouvriers étrangers ou des migrants internes. Dans les pays du Golfe, les travailleurs privés d’emploi se sont retrouvés bloqués sans pouvoir retourner chez eux ou expulsés comme en Arabie saoudite.
En Afrique, moins touchée que ne l’avaient prévu les prospectives, .des milliers de réfugiés et de migrants en mouvement entre l’Afrique de l’ouest et de l’est et les côtes africaines de la méditerranée se sont remis en mouvement à l’été 2020, endurant d’extrêmes violences en Libye notamment. avec 30% de morts selon le HCR (Haut Commissariat aux réfugiés).
La fermeture des frontières nationales a été l’une des premières mesures adoptées par de nombreux pays européens pour limiter la propagation du coronavirus. D’autres pays ont ensuite emboîté le pas (aux Etats-Unis, en Asie, au Maghreb, en Afrique sub-saharienne, en Australie et dans le Golfe), révélant aux migrants du Nord que les frontières n’étaient plus ouvertes à tous et qu’ils devenaient indésirables au sud et aux migrants du sud qu’ils n’avaient plus rien à faire chez eux. Le 17 mars l’Union européenne a d’abord annoncé une fermeture des frontières extérieures pour une durée de 30 jours puis le 8 avril cette décision a été prolongée jusqu’au 15 mai. Plusieurs États européens avaient déjà commencé à fermer leurs frontières avec leurs voisins, suivis par les pays situés de l’autre côté de la Méditerranée (Maroc, Algérie, Tunisie). Le moment de leur réouverture s’étale dans le temps, d’abord avec la réouverture progressive des frontières internes dans l’Union européenne notamment dans les pays de tourisme (Italie, Espagne, Portugal, Grèce).
Pour les migrants extra-européens, l’Organisation mondiale des migrations (OIM) a observé une baisse importante du trafic en méditerranée centrale, de la Libye à l’Italie ou vers la Grèce, qui a repris depuis. L’Europe n’est plus devenue attractive pour les réfugiés ou les migrants économiques, du fait de la fermeture des frontières et des risques sanitaires puisque le continent a été particulièrement touché par la pandémie. L’Agence européenne aux frontières,Frontex, a arrêté 4 650 personnes au mois de mars, soit moitié moins que le mois précédent. Face à la fermeture des ports et la possibilité de rester bloqué durablement en mer, des navires humanitaires ont aussi été à l’arrêt, comme l’Ocean Viking, affrété par l’ONG SOS Méditerranée, immobilisé à Marseille depuis la mi-avril.
L’épidémie a suspendu les arrivées de migrants en Europe et leur circulation entre les pays membres qui ont fermé leurs portes. L’exercice du droit d’asile s’est arrêté avec la fermeture des guichets pour les demandeurs d’asile.
La nouvelle Commission européenne invite à reprendre les enregistrements et le traitement des demandes d’asile, les transferts de « dublinés » (renvoyés vers le premier européen où ils sont entrés en Europe) et les politiques de retour volontaires ou forcées.
Le confinement s’est aussi concrétisé au-delà des frontières de l’Europe, mettant en sourdine les diplomaties migratoires avec les pays tiers. Alors qu’à la veille du confinement, les projecteurs étaient portés sur la décision turque d’ouvrir ses frontières aux candidats à l’asile les invitant à se déplacer vers la frontière grecque, les autorités turques ont transféré environ 4 000 personnes à l’intérieur des frontières turques pour qu’elles restent en quarantaine, temporairement, le temps de l’épidémie.
Ailleurs comme en Libye, des migrants restent « confinés » dans les centres de rétention en attendant d’être reconduits dans leur pays d’origine. D’autres demeurent dans des centres d’accueil de demandeurs d’asile, à haute densité de population. Les plus précaires ont vu leur situation se dégrader face à la raréfaction des distributions alimentaires et des services de santé.
Au sud, le COVID s’est poursuivi de façon accélérée comme en Asie du sud qui compte le quart de la population mondiale (Inde, 4ème pays le plus touché au monde, Pakistan, Corée du sud, Singapour), mais aussi en Algérie, à Djibouti et en Arabie saoudite, révélant par là même la précarité des ouvriers étrangers ou des migrants internes. Dans les pays du Golfe, les travailleurs privés d’emploi se sont retrouvés bloqués sans pouvoir retourner chez eux ou expulsés comme en Arabie saoudite.
En Afrique, moins touchée que ne l’avaient prévu les prospectives, .des milliers de réfugiés et de migrants en mouvement entre l’Afrique de l’ouest et de l’est et les côtes africaines de la méditerranée se sont remis en mouvement à l’été 2020, endurant d’extrêmes violences en Libye notamment. avec 30% de morts selon le HCR (Haut Commissariat aux réfugiés).
Perspicace des besoins structurels de main d'œuvre
Mais ce que la crise a surtout révélé, c’est la dépendance des pays d’immigration à l’égard de leur main d’œuvre immigrée, qui a parfois de son côté connu une perte d’emploi du fait du ralentissement de l’économie. Les partisans de la fermeture totale des frontières, bien avant le Coronavirus ont vu sous leurs yeux s’effectuer ce dont ils avaient longtemps rêvé : la clôture face aux étrangers. Mais très vite l’absence d’alternative à l’immigration s’est fait sentir. Le contraste observé tranche avec la doxa de la fermeture : la Hongrie a ainsi interdit à tous les étrangers à la mi-mars d’entrer sur son territoire. Mais l’Italie et le Portugal ont décidé de régulariser les sans papiers travaillant dans les métiers des soins à la personne (métiers du « care ») compte tenu des besoins dans ce secteur. En Allemagne, la pénurie de travailleurs saisonniers agricoles s’est fait sentir, notamment pour les récoltes saisonnières de printemps (asperges) habituellement effectuées par des travailleurs de l’est (Ukrainiens) et les saisonniers roumains ont vite repris, à la mi-avril, les chemins des champs allemands. De même en Autriche où les Roumaines s’occupant des personnes âgées ont pu revenir par petits contingents, accueillies à bras ouvert par les Viennois en manque de personnel. En Espagne, les ramasseuses de fraises marocaines se sont heurtées au blocage des frontières, mettant en péril leurs revenus pour la famille au Maroc, en proie à la sécheresse et à la baisse de l’emploi agricole, face à une faible substitution de ces tâches par des travailleurs espagnols. En Italie, les saisonniers marocains n’ont pu revenir qu’au compte-goutte, comme au Royaume Uni où les Roumains sont revenus travailler dans les champs, alors que la concurrence avec les Européens était l’un des thèmes favoris du Brexit.
L'Asile en suspens, le tourisme en berne
En Europe, le confinement a également limité le traitement des demandes d’asile ou l’a même parfois stoppé, les centres d’accueil ont parfois été vidés comme dans certaines villes en Autriche, les centres de rétention ont cessé de renvoyer chez eux ceux les migrants en situation irrégulière, les camps de réfugiés en Grèce où les conditions de promiscuité et d’hygiène sont souvent dénoncées, ont été parfois été mis en quarantaine.
Même si les touristes ne sont pas des migrants à proprement parler, les formes de mobilité à des fins de loisirs de courte durée (tourisme et pèlerinages) ont aussi marqué le pas. Des villes comme Venise, Rome, Paris ont vu leur chiffre d’affaires tomber dans ce secteur.
Même si les touristes ne sont pas des migrants à proprement parler, les formes de mobilité à des fins de loisirs de courte durée (tourisme et pèlerinages) ont aussi marqué le pas. Des villes comme Venise, Rome, Paris ont vu leur chiffre d’affaires tomber dans ce secteur.
A l'échelle mondiale, baisse des transferts de fonds
Ailleurs dans le monde, le COVID 19, en diminuant les flux, a eu pour effet de diminuer le montant des transferts de fonds vers les pays d’origine. Ils représentaient, en 2019, 530 milliards de dollars annuels. Même si les chiffres de 2020 ne seront connus qu’à la fin de l’année, une réduction des transferts de fonds a été observée de 2, 6% en Avril 2020 entre les Etats-Unis et le Mexique, région où ils sont parmi les plus élevés et une baisse de 20% est prévue selon la Banque mondiale en 2020 dans le monde, aggravant ainsi la crise économique dans les pays les plus pauvres dépendants de ces transferts.
Conclusion
Le COVID 19 n’a pas sonné la fin des migrations, mais il a accéléré les migrations internes de retour vers les régions d’origine, a renforcé les inégalités sociales et géopolitiques (métiers précaires, habitants des banlieues pauvres difficilement assignés à résidence dans des logements étroits et parfois surpeuplés, surmortalité des minorités ethniques comme au Royaume Uni et situation critique en Guyane) et a montré l’interdépendance structurelle des pays riches à l’égard des pays pauvres au lieu de faire la démonstration de l’autosuffisance à l’intérieur de frontières fermées. Les Européens ont aussi découvert qu’ils étaient devenus indésirables dans des régions du monde où ils circulaient hier librement.