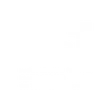Éthique et relations internationales : l’avènement de la « cosm-éthique »
28/06/2019

Éthique[1] et relations internationales[2] : l’avènement de la « cosm-éthique »
Par Emmanuel R. Goffi, analyste en sécurité et défense, chercheur à l’Université de Manitoba, professeur à l’ILERI.
Avec presque 71 millions de déplacés en 2018 ; 736 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvrete ; 153 millions de personnes menacées par une montée des eaux de 2 m à l’horizon 2100 ;
plus de 77 000 morts dans 162 conflits en 2018, 52 régimes autoritaires sur 167 pays, des inégalités qui se creusent inexorablement, les violations continues des droits humains, ou encore la déforestation massive, l’éthique ne semble pas être au cœur des relations internationales. Pourtant, l’éthique est omniprésente dans les discours, les déclarations, les rapports, les réflexions ou encore les écrits universitaires[1].
De manière logique, le sentiment d’un défaut d’éthique sur la scène internationale entraîne une demande d’éthique qui elle-même résulte en une production pléthorique sur le sujet et une surutilisation de la notion. En tout état de cause, l’éthique fait désormais partie des champs de réflexion sur les relations internationales et il est impossible de ne pas s’y confronter.
Cependant, un constat s’impose : les débats éthiques sont bien souvent éloignés de leur base philosophique. Employée à des fins communicationnelles, instrumentalisée tant pour justifier et légitimer que pour condamner et décrédibiliser toutes sortes d’actions, convoquée parfois sans raison et souvent de manière inadaptée ou manipulée à des fins politiques, l’éthique fait l’objet d’une exploitation exagérée qui affaiblit sa portée analytique. Souvent approchée au travers d’une déontologie low cost[3] pour en exploiter la dimension normative, elle est vidée de sa substance.
En relations internationales (RI) comme dans d’autres domaines, l’éthique est approchée de manière superficielle et souvent peu originale. Les a priori sur les liens entretenus entre les grandes théories des RI et l’éthique en témoignent. L’immoralisme, voire l’amoralisme, des réalistes, l’universalisme du libéralisme ou l’agnosticisme éthique des constructivistes, sont désormais considérés comme acquis. Mais avant de nous intéresser à ces trois perspectives, il semble important de se pencher sur les relations entre éthique et RI.
Par Emmanuel R. Goffi, analyste en sécurité et défense, chercheur à l’Université de Manitoba, professeur à l’ILERI.
Avec presque 71 millions de déplacés en 2018 ; 736 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvrete ; 153 millions de personnes menacées par une montée des eaux de 2 m à l’horizon 2100 ;
plus de 77 000 morts dans 162 conflits en 2018, 52 régimes autoritaires sur 167 pays, des inégalités qui se creusent inexorablement, les violations continues des droits humains, ou encore la déforestation massive, l’éthique ne semble pas être au cœur des relations internationales. Pourtant, l’éthique est omniprésente dans les discours, les déclarations, les rapports, les réflexions ou encore les écrits universitaires[1].
De manière logique, le sentiment d’un défaut d’éthique sur la scène internationale entraîne une demande d’éthique qui elle-même résulte en une production pléthorique sur le sujet et une surutilisation de la notion. En tout état de cause, l’éthique fait désormais partie des champs de réflexion sur les relations internationales et il est impossible de ne pas s’y confronter.
Cependant, un constat s’impose : les débats éthiques sont bien souvent éloignés de leur base philosophique. Employée à des fins communicationnelles, instrumentalisée tant pour justifier et légitimer que pour condamner et décrédibiliser toutes sortes d’actions, convoquée parfois sans raison et souvent de manière inadaptée ou manipulée à des fins politiques, l’éthique fait l’objet d’une exploitation exagérée qui affaiblit sa portée analytique. Souvent approchée au travers d’une déontologie low cost[3] pour en exploiter la dimension normative, elle est vidée de sa substance.
En relations internationales (RI) comme dans d’autres domaines, l’éthique est approchée de manière superficielle et souvent peu originale. Les a priori sur les liens entretenus entre les grandes théories des RI et l’éthique en témoignent. L’immoralisme, voire l’amoralisme, des réalistes, l’universalisme du libéralisme ou l’agnosticisme éthique des constructivistes, sont désormais considérés comme acquis. Mais avant de nous intéresser à ces trois perspectives, il semble important de se pencher sur les relations entre éthique et RI.
Ethique et relations internationales : un mariage improbable ?
Comme le souligne Ariel Colonomos, « [l]a science politique, la discipline qui le plus directement traite des relations internationales, entretient, dès son origine, une relation complexe avec la question éthique »[4]. Complexe du fait d’abord des différences d’orientations des deux domaines : si l’éthique est prescriptive, les théories des RI sont interprétatives au nom de la séparation invoquée par Max Weber entre faits et valeurs, et du besoin de neutralité axiologique du savant. Complexe ensuite du fait de la subjectivité des points de vue. Le débat entre universalistes et particularistes (également appelés relativistes) illustre la difficulté à trouver un terrain d’entente sur l’application de règles éthiques sur la scène internationale. Fort pertinemment, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer et Roya Chung soulignent que « [l]’éthique des relations internationales n’est pas un ensemble de règles, un code sur lequel tout le monde serait d’accord » mais plutôt « le lieu d’un débat entre des traditions philosophiques différentes, des valeurs morales opposées, qui s’affrontent sur des questions pratiques »[5].
Complexe, enfin, parce que l’éthique relève de la philosophie, ce qui lui donne une dimension parfois absconse, souvent éthérée et donc délicate à appréhender dans sa complexité. Ce point est essentiel pour quiconque prétend réfléchir sérieusement au sujet, et, si nous adhérons à l’affirmation de l’importance de l’interdisciplinarité en matière d’éthique appliquée aux RI[6], il nous parait essentiel de se prémunir contre toute tentation d’abandonner sa dimension philosophique au motif de sa nature trop théorique et abstraite. Si les « intolérances disciplinaires » et la recherche d’une « « pureté » disciplinaire » sont effectivement contreproductifs[7], le glissement de l’éthique du champ philosophique au champ purement politique ne l’est pas moins.
Ainsi, « [a] priori, tout sépare l’éthique des théories des relations internationales »[8]. Pourtant, force est de constater que « [l]a tendance est à la moralisation des relations internationales »[9]. Indépendamment de toute considération sur la sincérité des acteurs revendiquant la moralité de leurs actions, il est clair que la morale est largement convoquée en relations internationales. La volonté de se doter d’une réputation pour asseoir sa légitimité est désormais inséparable de revendications visant à affirmer son attachement à un système de valeurs morales ayant pour but de rendre acceptables les décisions prises et les actions menées. L’image, on le sait notamment grâce aux travaux des constructivistes[10], est un élément clé des relations entre acteurs sur la scène internationale.Il ne s’agit ici pas uniquement des relations entre États. L’image, qui renvoie aux questions entourant les perceptions[11], concerne également les relations entre tous les types d’acteurs, société civile, organisations gouvernementales et non-gouvernementales, médias, individus ou groupes d’individus. L’image conditionne la nature des rapports entretenus et leur qualité.
Elle repose sur des constats mais aussi sur des perceptions et des interprétations, justes ou erronées[12]. Or, nous disent Berger et Luckmann, le langage est le principal vecteur permettant de partager et transmettre des schémas de pensée qui se routinisent puis s’institutionnalisent. Le discours est ainsi l’un des outils permettant la « construction sociale de la réalité »[13]. En l’occurrence, le discours éthique est indiscutablement un facteur contribuant à modeler les perceptions sur certaines pratiques, sur la qualité des relations entre acteurs ou encore sur leurs légitimités et respectabilités respectives.
De fait, l’éthique est bel et bien présente dans le champ des relations internationales. Pour autant, elle doit être appréhendée dans sa multiplicité et son extrême complexité, et non au travers d’appréciations étroites et réductrices.
Complexe, enfin, parce que l’éthique relève de la philosophie, ce qui lui donne une dimension parfois absconse, souvent éthérée et donc délicate à appréhender dans sa complexité. Ce point est essentiel pour quiconque prétend réfléchir sérieusement au sujet, et, si nous adhérons à l’affirmation de l’importance de l’interdisciplinarité en matière d’éthique appliquée aux RI[6], il nous parait essentiel de se prémunir contre toute tentation d’abandonner sa dimension philosophique au motif de sa nature trop théorique et abstraite. Si les « intolérances disciplinaires » et la recherche d’une « « pureté » disciplinaire » sont effectivement contreproductifs[7], le glissement de l’éthique du champ philosophique au champ purement politique ne l’est pas moins.
Ainsi, « [a] priori, tout sépare l’éthique des théories des relations internationales »[8]. Pourtant, force est de constater que « [l]a tendance est à la moralisation des relations internationales »[9]. Indépendamment de toute considération sur la sincérité des acteurs revendiquant la moralité de leurs actions, il est clair que la morale est largement convoquée en relations internationales. La volonté de se doter d’une réputation pour asseoir sa légitimité est désormais inséparable de revendications visant à affirmer son attachement à un système de valeurs morales ayant pour but de rendre acceptables les décisions prises et les actions menées. L’image, on le sait notamment grâce aux travaux des constructivistes[10], est un élément clé des relations entre acteurs sur la scène internationale.Il ne s’agit ici pas uniquement des relations entre États. L’image, qui renvoie aux questions entourant les perceptions[11], concerne également les relations entre tous les types d’acteurs, société civile, organisations gouvernementales et non-gouvernementales, médias, individus ou groupes d’individus. L’image conditionne la nature des rapports entretenus et leur qualité.
Elle repose sur des constats mais aussi sur des perceptions et des interprétations, justes ou erronées[12]. Or, nous disent Berger et Luckmann, le langage est le principal vecteur permettant de partager et transmettre des schémas de pensée qui se routinisent puis s’institutionnalisent. Le discours est ainsi l’un des outils permettant la « construction sociale de la réalité »[13]. En l’occurrence, le discours éthique est indiscutablement un facteur contribuant à modeler les perceptions sur certaines pratiques, sur la qualité des relations entre acteurs ou encore sur leurs légitimités et respectabilités respectives.
De fait, l’éthique est bel et bien présente dans le champ des relations internationales. Pour autant, elle doit être appréhendée dans sa multiplicité et son extrême complexité, et non au travers d’appréciations étroites et réductrices.
Une Éthique ou des Éthiques
L’éthique est une branche de la philosophie englobant de nombreuses perspectives déclinables à l’infini. Que ce soit au travers des théories morales, des sujets traités ou des époques ou des lieux, des convictions religieuses et/ou philosophiques, l’éthique est sujette à interprétations. En la matière, le débat entre universalistes et particularistes est houleux. Pour les premiers, il serait possible de fonder une morale universellement partagée au motif de l’existence de valeurs elles-mêmes partagées. Cette perspective repose d’ailleurs sur un postulat cosmopolite envisageant l’humain dans son unicité plutôt que dans sa diversité. Pour les seconds, l’éthique est spécifique et contextuelle, attachée à une culture. Ainsi, l’universalisme des uns s’oppose au relativisme des autres. Si l’universalisme s’accompagne de la volonté d’imposer arbitrairement un modèle, le pluralisme suppose l’acceptation de toutes les formes de morales. Mais les deux approches ont en commun de poser de nombreux défis moraux.
Cela étant dit, la déclinaison de l’éthique en trois branches que sont la vertu[14], la déontologie[15] et le conséquentialisme[16], invite naturellement à penser la nuance plutôt que l’homogénéité, même s’il faut admettre que ces trois approches ont en commun d’être téléologiques.
En tout état de cause, il existe différentes appréciations de l’éthique, à la fois au sein même des trois théories, mais également au-delà avec d’autre approches telles que l’éthique de la sollicitude (également appelée éthique du care) de Carol Gilligan[17] ou de Virginia Held[18] ou l’éthique de la responsabilité de Hans Jonas[19], voire de Max Weber dans Le savant et le politique. Au sein même de ces perspectives, les désaccords sont nombreux comme dans le cas du principe conséquentialiste de maximisation du bonheur pour lequel une divergence se fait jour entre Jeremy Bentham qui favorise une approche quantitative du bonheur, alors que John Stuart Mill lui préfère une approche qualitative.
En matière de relations internationales, le sujet se complexifie par l’ajout de théories ou de courants spécifiques au domaine. Ainsi l’articulation entre les différentes orientations morales et le réalisme, le libéralisme ou encore le constructivisme, ajoute un degré de difficulté.
Cela étant dit, la déclinaison de l’éthique en trois branches que sont la vertu[14], la déontologie[15] et le conséquentialisme[16], invite naturellement à penser la nuance plutôt que l’homogénéité, même s’il faut admettre que ces trois approches ont en commun d’être téléologiques.
En tout état de cause, il existe différentes appréciations de l’éthique, à la fois au sein même des trois théories, mais également au-delà avec d’autre approches telles que l’éthique de la sollicitude (également appelée éthique du care) de Carol Gilligan[17] ou de Virginia Held[18] ou l’éthique de la responsabilité de Hans Jonas[19], voire de Max Weber dans Le savant et le politique. Au sein même de ces perspectives, les désaccords sont nombreux comme dans le cas du principe conséquentialiste de maximisation du bonheur pour lequel une divergence se fait jour entre Jeremy Bentham qui favorise une approche quantitative du bonheur, alors que John Stuart Mill lui préfère une approche qualitative.
En matière de relations internationales, le sujet se complexifie par l’ajout de théories ou de courants spécifiques au domaine. Ainsi l’articulation entre les différentes orientations morales et le réalisme, le libéralisme ou encore le constructivisme, ajoute un degré de difficulté.
Le réalisme : un anti-moralisme ?
L’essentiel de la réflexion éthique du réalisme repose sur une ontologie considérant que l’homme est belliqueux par nature, et que dans l’État de nature, que Hobbes définit comme la situation marquée par l’absence de loi et dans laquelle les « notions de bien et de mal, de justice et d’injustice n’ont aucune place », règne « la crainte permanente, et le danger de mort violente »[20]. Partant, les réalistes postulent l’immoralité des RI et « la maximisation égoïste de l’intérêt »[21]. Pourtant, cette approche relève de l’éthique attendu que l’égoïsme est lui-même une sous-branche de l’éthique conséquentialiste visant la maximisation des intérêts spécifiques de l’agent concerné[22].
Loin de la séparation traditionnelle entre éthique et réalisme, il apparait donc que ce dernier est porteur d’une vision éthique. Par ailleurs, il faut souligner que les réalistes ne s’opposent pas à l’idée de l’existence d’une dimension éthique dans les RI et admettent la présence de forces normatives. Aucune approche ou pensée « ne saurait être neutre sur le plan des valeurs et des préférences »[23]. Hans Morgenthau, réaliste et lecteur d’Aristote, accordait ainsi une grande importance à la prudence l’une des vertus cardinales aristotéliciennes. Il est même légitime de considérer que le réalisme adopte une position axiologique conséquentialiste, la fin justifiant les moyens, à laquelle s’ajoute une éthique de responsabilité politique tournée vers des intérêts nationaux. Considérant le monde comme anarchique (état de nature) ils adoptent une position morale focalisée sur l’intérêt égoïste et la survie. Refusant l’universalisme des valeurs et donc de la morale, ils adoptent également une position relativiste qui peut conduire à l’acceptation de tous système éthique et donc de pratiques plus que discutables.
Loin de la séparation traditionnelle entre éthique et réalisme, il apparait donc que ce dernier est porteur d’une vision éthique. Par ailleurs, il faut souligner que les réalistes ne s’opposent pas à l’idée de l’existence d’une dimension éthique dans les RI et admettent la présence de forces normatives. Aucune approche ou pensée « ne saurait être neutre sur le plan des valeurs et des préférences »[23]. Hans Morgenthau, réaliste et lecteur d’Aristote, accordait ainsi une grande importance à la prudence l’une des vertus cardinales aristotéliciennes. Il est même légitime de considérer que le réalisme adopte une position axiologique conséquentialiste, la fin justifiant les moyens, à laquelle s’ajoute une éthique de responsabilité politique tournée vers des intérêts nationaux. Considérant le monde comme anarchique (état de nature) ils adoptent une position morale focalisée sur l’intérêt égoïste et la survie. Refusant l’universalisme des valeurs et donc de la morale, ils adoptent également une position relativiste qui peut conduire à l’acceptation de tous système éthique et donc de pratiques plus que discutables.
L'universalisme libéral
À cette conception d’un monde hobbesien, si ce n’est machiavélien, est traditionnellement opposée une vision kantienne universaliste et libérale des relations internationales. Emmanuel Kant est en effet « l’auteur qui a le plus marqué le domaine de l’éthique des relations internationales »[24]. La déontologie kantienne, qui repose sur l’application d’impératifs catégoriques ayant passé le test d’universalisation, se focalise, contrairement au conséquentialisme, sur les moyens plus que sur les fins[25]. C’est des réflexions du philosophe de Königsberg, et notamment de ses livres Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique[26] et Projet de paix perpétuelle, que procède une vision cosmopolite du monde fondée sur « la possession commune de la surface de la terre » sur laquelle les hommes, comme les États, sont des « parties constituantes du grand État du genre humain »[27]. À partir de cette conception et du constat du caractère belliqueux de l’état de nature (constat partagé avec les réalistes), Kant développe une philosophie visant à établir une fédération d’États libres de constitution républicaine et appliquant un droit cosmopolite devant se « borner aux conditions de l’hospitalité universelle »[28]. On voit clairement ici les implications actuelles possibles de cette perspective en matière d’accueil des migrants. En relation internationales, la philosophie kantienne a notamment donné naissance à la théorie de la paix démocratique, postulant que les démocraties[29] ne se font pas la guerre. De là l’idée de promouvoir la démocratie pour installer une paix perpétuelle. Mais le kantisme a aussi sa face sombre. Et comme le souligne Ariel Colonomos, « une politique universaliste est toujours susceptible de prendre une tournure très coercitive ou même martiale. (…) interventionniste et parfois hégémonique (…). Il n’y a souvent qu’un pas à franchir entre considérer que les démocraties ne se font pas la guerre (…) et imposer la démocratie »[30]. Le risque étant que la paix perpétuelle se transforme en tyrannie morale perpétuelle.
Normes, valeurs et construction de la réalité
Le constructivisme[31], qui n’est pas à proprement parlé une théorie des RI, offre une perspective nouvelle sur le rapport entre éthique et RI. En soulignant le rôle des normes qui façonnent les comportements qui sont eux-mêmes conditionnés par les normes[32]. Les constructivistes visent donc plus à développer une approche explicative que normative. Refusant toute réification de l’État (agent) ou du système-monde (structure), ils prétendent étudier les processus d’interactions entre les agents et les structures pour en expliquer la formation et l’existence[33].
L’intersubjectivité est donc au centre de la construction des perceptions[34], idées et croyances, qu’ont les acteurs à la fois de leur environnement, de la place qu’ils y tiennent et du rôle qu’ils y jouent. De ces réalités construites par chacun, procèdent des normes qui vont structurer les relations entre les différents acteurs. De fait, les agents ne sont pas réifiés, c’est à dire considérés comme données, et leurs comportements sont problématisés et contextualisés pour être étudiés.
Dans ce jeu d’
interactions, les valeurs ont donc une importance particulière puisqu’elles contribuent à la formation des identités et donc au positionnement des acteurs sur la scène internationale. Par ailleurs, ces valeurs peuvent, lorsqu’elles sont partagées en tout ou partie, aboutir à des alliances autour de problématiques perçues de manière commune comme dans le cas de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et de la lutte contre le terrorisme qui a profondément marqué la pensée stratégique contemporaine désormais structurée autour des perceptions qui entoure le phénomène.
Pour les constructivistes l’éthique des RI est à la fois un objet d’études dont ils tentent d’« éclairer et interpréter le sens »[35] et un des éléments façonnant les relations entre acteurs. Ils proposent donc un programme de recherche sur la formation des normes éthiques mais également sur leurs impacts inégaux sur les relations internationales. Quoi qu’il en soit, le constructivisme adopte une position neutre axiologiquement et se présente comme une ontologie non normative et non comme une théorie substantive, une approche alternative aux théories classiques.
L’intersubjectivité est donc au centre de la construction des perceptions[34], idées et croyances, qu’ont les acteurs à la fois de leur environnement, de la place qu’ils y tiennent et du rôle qu’ils y jouent. De ces réalités construites par chacun, procèdent des normes qui vont structurer les relations entre les différents acteurs. De fait, les agents ne sont pas réifiés, c’est à dire considérés comme données, et leurs comportements sont problématisés et contextualisés pour être étudiés.
Dans ce jeu d’
interactions, les valeurs ont donc une importance particulière puisqu’elles contribuent à la formation des identités et donc au positionnement des acteurs sur la scène internationale. Par ailleurs, ces valeurs peuvent, lorsqu’elles sont partagées en tout ou partie, aboutir à des alliances autour de problématiques perçues de manière commune comme dans le cas de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et de la lutte contre le terrorisme qui a profondément marqué la pensée stratégique contemporaine désormais structurée autour des perceptions qui entoure le phénomène.
Pour les constructivistes l’éthique des RI est à la fois un objet d’études dont ils tentent d’« éclairer et interpréter le sens »[35] et un des éléments façonnant les relations entre acteurs. Ils proposent donc un programme de recherche sur la formation des normes éthiques mais également sur leurs impacts inégaux sur les relations internationales. Quoi qu’il en soit, le constructivisme adopte une position neutre axiologiquement et se présente comme une ontologie non normative et non comme une théorie substantive, une approche alternative aux théories classiques.
Les dérives de l'éthique : le développement de la « cosm-éthique »
L’éthique, ou la morale, a donc envahit le champ des relations internationales. S’il est de bon ton de s’en réjouir, il est cependant nécessaire d’émettre quelques réserves à cette apparente moralisation des RI.
Il semble en effet que l’argument moral soit devenu un outil communicationnel bien plus que l’expression de convictions et encore moins d’analyses philosophiques sur le Bien et le Mal. En l’occurrence, la surutilisation et le dévoiement de l’éthique, s’appuie sur l’absence de réflexion morale en tant que telle. Il est notable par exemple de constater que nombre d’experts auto-proclamés de la morale n’ont aucun bagage philosophique. Contrairement à ce qui peut être affirmé ici ou là, la morale n’est pas du « simple bon sens ». Elle ne relève pas non plus de la politique, même si elle est influencée par cette dernière et l’influence en retour. Enfin, la morale n’est pas du droit, bien que les deux soient souvent liés. La morale relève de la philosophie au même titre que l’esthétique, la métaphysique ou encore l’épistémologie. La convocation de l’argument moral exige donc des connaissances en philosophie ou, à tout le moins, une connaissance des principales théories de la morale que sont la vertu, la déontologie et le conséquentialisme. Force est de constater qu’à l’exception de travaux spécifiquement universitaires, le recours à la morale dans l’espace public s’affranchit de ce prérequis pourtant fondamental.
Car c’est bien là l’intérêt de la morale : elle parle à tout le monde, même si personne ne la comprend vraiment. La morale est un outil de choix pour tout communicant en ce qu’elle est flexible, facile à manipuler, aisée à comprendre et adaptée à tous les publics, pour peu qu’elle soit réduite à sa plus simple expression : l’opposition entre le Bien et le Mal, eux-mêmes entendus de manière parcellaire, superficielle et manichéenne.
L’idée qu’il existerait une morale universelle, ou universalisable, n’est pas étrangère à ce manichéisme destructeur. Si la morale procède de la philosophie et que la philosophie est subjective et relative, la morale ne peut être objective et absolue. Ce qui est acceptable moralement pour les uns peut ne pas l’être pour d’autres. En RI, le risque est bien entendu de sombrer dans les dérives d’un universalisme tyrannique ou au contraire d’un relativisme destructeur. Pourtant, loin de devoir s’astreindre à un choix binaire entre réalisme et idéalisme, il est possible d’être idéaliste tout en étant réaliste, d’envisager le monde tel que nous voudrions qu’il soit tout en le voyant tel qu’il est. En la matière, seule la naïveté est à éviter.
La tendance semble, cependant, être au développement d’une cosm-éthique ayant pour finalité d’embellir la réalité internationale, de la couvrir d’un verni d’acceptabilité. On notera d’ailleurs l’emploi récurrent du mot « moral » en lieu et place de « Bien », alors que le vocable, loin de ne couvrir que ce domaine englobe également celui du Mal. Considérer que certaines pratiques sont « immorales » dès lors qu’elles n’entrent pas dans cadre de notre conception du Bien, est une erreur qui conduit bien souvent à la polarisation de positions pouvant conduire à des conflits. Erreur parce que, d’une part, la morale est éminemment relative et, d’autre part, parce que le Mal est lui-même un champ de la morale. La réduction de ce que nous considérons comme moral à la seule notion de Bien est illustrative de l’arbitraire de nos schémas de pensée. Ce genre de tropisme doit être évité pour tenter d’objectiver l’analyse et comprendre les enjeux éthiques des RI.
Il semble en effet que l’argument moral soit devenu un outil communicationnel bien plus que l’expression de convictions et encore moins d’analyses philosophiques sur le Bien et le Mal. En l’occurrence, la surutilisation et le dévoiement de l’éthique, s’appuie sur l’absence de réflexion morale en tant que telle. Il est notable par exemple de constater que nombre d’experts auto-proclamés de la morale n’ont aucun bagage philosophique. Contrairement à ce qui peut être affirmé ici ou là, la morale n’est pas du « simple bon sens ». Elle ne relève pas non plus de la politique, même si elle est influencée par cette dernière et l’influence en retour. Enfin, la morale n’est pas du droit, bien que les deux soient souvent liés. La morale relève de la philosophie au même titre que l’esthétique, la métaphysique ou encore l’épistémologie. La convocation de l’argument moral exige donc des connaissances en philosophie ou, à tout le moins, une connaissance des principales théories de la morale que sont la vertu, la déontologie et le conséquentialisme. Force est de constater qu’à l’exception de travaux spécifiquement universitaires, le recours à la morale dans l’espace public s’affranchit de ce prérequis pourtant fondamental.
Car c’est bien là l’intérêt de la morale : elle parle à tout le monde, même si personne ne la comprend vraiment. La morale est un outil de choix pour tout communicant en ce qu’elle est flexible, facile à manipuler, aisée à comprendre et adaptée à tous les publics, pour peu qu’elle soit réduite à sa plus simple expression : l’opposition entre le Bien et le Mal, eux-mêmes entendus de manière parcellaire, superficielle et manichéenne.
L’idée qu’il existerait une morale universelle, ou universalisable, n’est pas étrangère à ce manichéisme destructeur. Si la morale procède de la philosophie et que la philosophie est subjective et relative, la morale ne peut être objective et absolue. Ce qui est acceptable moralement pour les uns peut ne pas l’être pour d’autres. En RI, le risque est bien entendu de sombrer dans les dérives d’un universalisme tyrannique ou au contraire d’un relativisme destructeur. Pourtant, loin de devoir s’astreindre à un choix binaire entre réalisme et idéalisme, il est possible d’être idéaliste tout en étant réaliste, d’envisager le monde tel que nous voudrions qu’il soit tout en le voyant tel qu’il est. En la matière, seule la naïveté est à éviter.
La tendance semble, cependant, être au développement d’une cosm-éthique ayant pour finalité d’embellir la réalité internationale, de la couvrir d’un verni d’acceptabilité. On notera d’ailleurs l’emploi récurrent du mot « moral » en lieu et place de « Bien », alors que le vocable, loin de ne couvrir que ce domaine englobe également celui du Mal. Considérer que certaines pratiques sont « immorales » dès lors qu’elles n’entrent pas dans cadre de notre conception du Bien, est une erreur qui conduit bien souvent à la polarisation de positions pouvant conduire à des conflits. Erreur parce que, d’une part, la morale est éminemment relative et, d’autre part, parce que le Mal est lui-même un champ de la morale. La réduction de ce que nous considérons comme moral à la seule notion de Bien est illustrative de l’arbitraire de nos schémas de pensée. Ce genre de tropisme doit être évité pour tenter d’objectiver l’analyse et comprendre les enjeux éthiques des RI.
Conclusion
Des Traités de Westphalie (1648), qui inscrivent la notion de souveraineté étatique attachée à un territoire dans le marbre[36], au village global de McLuhan[37], en passant par le Congrès de Vienne en 1815, et sa conception impériale de l’ordre international, et le Traité de Versailles qui établit, en 1919, la Société des Nations et entérine ainsi le droit à l’auto-détermination proposé par le Président Woodrow Wilson, le monde a traversé des époques marquées par des réalités multiples en termes d’identités et de perceptions.
À la réification de l’État-nation comme unité de base de l’ordre international après Westphalie, s’est ainsi substituée l’idée d’un monde globalisé remettant en question le paradigme du nationalisme politique postulant le droit de chaque nation à l’auto-détermination et à se constituer en État souverain. « [l]’État-nation (national state) est ainsi devenu une expression d’un idéal éthique – le droit de chaque nation à se réguler elle-même », la mesure morale de toute décision centrée sur l’intérêt national. L’idée selon laquelle les nations ont des droits moraux, au premier rang desquels celui de s’autogouverner, au nom du principe de souveraineté, continue d’irriguer la réflexion sur l’éthique des relations internationales[38]. Pourtant, à la faveur de nombreux événements, cette conception des RI a été bousculée dans ses fondements.
Le processus de globalisation, porté par les évolutions technologiques en matière de communications et de moyens de transport qui ont compressé l’espace et le temps, s’est accompagné de l’affaiblissement des frontières et de l’État lui-même, de l’accélération et l’accroissement des échanges et donc des interdépendances, de la naissance d’une responsabilité globale associée à l’existence de valeur universelles sur lesquelles pourrait être bâtie une morale elle-même universalisable. Dans le même temps cette globalisation a remis en cause l’apparente homogénéité morale procédant de la déification de l’État-nation érigé en transcendance et synonyme d’appartenance à une communauté de valeurs. Elle a, de fait, bousculer le paradigme dominant et mis au jour la diversité des perspectives morales du « village global », avec leurs points communs mais aussi leurs différences et leurs incompatibilités, si ce n’est leurs confrontations. La globalisation a contribué à déconstruire l’édifice international stato-centré et à créer de l’incertitude, elle-même productrice de tensions. L’ordre international fondé sur le droit est lui-même remis en question.
Dans ces conditions, il est normal que la morale fasse un retour en force pour pallier les faiblesses des normes positives, redonner un sens à l’apparente anarchie du système international et proposer des perspectives rassurantes.
Cet état de fait invite à une réflexion approfondie, rigoureuse et décomplexée de l’éthique des relations internationales. Il invite surtout à un travail de recherche plus important dans le domaine. Mais avant même d’envisager la recherche, il est plus que nécessaire de former une génération de chercheurs et de chercheuses spécialistes du domaine, sans quoi l’éthique ne cessera d’être instrumentalisée par des acteurs parfois peu scrupuleux à des fins purement communicationnelles.
La pratique de la cosm-éthique qui consiste à maquiller une réalité souvent inacceptable en réalité fantasmée acceptable, doit faire place au débat qui seul peut faciliter les relations entre acteurs et atténuer, si ce n’est supprimer, des tensions pouvant aboutir à la violence.
[1] Soulignons que la réflexion universitaire française sur le sujet est assez embryonnaire comparée aux productions anglo-américaines.
[1] Bien que les deux puissent être différenciés, dans les lignes qui suivent, nous utiliserons indistinctement les mots « éthique » et « morale ».
[2] La notion de relations internationales est contestée dans le monde académique. Sans entrer dans le débat sur sa légitimité, nous employons cette terminologie dans un sens non restrictif, c’est-à-dire, englobant l’ensemble des acteurs, individus ou groupes d’individus, de la scène internationale, qu’ils soient étatiques ou non.
[3] Emmanuel Goffi. There is No Real Moral Obligation to Obey Orders: Escaping from ‘Low Cost Deontology’. In Andrea ELLNER, Paul ROBINSON, David WHETHAM (eds.). When Soldiers Say No: Selective Conscientious Objection in the Modern Military. Aldershot, England: Ashgate, 2013, pp. 43-68.
[4] Ariel Colonomos. Éthique et théories des relations internationales. In Jean-Baptiste Jeangène Vilmer et Ryoa Chung (éd.). Éthique des relations internationales : Problématiques contemporaines. Paris : Presses Universitaires de France, 2013, p. 40.
[5] Jeangène Vilmer et Chung. Op. cit., p. 2.
[6] Id., pp. 4-7.
[7] Id., pp. 6-7.
[8] Colonomos. Éthique et théories des relations internationales. Op. cit., p. 39.
[9] Jeangène Vilmer et Chung. Op. cit., p. 1.
[10] Thomas Lindemann. Les images dans la politique internationale : l’image de l’autre. Stratégique, revue en ligne, No. 72 « Ami-ennemi », 1998.
[11] Robert Jervis. Perception and Misperception in International Politics. Princeton NJ: Princeton University Press, 1976.
[12] Robert Jervis. Perception and Misperception in International Politics. Princeton NJ: Princeton University Press, 1976.
[13] Peter L. Berger et Thomas Luckmann. La construction sociale de la réalité. Paris : Armand Colin, 2006 [1966].
[14] Emmanuel Goffi. Aristote et l’éthique de la vertu. Les carnets du temps, No. 103, décembre 2013-janvier 2014. pp. 22-23.
[15] Emmanuel Goffi. Kant et la déontologie. Les carnets du temps, No. 104, février 2014. pp. 22-23.
[16] Emmanuel Goffi. L’utilitarisme chez Bentham et Mill. Les carnets du temps, No. 105, avril 2014. pp. 22-23.
[17] Carol Gilligan. In A Different Voice. Cambridge MA: Harvard University Press, 1982.
[18] Virginia Held. The Ethics of Care: Personal, Political, and Global. Oxford NY: Oxford University Press, 2005.
[19] Hans Jonas. The Imperative of Responsibility: In Search of Ethics for the Technological Age. Chicago IL: University of Chicago Press, 1984 [1979].
[20] Thomas Hobbes. Léviathan : Traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la république ecclésiastique et civile. Partie I, Chap. XIII.
[21] Ariel Colonomos. Chapitre 27. L’éthique des RI. In Thierry Balzacq et Frédéric Ramel (dir.), Traité de relations internationales. Paris : Presses de Sciences Po, 2013. p. 661.
[22] Louis Pojman and James Fieser. Ethics: Discovering Right and Wrong. Boston MA: Wadsworth Cengage Advantage Books, seventh edition, 2011. p. 87.
[23] Colonomos. Chapitre 27. L’éthique des RI. Op. cit., p. 663.
[24] Id., p. 665.
[25] Emmanuel Kant. Fondements de la métaphysique des mœurs. 1792.
[26] Emmanuel Kant. Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. 1784.
[27] Emmanuel Kant. Projet de paix perpétuelle. Essai philosophique. Paris : Jansen et Perronneau, 1796 [1795]. p. 43 et 21.
[28] Id., p. 42.
[29] Le mot démocratie doit être entendu ici comme l’expression actualisée du mot république utilisé par Kant.
[30] Colonomos. Éthique et théories des relations internationales. Op. cit., p. 54.
[31] Emmanuel Goffi. Social constructionism. In Paul I. Joseph (Ed.). The SAGE Encyclopedia of War: Social Science Perspectives. Thousand Oaks CA: SAGE Publications Ltd., Vol. 4, 2017. pp. 1575-1577.
[32] Nicholas G. Onuf. Constructivism: A User’s Manual. In Vendulka Kubalkova, Nicholas G. Onuf, Paul Kowert (eds.). International Relations in a Constructed World. New York: M. E. Sharpe, 1998. pp. 58-78.
[33] Alexander Wendt. The Agent-Structure Problem in International Relations Theory. International Organization, Vol. 41, No. 3, Summer 1987. p. 335-370 et Alexander Wendt. Social Theory of International Politics. Cambridge NY: Cambridge University Press, 2010 [1999].
[34] Berger et Luckmann. Op. cit..
[35] Colonomos. Chapitre 27. L’éthique des RI. Op. cit., p. 662.
[36] Les textes des deux principaux traités que sont le Traité de paix signé à Münster entre la France et le Saint-Empire et le Traité de paix entre l’Empire et la Suède, conclu et signé à Osnabrück, tous deux signés le 24 octobre 1648, sont disponible sur le site de la Digithèque de matériaux juridiques et politiques.
[37] Herbert Marshall McLuhan. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. Toronto ON: University of Toronto Press, 1962.
[38] Gordon Graham, Ethics and International Relations, Malden MA: Blackwell Publishing, 2008, p. 5-6.
À la réification de l’État-nation comme unité de base de l’ordre international après Westphalie, s’est ainsi substituée l’idée d’un monde globalisé remettant en question le paradigme du nationalisme politique postulant le droit de chaque nation à l’auto-détermination et à se constituer en État souverain. « [l]’État-nation (national state) est ainsi devenu une expression d’un idéal éthique – le droit de chaque nation à se réguler elle-même », la mesure morale de toute décision centrée sur l’intérêt national. L’idée selon laquelle les nations ont des droits moraux, au premier rang desquels celui de s’autogouverner, au nom du principe de souveraineté, continue d’irriguer la réflexion sur l’éthique des relations internationales[38]. Pourtant, à la faveur de nombreux événements, cette conception des RI a été bousculée dans ses fondements.
Le processus de globalisation, porté par les évolutions technologiques en matière de communications et de moyens de transport qui ont compressé l’espace et le temps, s’est accompagné de l’affaiblissement des frontières et de l’État lui-même, de l’accélération et l’accroissement des échanges et donc des interdépendances, de la naissance d’une responsabilité globale associée à l’existence de valeur universelles sur lesquelles pourrait être bâtie une morale elle-même universalisable. Dans le même temps cette globalisation a remis en cause l’apparente homogénéité morale procédant de la déification de l’État-nation érigé en transcendance et synonyme d’appartenance à une communauté de valeurs. Elle a, de fait, bousculer le paradigme dominant et mis au jour la diversité des perspectives morales du « village global », avec leurs points communs mais aussi leurs différences et leurs incompatibilités, si ce n’est leurs confrontations. La globalisation a contribué à déconstruire l’édifice international stato-centré et à créer de l’incertitude, elle-même productrice de tensions. L’ordre international fondé sur le droit est lui-même remis en question.
Dans ces conditions, il est normal que la morale fasse un retour en force pour pallier les faiblesses des normes positives, redonner un sens à l’apparente anarchie du système international et proposer des perspectives rassurantes.
Cet état de fait invite à une réflexion approfondie, rigoureuse et décomplexée de l’éthique des relations internationales. Il invite surtout à un travail de recherche plus important dans le domaine. Mais avant même d’envisager la recherche, il est plus que nécessaire de former une génération de chercheurs et de chercheuses spécialistes du domaine, sans quoi l’éthique ne cessera d’être instrumentalisée par des acteurs parfois peu scrupuleux à des fins purement communicationnelles.
La pratique de la cosm-éthique qui consiste à maquiller une réalité souvent inacceptable en réalité fantasmée acceptable, doit faire place au débat qui seul peut faciliter les relations entre acteurs et atténuer, si ce n’est supprimer, des tensions pouvant aboutir à la violence.
[1] Soulignons que la réflexion universitaire française sur le sujet est assez embryonnaire comparée aux productions anglo-américaines.
[1] Bien que les deux puissent être différenciés, dans les lignes qui suivent, nous utiliserons indistinctement les mots « éthique » et « morale ».
[2] La notion de relations internationales est contestée dans le monde académique. Sans entrer dans le débat sur sa légitimité, nous employons cette terminologie dans un sens non restrictif, c’est-à-dire, englobant l’ensemble des acteurs, individus ou groupes d’individus, de la scène internationale, qu’ils soient étatiques ou non.
[3] Emmanuel Goffi. There is No Real Moral Obligation to Obey Orders: Escaping from ‘Low Cost Deontology’. In Andrea ELLNER, Paul ROBINSON, David WHETHAM (eds.). When Soldiers Say No: Selective Conscientious Objection in the Modern Military. Aldershot, England: Ashgate, 2013, pp. 43-68.
[4] Ariel Colonomos. Éthique et théories des relations internationales. In Jean-Baptiste Jeangène Vilmer et Ryoa Chung (éd.). Éthique des relations internationales : Problématiques contemporaines. Paris : Presses Universitaires de France, 2013, p. 40.
[5] Jeangène Vilmer et Chung. Op. cit., p. 2.
[6] Id., pp. 4-7.
[7] Id., pp. 6-7.
[8] Colonomos. Éthique et théories des relations internationales. Op. cit., p. 39.
[9] Jeangène Vilmer et Chung. Op. cit., p. 1.
[10] Thomas Lindemann. Les images dans la politique internationale : l’image de l’autre. Stratégique, revue en ligne, No. 72 « Ami-ennemi », 1998.
[11] Robert Jervis. Perception and Misperception in International Politics. Princeton NJ: Princeton University Press, 1976.
[12] Robert Jervis. Perception and Misperception in International Politics. Princeton NJ: Princeton University Press, 1976.
[13] Peter L. Berger et Thomas Luckmann. La construction sociale de la réalité. Paris : Armand Colin, 2006 [1966].
[14] Emmanuel Goffi. Aristote et l’éthique de la vertu. Les carnets du temps, No. 103, décembre 2013-janvier 2014. pp. 22-23.
[15] Emmanuel Goffi. Kant et la déontologie. Les carnets du temps, No. 104, février 2014. pp. 22-23.
[16] Emmanuel Goffi. L’utilitarisme chez Bentham et Mill. Les carnets du temps, No. 105, avril 2014. pp. 22-23.
[17] Carol Gilligan. In A Different Voice. Cambridge MA: Harvard University Press, 1982.
[18] Virginia Held. The Ethics of Care: Personal, Political, and Global. Oxford NY: Oxford University Press, 2005.
[19] Hans Jonas. The Imperative of Responsibility: In Search of Ethics for the Technological Age. Chicago IL: University of Chicago Press, 1984 [1979].
[20] Thomas Hobbes. Léviathan : Traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la république ecclésiastique et civile. Partie I, Chap. XIII.
[21] Ariel Colonomos. Chapitre 27. L’éthique des RI. In Thierry Balzacq et Frédéric Ramel (dir.), Traité de relations internationales. Paris : Presses de Sciences Po, 2013. p. 661.
[22] Louis Pojman and James Fieser. Ethics: Discovering Right and Wrong. Boston MA: Wadsworth Cengage Advantage Books, seventh edition, 2011. p. 87.
[23] Colonomos. Chapitre 27. L’éthique des RI. Op. cit., p. 663.
[24] Id., p. 665.
[25] Emmanuel Kant. Fondements de la métaphysique des mœurs. 1792.
[26] Emmanuel Kant. Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. 1784.
[27] Emmanuel Kant. Projet de paix perpétuelle. Essai philosophique. Paris : Jansen et Perronneau, 1796 [1795]. p. 43 et 21.
[28] Id., p. 42.
[29] Le mot démocratie doit être entendu ici comme l’expression actualisée du mot république utilisé par Kant.
[30] Colonomos. Éthique et théories des relations internationales. Op. cit., p. 54.
[31] Emmanuel Goffi. Social constructionism. In Paul I. Joseph (Ed.). The SAGE Encyclopedia of War: Social Science Perspectives. Thousand Oaks CA: SAGE Publications Ltd., Vol. 4, 2017. pp. 1575-1577.
[32] Nicholas G. Onuf. Constructivism: A User’s Manual. In Vendulka Kubalkova, Nicholas G. Onuf, Paul Kowert (eds.). International Relations in a Constructed World. New York: M. E. Sharpe, 1998. pp. 58-78.
[33] Alexander Wendt. The Agent-Structure Problem in International Relations Theory. International Organization, Vol. 41, No. 3, Summer 1987. p. 335-370 et Alexander Wendt. Social Theory of International Politics. Cambridge NY: Cambridge University Press, 2010 [1999].
[34] Berger et Luckmann. Op. cit..
[35] Colonomos. Chapitre 27. L’éthique des RI. Op. cit., p. 662.
[36] Les textes des deux principaux traités que sont le Traité de paix signé à Münster entre la France et le Saint-Empire et le Traité de paix entre l’Empire et la Suède, conclu et signé à Osnabrück, tous deux signés le 24 octobre 1648, sont disponible sur le site de la Digithèque de matériaux juridiques et politiques.
[37] Herbert Marshall McLuhan. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. Toronto ON: University of Toronto Press, 1962.
[38] Gordon Graham, Ethics and International Relations, Malden MA: Blackwell Publishing, 2008, p. 5-6.