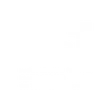Les analyses philosophiques et économiques des liens entre la guerre et l’économie avant 1776
31/10/2019

Les analyses philosophiques et économiques des liens entre la guerre et l’économie avant 1776
Par Jacques Fontanel, Professeur émérite, enseignant à l’ILERI et l’Université Grenoble Alpes
En 1776, Adam Smith publie son célèbre livre sur la « Richesse des Nations » [1]. Il développe l’idée libérale selon laquelle l’ensemble des actions individuelles guidées par le seul intérêt personnel conduit à l’accroissement des richesses et au bien commun. Les marchés sont autorégulateurs et conduisent à l’harmonie sociétale, à condition de contrôler le syndicalisme ouvrier et patronal. L’Etat est le gardien de l’intérêt général, il exerce les fonctions régaliennes, il protège les citoyens par le droit et il combat toutes les formes d’invasion des autres « sociétés ». Adam Smith condamne alors l’esclavage (jugé trop onéreux) et le colonialisme (qui conduit à gérer des dépendances accessoires et coûteuses). L’économie de marché favorise la paix. Cette perception de la relation entre l’économie et la guerre n’est pas originale, l’idée avait déjà été exprimée par d’autres auteurs, notamment par Montesquieu, mais elle marque un tournant essentiel dans le développement de la pensée du libéralisme et du capitalisme, conduisant à une remise en cause profonde des analyses politiques et économiques de la guerre précédentes.
La guerre est une réalité ancienne, déjà conceptualisée par les philosophes grecs. Deux postulats philosophiques s’affrontaient alors concernant les causes des guerres. Pour la pensée « déterministe », si l’univers est mû par la guerre, les hommes ne sont que des pions qu’une volonté aveugle fait obéir. Dans ce contexte, l’homme n’est pas vraiment responsable et il est un acteur involontaire et irresponsable de la guerre. Au contraire, les philosophes de la liberté insistent sur le fait que la guerre est le produit d’un choix et d’une responsabilité des humains.
La guerre a été progressivement justifiée comme une décision exceptionnelle, lourde de conséquences, des autorités politiques et religieuses, lesquelles proclament que le fait de tuer un ennemi commun n’est pas considéré comme un crime, mais plutôt comme un acte de bravoure et de citoyenneté. La guerre exprime le refus du discours de l’autre, elle conduit à nier, par la mort, l’intérêt collectif (national, idéologique ou religieux) de l’existence de l’autre. A ce titre, les autorités qui administrent les citoyens créent une armée, placée sous son autorité, chargée d’assurer la sécurité ou de construire la puissance militaire du pays. Dans l’acte de tuer, il s’agit donc de distinguer d’une part les nécessités de protection et de force d’un pays face à un ou plusieurs ennemis communs et d’autre part la suppression de la vie d’une personne à titre privé, sans en avoir reçu l’autorisation de l’autorité publique qui gouverne l’entité et fixe les lois. Dans ce contexte, les forces armées supposent à la fois des dépenses (un fardeau) qui peuvent être plus que compensées, en cas de victoire dans le conflit avec l’autre, par la prédation, la puissance ou l’indépendance retrouvée ou acquise.
La guerre se proclame comme telle, elle utilise des mots emphatiques d’héroïsme, de survie de la vie collective, ou de destin national à la puissance ou à la résistance. Elle mobilise toutes les énergies d’une Nation, qui se considère alors en « état de guerre », et elle a souvent été à l’origine de la création spécifique des Etats et de leurs contours historiques mouvants. La guerre est déclarée en vue d’une paix durable (y compris la fameuse « paix des cimetières ») que ne viendra plus ternir les principes, la philosophie ou la richesse de l’ennemi. Elle est alors censée être créatrice d’une paix à long terme, malgré les destructions des personnes et des biens. Elle est accusée parfois d’exercer un rôle nécessaire de régulateur démographique, en l’absence d’autres moyens de contrôle des naissances. C’est donc un bien nécessaire. Pour d’autres analystes, la guerre permet d’engager une destruction innovatrice d’un monde déjà obsolète, elle modifie le fonctionnement normal du système économique des Nations, elle pousse à l’innovation technologique pour les armes et à une réorganisation de l’économie nationale menacée par la rareté des biens et services disponibles dans la vie quotidienne des citoyens. La science économique se présente parfois comme un paravent de la guerre économique[2].
Aujourd’hui, le concept polysémique de guerre économique vient troubler cette présentation[3]. Dans une optique mercantiliste, la guerre économique désigne un conflit entre des économies concurrentes dans le jeu des échanges internationaux, conflit d’où sortira un gagnant et un perdant, sauf si un « mercantilisme éclairé » conduit à des concessions réciproques. Elle exprime aussi la réalisation d’actions militaires ayant des finalités principalement économiques, notamment certaines formes de colonisation ou d’esclavagisme[4]. La mise en place d’un blocus économique a pour objet aussi de faire pression sur les populations ennemies et d’obtenir leur reddition ou leur mort. L’avidité est un facteur belligène au même titre que les ambitions personnelles des gouvernants, mais il n’est pas de guerre sans une dimension symbolique dont il faudra rendre compte face à l’Histoire.
En 1776, Adam Smith publie son célèbre livre sur la « Richesse des Nations » [1]. Il développe l’idée libérale selon laquelle l’ensemble des actions individuelles guidées par le seul intérêt personnel conduit à l’accroissement des richesses et au bien commun. Les marchés sont autorégulateurs et conduisent à l’harmonie sociétale, à condition de contrôler le syndicalisme ouvrier et patronal. L’Etat est le gardien de l’intérêt général, il exerce les fonctions régaliennes, il protège les citoyens par le droit et il combat toutes les formes d’invasion des autres « sociétés ». Adam Smith condamne alors l’esclavage (jugé trop onéreux) et le colonialisme (qui conduit à gérer des dépendances accessoires et coûteuses). L’économie de marché favorise la paix. Cette perception de la relation entre l’économie et la guerre n’est pas originale, l’idée avait déjà été exprimée par d’autres auteurs, notamment par Montesquieu, mais elle marque un tournant essentiel dans le développement de la pensée du libéralisme et du capitalisme, conduisant à une remise en cause profonde des analyses politiques et économiques de la guerre précédentes.
La guerre est une réalité ancienne, déjà conceptualisée par les philosophes grecs. Deux postulats philosophiques s’affrontaient alors concernant les causes des guerres. Pour la pensée « déterministe », si l’univers est mû par la guerre, les hommes ne sont que des pions qu’une volonté aveugle fait obéir. Dans ce contexte, l’homme n’est pas vraiment responsable et il est un acteur involontaire et irresponsable de la guerre. Au contraire, les philosophes de la liberté insistent sur le fait que la guerre est le produit d’un choix et d’une responsabilité des humains.
La guerre a été progressivement justifiée comme une décision exceptionnelle, lourde de conséquences, des autorités politiques et religieuses, lesquelles proclament que le fait de tuer un ennemi commun n’est pas considéré comme un crime, mais plutôt comme un acte de bravoure et de citoyenneté. La guerre exprime le refus du discours de l’autre, elle conduit à nier, par la mort, l’intérêt collectif (national, idéologique ou religieux) de l’existence de l’autre. A ce titre, les autorités qui administrent les citoyens créent une armée, placée sous son autorité, chargée d’assurer la sécurité ou de construire la puissance militaire du pays. Dans l’acte de tuer, il s’agit donc de distinguer d’une part les nécessités de protection et de force d’un pays face à un ou plusieurs ennemis communs et d’autre part la suppression de la vie d’une personne à titre privé, sans en avoir reçu l’autorisation de l’autorité publique qui gouverne l’entité et fixe les lois. Dans ce contexte, les forces armées supposent à la fois des dépenses (un fardeau) qui peuvent être plus que compensées, en cas de victoire dans le conflit avec l’autre, par la prédation, la puissance ou l’indépendance retrouvée ou acquise.
La guerre se proclame comme telle, elle utilise des mots emphatiques d’héroïsme, de survie de la vie collective, ou de destin national à la puissance ou à la résistance. Elle mobilise toutes les énergies d’une Nation, qui se considère alors en « état de guerre », et elle a souvent été à l’origine de la création spécifique des Etats et de leurs contours historiques mouvants. La guerre est déclarée en vue d’une paix durable (y compris la fameuse « paix des cimetières ») que ne viendra plus ternir les principes, la philosophie ou la richesse de l’ennemi. Elle est alors censée être créatrice d’une paix à long terme, malgré les destructions des personnes et des biens. Elle est accusée parfois d’exercer un rôle nécessaire de régulateur démographique, en l’absence d’autres moyens de contrôle des naissances. C’est donc un bien nécessaire. Pour d’autres analystes, la guerre permet d’engager une destruction innovatrice d’un monde déjà obsolète, elle modifie le fonctionnement normal du système économique des Nations, elle pousse à l’innovation technologique pour les armes et à une réorganisation de l’économie nationale menacée par la rareté des biens et services disponibles dans la vie quotidienne des citoyens. La science économique se présente parfois comme un paravent de la guerre économique[2].
Aujourd’hui, le concept polysémique de guerre économique vient troubler cette présentation[3]. Dans une optique mercantiliste, la guerre économique désigne un conflit entre des économies concurrentes dans le jeu des échanges internationaux, conflit d’où sortira un gagnant et un perdant, sauf si un « mercantilisme éclairé » conduit à des concessions réciproques. Elle exprime aussi la réalisation d’actions militaires ayant des finalités principalement économiques, notamment certaines formes de colonisation ou d’esclavagisme[4]. La mise en place d’un blocus économique a pour objet aussi de faire pression sur les populations ennemies et d’obtenir leur reddition ou leur mort. L’avidité est un facteur belligène au même titre que les ambitions personnelles des gouvernants, mais il n’est pas de guerre sans une dimension symbolique dont il faudra rendre compte face à l’Histoire.
L’analyse de la guerre avant l’essor de la pensée économique comme catégorie spécifique
La guerre a toujours existé, au moins depuis l’avènement de l’agriculture, puis de l’apparition des communautés publiques, notamment des seigneuries ou des Etats. Dans le film japonais des « 7 samouraï », sans protection, les agriculteurs se voient dépouillés de leur récolte. Dans ce contexte, la propriété privée ou communautaire est alors revendiquée et protégée. Ce qui est vrai dans le domaine de la microéconomie domestique, l’est aussi au niveau des Etats, qui cherchent à se protéger contre les prédateurs.
« La guerre est le père de toutes choses et de toutes choses il est roi », affirmait Héraclite (l’obscur) au Ve siècle avant JC. Les contradictions, les querelles et les conflits sont innés à la vie sur Terre, car le logos (tout est un) inclut le monde humain et le monde naturel, il n’y a pas de séparation entre la cosmologie, la politique ou la vie sociale. Le polemos (guerre, conflit, querelle, discorde, différends) est universel. L’harmonie naît de la confrontation et de l’ajustement des contraires, du principe de mouvement et de génération de toutes choses. La paix est discorde, comme la justice, car elles impliquent nécessairement leur contraire, la guerre et l’injustice. Ce qui est contraire est utile. « Il faut savoir que la guerre est universelle, et la joute justice, et que, engendrées, toutes choses le sont par la joute, et par elle nécessitées »[5]. Si l’on suit la pensée d’Héraclite, la guerre et l’économie (terme conceptualisé par Xénophon, un élève de Socrate, donc postérieur à l’analyse d’Héraclite) sont donc étroitement associées. Chez les Grecs, l’économie (qui est accusée d’amoralité et d’égoïsme) est un sous ensemble de l’organisation de la cité, qui n’est pas celui qui porte les plus belles valeurs.
Platon (428-347 av. JC)[6] va définir sa société communiste sur la base de la reconnaissance de trois classes, d’abord, celle des agriculteurs, commerçants, artisans, puis celle les guerriers, enfin celle des chefs, ceux qui dirigent l’ensemble de la société. C’est une question de statut, lequel n’implique nullement un confort matériel différent, car le partage des biens, l’application de la morale et de la justice, l’égalité des fortunes et l’encadrement du marché par l’Etat sont les règles centrales de la cité idéale qui comprend 5040 citoyens. L’égalité de traitement économique et juridique est un principe de base. Il s’agira d’organiser la population et de la contrôler (eugénisme, droit d’ainesse, droit d’obtenir un enfant en cas d’infertilité). De fait, Platon ne mentionne pas les esclaves, pourtant très nombreux, ni les enfants, ni ceux qui n’ont pas le statut de citoyen[7]. Or, la grande partie de l’activité économique était assurée par les esclaves. Dans sa pensée originelle, l’esclavage n’existait pas dans la Cité car les citoyens, en fonction de leurs aptitudes pouvaient assurer l’ensemble des activités satisfaisant les besoins particuliers et collectifs des citoyens. Plus tard (Les Lois)[8], il n’abordera pas la question de la même manière et il acceptera l’idée que l’esclavage peut être une solution économique à la vie collective. Il évite d’aborder la question du travail des esclaves dans la production des ressources au profit du bon fonctionnement de la Cité, et la répartition inégalitaire qu’ils reçoivent en échange au bénéfice des citoyens.
Au regard des pays étrangers, il distingue la guerre avec les Barbares, des conflits et dissensions entre cités grecques, dont les citoyens ne peuvent être réduits en esclavage. Sa société communiste renie la démocratie athénienne, laquelle donne la victoire aux citoyens incapables de gouverner et de maintenir le fonctionnement de la Cité idéale. En outre, l’excès de liberté dans un régime démocratique aboutit à accorder aux étrangers quasiment autant de droits qu’aux citoyens, avec la tentation inhérente démagogique de supprimer l’esclavage. Les gardiens de la société, les chefs, doivent posséder ou acquérir des vertus collectives suffisantes et spécifiques pour conduire à l’harmonie collective[9]. Les guerriers et les chefs doivent garder leurs vertus morales, donc ils ne doivent avoir aucun contact avec les affaires, nécessairement corruptrices, d’argent et de négoce. La justice sociale est fondée sur le mérite. Il imagine une cité parfaite qui repose sur le partage des biens (« communisme » de Platon, sans propriété privée), la morale et la justice. Dans la cité réelle, Platon insiste sur la nécessité d’établir l’égalité des fortunes et de corriger les inégalités par la redistribution car les non possédants sont une perpétuelle source de révolution. En fait, il recherche l’efficacité et non la réelle égalité.
La recherche d’un système politique idéal suppose l’harmonisation de la Société (la Cité) et de son contenu (l’individu). Platon décrit longuement les gardiens de la Cité et les vertus qu’ils devraient posséder. Cette conception platonicienne conduit à une hiérarchie principalement définie par les héritages. La Cité n’est pas fondée sur un consensus des citoyens, elle est imposée par le ou les chefs qui défendent la raison et la vérité dans le cadre complémentaire d’une sacralisation religieuse et du refus d’expression des inimitiés, notamment envers les autres cités grecques. Elle interdit l’initiative individuelle, promeut la censure, rigidifie l’éducation et l’innovation, contrôle et distingue la procréation de l’amour, établit des règles restrictives et conduit à un contrôle social qui pourrait s’apparenter à une forme de totalitarisme. Platon définit un mode quasi autarcique dans lequel toute évolution est jugée décadente et la guerre offensive condamnée.
Aristote va critiquer les constitutions platoniciennes de la République et des Lois, jugées contradictoires et incompatibles avec le monde humain tel qu’il existe. Pour Aristote, le monde est fait de profonds changements, lesquels ne peuvent pas toujours être maitrisés par les hommes. Il n’y a pas de modèle idéal, seule l’expérience peut fournir des informations utiles pour l’avenir[10]. Aristote définit les conditions naturelles de la vie politique et sociale, avec des règles claires de rapport de rangs, le mari et la femme, les parents et les enfants, mais aussi entre le maître et l’esclave. Chez l’homme le courage est une vertu de commandement, chez la femme une vertu de subordination. Le bonheur suppose que l’individu dispose, privativement, de biens matériels. La propriété privée est pour lui synonyme de paix sociale car les hommes ne prennent pas soin de ce qui ne leur appartient pas directement. Aristote opère également une distinction entre l’économie (qui signifie l’autoconsommation, et donc le travail directement pour se nourrir) de la chrématistique (l’acquisition de richesses, et donc la consommation). Il y a une façon naturelle d’acquérir des biens : c’est l’agriculture, la chasse, et la pêche car ces dons de la nature on été fait offerts à l’utilisation et à la consommation des l’homme. En revanche, le commerce est une activité non naturelle elle est donc condamnable. Toutes les activités économiques dépendent principalement du résultat du travail ; or, le travail est incompatible avec le véritable objet de l’homme. Pour dénouer cette contradiction, Aristote fait appel à l’esclavagisme, lequel est justifié par l’infériorité naturelle de certains hommes et populations. L’activité économique a besoin de la subordination de esclaves, mais aussi des femmes. Les Grecs avaient trois manières de s’approvisionner en esclaves : le commerce, la piraterie, mais aussi la guerre avec son butin de prisonniers.
Cependant, il faut lutter contre les tendances à l’inimitié à l’égard des autres et la guerre doit être évitée. Certes, la désignation d’un ennemi externe est parfois nécessaire pour l’unité de la Cité, mais elle ne doit pas conduire à une lutte acharnée conduisant à des destructions dommageables et à des résultats capables de remettre en cause le principe d’autarcie. La guerre n’est cependant pas écartée, notamment si elle est nécessaire pour recouvrer des valeurs collectives dans une autarcie altérée. Qu’elle soit offensive ou défensive, elle est un moyen pour recouvrer la paix. Aristote n’engage pas la Cité à développer des conquêtes, mais il souhaite aussi que celle-ci se protège par les armes. Il réclame une utilisation mesurée et opportune de la puissance militaire. La guerre est fondamentalement un acte économique particulier de prédation et d’investissement avec la main d’œuvre des esclaves. Guerre et économie sont étroitement associés. Pour autant, il considère que l’objet de la guerre, c’est la paix. Indépendamment de la complexité de l’histoire de l’humanité, la guerre a toujours servi la prédation du vainqueur, laquelle ne se limitait pas aux biens matériels, mais aussi à la mise en esclavage des vaincus. C’était un moyen de production essentiel, pour permettre aux citoyens de travailler leurs compétences et leur rôle dans la société. L’esclavage est sans doute l’une des plus vieilles institutions de l’humanité. Privé de son identité, l’esclave était doté d’un statut juridique spécifique dans la société ; il était privé de son identité et de sa liberté, selon des règles différenciées dans le temps et dans l’espace.
Dès l’origine, la chrétienté ne s’oppose pas à l’esclavage[11]. Pour Saint Paul, tous les baptisés, qu’ils soient Grecs ou Juifs, hommes libres ou esclaves, ne forment qu’un seul corps nourris par le même esprit de Dieu. Il recommande aux esclaves l’obéissance à leurs maîtres et leur rappelle que le Royaume des Cieux leur est ouvert. Les êtres humains restent libres dans leur soumission à Dieu. Pendant tout le Moyen-Age, l’esclavage sera accepté par l’Eglise, comme un élément incontournable du destin des hommes. La guerre elle-même n’est pas rejetée, elle est même parfois revendiquée.
Concernant la guerre elle-même, pour Saint Augustin (354-430, après JC.), « on ne cherche pas la paix pour faire la guerre, mais on fait la guerre pour obtenir la paix. Sois donc pacifique en combattant, afin de conduire ceux que tu connais au bienfait de la paix, en remportant sur eux la victoire ». Cette idée sera poursuivie par Saint Thomas d’Aquin (1224-1274) pour lequel « une guerre est juste si sa cause est juste et qu’elle poursuit le Bien Commun ». De même, l’économie doit répondre aux principes religieux. Thomas d’Aquin va défendre la notion du « juste prix » et de l’interdiction du taux d’intérêt (car le temps appartient à Dieu, le taux d’intérêt est le pris du temps et on ne peut pas vendre ce qui ne nous appartient pas). Il va défendre le principe de la propriété, mais il est obligé de dire que se servir d’un bien d’autrui que l’on a dérobé dans un cas d’extrême nécessité n’est pas un vol à proprement parler. En reprenant la pensée aristotélicienne, que la propriété privée seule permet de mettre de l’ordre, car chacun sait ce qu’il doit faire. En revanche, l’accumulation des richesses ne doit pas être une fin en soi L’objectif est de trouver un système économique compatible avec les doctrines chrétiennes de piété et justice. L’esclavage comme ressource humaine n’est pas condamnable, il a été institué en punition des péchés par Dieu tout-puissant. Il faudra attendre la fin du XIXe siècle (1888), pour que le Pape Léon III, favorable aux mouvements anti-esclavagistes, condamne l’esclavage[12].
Ces idées concernant la guerre seront clairement prolongées par Macchiavel (1513)[13], pour lequel, une guerre est juste lorsqu’elle est nécessaire. A qui ? Au Prince. C’est une pensée nouvelle, qui annonce le mercantilisme, la première théorie économique conçue telle quelle, sans référence nécessaire aux valeurs religieuses. La guerre est au cœur de l’action gouvernementale, la stabilité politique est plus essentielle que l’enrichissement national. Les forces armées assurent la supériorité de l’Etat et toutes les lois et règles morales ne peuvent survivre sans le soutien d’une force militaire puissante. L’économie c’est l’art d’enrichir le Prince et le royaume, dans une optique de puissance, c’est-à-dire une optique militaire. La force militaire est plus importante que la richesse des Nations, même si la guerre est un facteur essentiel de la redistribution des richesses dans le monde[14]. La militarisation de la société est nécessaire à la fois pour gérer le pays, mais aussi pour maintenir la cohésion sociale. La guerre est un moyen d’achever les buts politiques et économiques du Prince. La force économique est utile pour disposer des moyens nécessaires pour gagner la guerre et assurer la toute puissance du Prince. L’objectif n’est pas l’amélioration de la situation économique et sociale des citoyens, il est dans la volonté de domination qui est inscrite dans la nature même de l’Etat. L’économie est un moyen, ce n’est pas le but ultime. Machiavel va inspirer les thèses mercantilistes.
Les phénomènes économiques sont alors conçus dans le cadre de l’Etat ; c’est une théorie d’économie politique laïque, qui souligne les rapports de force entre les Etats et leur volonté de s’enrichir, notamment par l’acquisition de l’or et la mise en place d’une organisation économique efficace, sans crainte d’utiliser des stratégies qui appauvrissent les Etats voisins.
Ces conceptions vont être battues en brèche avec les grandes découvertes et la Renaissance[15]. Le mercantilisme marque la fin de ces représentations ancestrales. Il apparaît dans un contexte intellectuel où l’humanité s’ouvre de nouveau aux sciences et conteste parfois les croyances défendues par l’Eglise (Copernic, Galilée).
Le mercantilisme
Jusqu’au XVIe siècle, la théorie économique tient peu de place, elle n’existe pas vraiment en tant que telle. L’émergence d’idées mercantilistes coïncide avec la montée en puissance des États nations. Au départ, le mercantilisme n’est pas un courant de pensée homogène, mais il va contribuer à débattre le l’organisation économique d’un pays dans le débat public. Il se caractérise par la course étatique à la richesse et à la puissance, par la recherche d’indépendance, voire d’autarcie, et la mise en place d’un processus plus ou moins sophistiqué de prédation. Les objectifs économiques portent sur la volonté des acteurs économiques de s’enrichir et sur la possession de stocks d’or comme expression de puissance et de la richesse du Prince, à l’intérieur et à l’extérieur du Royaume. L’Etat devient un acteur économique déterminant, qui peut encourager l’essor des activités de production, notamment manufacturières, Les politiques économiques proposées diffèrent en fonction de l’état des connaissances, mais aussi de l’histoire guerrière des Etats. Cependant, s’instaure une vision dynamique d’une action publique destinée, par tous les moyens, à donner les instruments de puissance au Prince. Afin de limiter la dépendance vis-à-vis des marchands étrangers, il est recommandé d’annexer les territoires qui fourniront les richesses dont la métropole ne dispose pas. Pour gagner la guerre économique, les mercantilistes préconisent l’expansion militaire, à la fois contre les Etats puissants qui contestent le pouvoir de l’Etat, mais aussi contre les territoires lointains qu’il convient de piller ou de coloniser.
Le mercantilisme n’est pas une théorie économique unifiée[16]. Les mercantilistes bullionistes développent leurs stocks de richesse pour le Prince, par le colonialisme, l’impérialisme et la prédation. Le « mercantilisme colbertien » propose l’autarcie comme principe, avec une dépendance limitée aux importations qui créent une dépendance économique de la Nation et l’essor des industries nationales et des exportations pour accroître le pouvoir royal. Enfin, le mercantilisme « anglais » croit d’abord à l’essor du commerce national, avec une flotte militaire et commerciale britannique dominante par rapport à la puissance hollandaise, grâce notamment aux guerres anglo-hollandaises. Le colonialisme est préconisé et institué pour réduire les dépendances économiques nationales et contraindre les Etats dominés à éviter toute concurrence avec les biens et services produits sur le sol de la métropole.
Les principes : L’argent fait le bonheur et la puissance des Princes
Certains mercantilistes conçoivent le système économique comme un jeu à somme nulle, où le gain réalisé par un agent se traduit par la perte pour les autres agents. Comme le dit à l’époque Jean Bodin : « Il n’y a personne qui gagne qu’un autre n’y perde » (Les Six livres de la République). De ce fait, toute politique économique bénéficiant à un groupe d’individus, étant par définition néfaste à un autre, l’économie intérieure n’a que très peu d’effet sur l’augmentation du bien-être social général. Et puisque le commerce intérieur n’augmente pas ou peu la richesse nationale, il est donc justifié et souhaitable de donner la priorité au commerce extérieur pour répondre à cet impératif.
Le rôle des États-nations va croissant. Durant cette période, d’importantes quantités d’or et d’argent affluent des colonies espagnoles du Nouveau Monde vers l’Europe. À l’origine, pour les auteurs bullionistes, tels que Jean Bodin ou Thomas Gresham , la richesse et le pouvoir de l’État sont mesurés par la quantité d’or qu’il possède. Chaque nation doit accroître son pouvoir en accroissant ses réserves d’or aux dépens des autres nations. La prospérité d’un État est censée être mesurée par la richesse accumulée par son gouvernement, sans référence au revenu national. Un pays riche est celui qui possède le plus d’argent et d’or. Cet intérêt pour les réserves d’or et d’argent s’explique en partie par l’importance de ces matières premières en temps de guerre. Les armées comprennent nombre de mercenaires qui sont payés en or. Ainsi le mercantiliste français Antoine de Montchrestien explique en 1615 : « Il est impossible de faire la guerre sans hommes, d’entretenir des hommes sans soldes, de fournir à leur solde sans tributs, de lever des tributs sans commerce. »[17]. L’Espagne et le Portugal, possesseurs des principales mines destinées à l’Europe, en ont prohibé l’exportation sous les peines les plus graves, ou l’ont assujettie à des droits énormes. Pour les autres pays, l’excédent commercial est l’objectif économique majeur, la principale méthode d’acquisition de ces matières premières. Il revient donc à l’État, en exportant davantage qu’il n’importe, de tout faire pour enregistrer une « balance du commerce » (ce qui correspond, de nos jours, à la balance commerciale) excédentaire, soit une entrée nette de richesses, traduites en or ou autres métaux précieux. Les « bullionistes » prescrivaient en outre la mise en place de taux d’intérêt élevés pour encourager les investisseurs à placer leur argent dans le pays.
Les mercantilistes recherchent le développement économique comme une opportunité pour enrichir l’Etat au moyen d’un commerce extérieur dégageant un solde positif grâce à des actions économiques et commerciales pertinentes des autorités publiques. L’Etat a la responsabilité d’accroître constamment la richesse nationale, grâce au protectionnisme, à l’innovation industrielle et commerciale, au soutien apporté à l’exportation et aux victoires militaires. Les relations économiques ne répondent pas à une politique de marché libre, elles sont souvent forcées. Alors que le stock de richesses est considéré comme relativement fixe, la seule façon d’accroître la richesse d’un pays ne peut se faire qu’au détriment d’un autre. Du XVIe au XVIIIème, les idées mercantilistes vont justifier l’exercice des rapports de force qui peuvent conduire à des conflits longs et à des guerres, lesquelles apportent parfois une solution à la question de la puissance économique relative des Etats. C’est l’essor du colonialisme et de l’impérialisme. De nombreuses guerres, dont les guerres anglo-hollandaises, franco-hollandaise, et franco-anglaise se déclenchent sur la base d’un « nationalisme économique » destiné à accroître la puissance du Prince.
Les Nations puissantes doivent s’emparer des territoires disposant de matières premières ou importateurs de produits nationaux afin de limiter la dépendance à l’égard d’un pays, qu’il soit puissant ou non. Il s’agit de vivre le plus possible en autarcie au regard des importations, mais aussi de produire plus que les besoins du pays pour exporter et accroître les stocks d’or du Prince. Les expéditions occidentales vont alors se développer dans le monde entier, avec la création de la Compagnie anglaise des Indes orientales par l’Angleterre (1600) puis la riposte des Provinces Unies avec la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (1602), la France réagit à son tour par la création de la compagnie française des Indes orientales (1664).
Le mercantilisme ibère, dit bullioniste
Le mercantilisme bullioniste, matrice originelle, considère que les métaux précieux (notamment l’or détenu en stock) représentent la
richesse
par excellence du fait de leur caractère impérissable. En 1503, la Casa de Contratación, un organisme chargé de réglementer le trafic entre l’Espagne et les nouvelles colonies, est créé à Séville. Il est chargé de prélever une taxe correspondant au cinquième du commerce avec les Indes occidentales (Quinto Real) et de collecter les informations sur les découvertes des explorateurs.
Sur cette base, l’Etat puissant doit empêcher les métaux précieux à sortir de son territoire et, au contraire, il doit en accroître la quantité disponible à l’intérieur du Royaume à la disposition du Prince. Sous les règnes de Charles Quint et de Philippe II, l’Espagne va s’engager résolument dans les actions colonialistes et impérialistes. Dans ce contexte de pensée, l’Espagne va partir à la conquête de l’Amérique (aujourd’hui appelée latine). Dès le début, la conquête s’inscrit violemment dans la volonté de prédation des terres et des biens des autochtones. La maison royale accorde aux conquistadores le droit de s’approprier les terres en échange de 20 % des butins et trésors ainsi obtenus[18]. La supériorité technologique de l’offensive, ainsi que les maladies importées d’Europe, les croyances (comme le mythe de Quetzalcoatl) ou les divisions des Amérindiens ont permis des conquêtes rapides[19], favorisant un esprit de prédation violent. Dès le départ, Christophe Colomb a mesuré la naïveté des autochtones, qu’il décrit sans armes, ne connaissant pas le fer, faciles à asservir et à en faire de bons serviteurs. De fait, les conquêtes furent facilitées par les stratégies militaires et psychologiques grâce à l’aide des hostilités entre Amérindiens, eux-mêmes en conflits internes ou en révoltes contre leurs dirigeants jugés trop cruels. En 1521, trois ans après son arrivée, Cortès devient gouverneur de l’empire Aztèque. Dix ans plus tard, grâce à un coup d’audace et à la traitrise, Pizzaro s’empare de l’empire des Incas. Les Conquistadors s’approprient les terres et les mines, et ils pillent les richesses des autochtones. L’or des Antilles, puis du Pérou, enfin de Colombie, et l’argent du Mexique et de la Bolivie furent ensuite importés en Espagne. Les mines fournissent rapidement 80 % de la production mondiale d’argent (dont 1/5e pour le Roi).
A la Renaissance, l’âge d’or espagnol, sa puissance apparente naît de l’abondance de métaux précieux importés et entassés. Disposant des principales mines qui fournissent ces métaux à l’Europe, l’Etat va contrôler le commerce[20], et en limiter, voire prohiber, l’exportation, en instituant des droits de taxes douanières considérables. Dans ces conditions, les promoteurs des voyages transatlantiques, souvent nobles, vont s’enrichir rapidement et les inégalités de ressources et de fortune à l’intérieur du pays vont alors croître considérablement. Les grandes propriétés agricoles (latifundia) vont se développer, surtout à partir du XVIIe siècle, tournée vers une production extensive, sans recherche d’exploitation optimale, au regard des revenus conséquents de leurs propriétaires, peu incités à s’engager dans un système productif agricole et industriel, plus aléatoire que le pillage des ressources naturelles de l’Amérique. Entre la métropole et les colonies, les rapports sont de moins en moins harmonieux, car ces dernières se voient interdire de commercer avec d’autres Nations ou de créer des industries susceptibles de concurrencer les produits espagnols. Le travail forcé est de moins en moins admis par les autochtones et les mines progressivement s’épuisent, ce qui conduit la couronne d’Espagne à augmenter les taxes diverses, conduisant progressivement à une récession économique de ces colonies. L’Espagne va s’appauvrir, avec les migrations de forces vives vers l’Amérique latine, mais aussi avec la thésaurisation des métaux précieux, qui empêche l’investissement agricole et industriel.
L’exploitation des Amérindiens est violente. Un demi siècle, après leur défaite, il ne reste plus qu’un million d’Incas, sur 12 millions. De manière plus générale, la population amérindienne s’effondre, passant d’environ 80 millions d’habitants au début du XVIe siècle à environ 12 millions cent ans plus tard, les populations étant laminées par les guerres, les conditions de travail et les maladies importées par les colons. Pourtant ne cédule royale de 1503, reconnaissait la liberté des Indiens et leur capacité à recevoir un salaire de leurs maîtres. Cependant, le système de « l’encomienda » va s’étendre sur l’ensemble des territoires occupés par l’Espagne et s’écarter des règles de la cédule royale. C’est un droit de seigneurie (tribut de métaux précieux, corvées, travail forcé, en échange de l’évangélisation et de la protection de leurs maîtres) sur les communautés indiennes qui ressemblent de fait, à une situation d’esclavage. Dix années plus tard, les lois de Burgos imposent aux Espagnols de meilleures conditions de travail pour leurs Indiens, mais ni la loi, ni la bulle du pape Paul III qui condamne l’esclavage des Indiens en affirmant leurs droits à la liberté et à la propriété, ne furent respectées. Un demi siècle plus tard, les exactions des conquistadors espagnols, sans cesse révélées par maints humanistes, sont révélées par Bartolomé de Las Casas lui-même ancien « encommendero ». Charles Quint prendra les Indiens sous la protection de la couronne d’Espagne, mais la violence des « encommenderos » ne permit guère l’application de cette règle. En 1550, lors de la Controverse de Valladolid qui l’oppose au théologien Juan Ginés de Sepúlveda (lequel, reprenant les arguments d’Aristote, considère que la conquête institutionnelle est un devoir moral au regard de l’immaturité, l’amoralité et l’idolâtrie des autochtones) il parvient à imposer l’idée selon laquelle les autochtones ont une âme et sont donc sujets de droit. Pour Las Casas, toutes les sociétés sont humaines et dignes d’exister et il est outrageux de vouloir convertir par la force, et non par l’évangile. Pour de Sepùlveda, les sacrifices humains et l’anthropophagie témoignent de l’arriération de ces civilisations et explique leur mise en tutelle afin de les empêcher à violer les lois de la morale. En outre, le Christ a donné aux chrétiens l’ordre d’évangéliser le monde. La controverse est restée célèbre, mais aussi elle a eu pour conséquence de poser la question de l’esclavage et de l’exploitation des plus faibles communautés, au regard du respect de la nature humaine.
L’importation d’or et d’argent du Nouveau Monde stimule la croissance immédiate, mais elle provoque aussi l’apparition d’une forte inflation. Les nouveaux riches sont aussi friands des produits importés plus fastueux. Les finances royales sont dilapidées par les guerres et le faste impérial, ce qui conduit le roi à souscrire des prêts à taux élevés auprès de banquiers italiens et allemands et à obliger leurs riches sujets à souscrire des obligations d’Etat à faible rendement. L’Espagne va connaître un lent mais solide déclin dès le début du XVIIe siècle, malgré (ou à cause de) la domination militaire en Europe et du développement de colonies de peuplement. L’accumulation de métaux précieux, souvent dépensés par les plus riches pour honorer les dettes envers les fournisseurs et banquiers d’Allemagne ou d’Italie, ne favorise pas le développement de la métropole, elle constitue plutôt un accélérateur à l’activité économique et préindustrielle des pays voisins. Cette politique non seulement conduit à un manque d’investissement sur le territoire national qui se conjugue à une forte inflation, mais conduit aussi au dépeuplement de ses forces vives au bénéfice du Nouveau Monde. Le choix d’une domination à la fois outre-mer, en Europe et contre les protestants engendre de coûteuses dépenses militaires. En 1627, l’Etat espagnol ne peut éviter la banqueroute[21]. Incapable de réduire les dépenses somptuaires, de mettre à contribution les plus riches et à stimuler l’économie nationale (du fait des facteurs de thésaurisation), la couronne royale a plusieurs fois été en cessation de paiement, ce qui n’a fait qu’accroître sa dette et le coût de la dette avec les banques étrangères. L’Espagne n’était plus maîtresse de son destin économique et financier. Plus grande puissance coloniale mondiale au XVIe siècle, avec son invincible armada, l’Espagne va connaître progressivement un déclin marqué et constater que les puissances anglaises, française ou hollandaises la dépasser économiquement, technologiquement, militairement.
Le mercantilisme français
En France, le mercantilisme voit le jour au début du XVIe siècle, peu de temps après l’affermissement de la monarchie. En 1539, un décret royal interdit l’importation de marchandises à base de laine d’’Espagne et d’une partie de la Flandre. L’année suivante, des restrictions sont imposées à l’exportation d’or. Des mesures protectionnistes se multiplient tout au long du siècle. Au début du XVIIe siècle, Antoine de Montchrestien a conçu le premier manuel d’économie politique, un néologisme d’alors, titre de son livre principal. Il se propose de construire une réflexion économique destinée à comprendre les processus de la production nationale et de la distribution des richesses. Il traite recommande l’intervention économique soutenue de l’Etat, d’abord pour créer des manufactures, développer le commerce et l’industrie à côté de l’agriculture et enfin pour instituer une forme de travail obligatoire et réglementer les professions. L’objectif est d’engager le développement des activités économiques de la Nation et de se protéger, par les droits de douane, de la concurrence des produits étrangers, dans l’intérêt bien compris de l’enrichissement de l’Etat. A l’intérieur du Royaume, il préconise la concurrence intérieure pour stimuler l’industrie, mais il ne l’accepte pas face aux entreprises étrangères. Celles-ci n’ont pour but que d’affaiblir la Nation, la rendre dépendante et lui prendre ses richesses. Son protectionnisme est institué sur les biens produits en France, mais il peut admettre le libre-échange pour les biens pour lesquels la France n’a pas de disponibilités en termes de production ou de ressources naturelles.
Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), Contrôleur général des finances pendant dix-huit ans (1665-1683), est le principal instigateur des idées mercantilistes en France, ce qui conduit certains à parler de colbertisme pour désigner le mercantilisme français. Il fait de l’État un promoteur actif dans la sphère du Commerce, mais aussi de l’Industrie. Sous sa direction, le gouvernement français s’implique de façon importante dans l’économie afin d’accroître la production nationale, mais aussi les exportations, en créant des Manufactures, voire des « villages-usines » destinées à l’exportation de produits de luxe. Il s’agit d’être concurrentiel, dominant. Dans sa conception, la puissance du Prince constitue l’objectif principal de toutes les actions politiques et économiques.
Afin de maximiser la production, l’application de la loi d’airain est recommandée. Il s’agit de fournir un revenu minimum, celui qui permet la simple subsistance des agriculteurs et des ouvriers. Les travailleurs sont considérés alors comme une forme de capital humain qu’il faut savoir maintenir en vie sans lui offrir d’autres objectifs qu’un travail de survie. Un revenu supérieur des « travailleurs » conduit nécessairement à une recherche de vie sociale plus élaborée, une aspiration vers du temps libre ou d’éducation susceptible de développer à la fois la paresse et des contestations, que la précarité de la situation sociétale leur interdit. En France, les enfants âgés de six ans travaillaient dans les manufactures d’État et l’esclavage dans les colonies est maintenu.
Colbert fait construire un important réseau de routes et canaux pour abaisser les obstacles au commerce et il réduit les droits de douane intérieurs. L’Etat développe des monopoles nationaux et contrôle les propriétaires privés des moyens de production. Les compagnies de commerce sont considérées comme des armées du roi, qui doivent vaincre les « armées économiques étrangères ». Dans ce contexte, les manufactures ne sont que des fournisseurs de produits, qui permettent d’assurer la dépendance des pays étrangers aux productions françaises et d’accroître le trésor de l’Etat. Les politiques menées par Colbert ont été dans l’ensemble efficaces, et elles ont permis à l’industrie et à l’économie françaises de croître considérablement durant cette période, faisant de la France une des plus grandes puissances européennes. Cependant, sa politique restrictive concernant les échanges internationaux et la faiblesse de la demande intérieure consécutive aux conditions de travail déplorables du pays ne permettent guère aux citoyens d’améliorer leur situation, dans une période où les Rois continuent à exercer à grand frais leur « droit de guerre ». A la mort de Colbert, l’Angleterre et la Hollande devancent toujours la France. Adam Smith contestera fortement l’action de Colbert en considérant que l’organisation d’une économie au seul service du Prince ne permet pas le développement économique et nuit, à terme, à la puissance de l’Etat.
Le mercantilisme anglais
Les Anglais croient à l’essor de l’industrie et au commerce international comme vecteur de puissance de l’Etat. Le commerce extérieur est une source abondante de richesse pour un pays à condition de dégager un excédent de la balance commerciale, laquelle suppose d’investir dans des activités économiques à forts rendements. La stratégie industrielle de l’Angleterre est claire. Dès 1485, selon la formule d’Henry VII, il s’agit « d’exporter des biens manufacturés et d’importer des produits bruts », cette phrase résumant l’essentiel de ce que sera la politique industrielle anglaise et sa future prospérité. Dans ce contexte, le mercantilisme anglais prône un contrôle du commerce international en vue d’encourager les exportations par des subventions et de limiter les importations par la mise en œuvre de taxes. Dans ces conditions, l’économie nationale est privilégiée, non pas seulement par une action directe sur la production elle-même, mais par des règles et lois qui privilégient et soutiennent les investisseurs nationaux, accompagnés dans leurs relations commerciales avec leurs clients et fournisseurs par la puissante Royal Navy. La compétition économique dans le domaine des ressources de matières premières est fortement réduite par l’interdiction d’exportation de certaines d’entre elles. Au plan intérieur, contrairement aux mercantilistes espagnols, l’idée principale était l’utilisation de toutes les terres pour l’agriculture, en vue d’améliorer l’autonomie alimentaire du pays et d’optimiser la production nationale.
La promulgation de règlements et de législations mercantilistes a surtout été engagée au milieu du XVIIe siècle, engagée, notamment pendant la période du « Long Parliament » (1640-1660)[22] de Cromwell. Un embargo a d’abord été décidé à l’encontre de trois colonies encore sous contrôle royal, la Barbade, les Bermudes et la Virginie. Il a ensuite été décidé de collecter une taxe de 15% sur les navires marchands battant pavillon anglais, destinée à la protection des convois nécessaires au commerce anglais et pour renforcer la marine de guerre. La loi sur la navigation (Navigation Act, 1651)[23] mise en place par le gouvernement anglais, interdit aux commerçants étrangers de faire du commerce intérieur en Angleterre, colonies comprises. Cette décision va conduire au développement de la construction navale nationale, un secteur particulièrement intéressant pour engager un processus d’innovation favorable à l’émergence structurelle d’un développement économique national. La Barbade, gérée par l’opposition royaliste, était un pays producteur opulent de sucre. Il s’agissait donc d’interdire son exportation par les navires hollandais et de réserver cette activité à la flotte commerciale anglaise. Ce sera l’objet de la première guerre anglo-hollandaise.
Cette politique a été maintenue pendant les périodes royales des Tudor et des Stuart. Si le contrôle royal direct sur l’économie nationale n’était pas aussi fort qu’en France, réduit par le principe de la Common law[24], son action indirecte par les lois du Parlement fournissait aux commerçants anglais des moyens d’action et de pression qui leur a permis de dominer progressivement les mers, souvent avec l’aide de moyens militaires destinés à contraindre les fournisseurs et clients étrangers. La politique coloniale avait pour objectif de garantir de nouveaux marchés et d’opérer des importations des matières premières nécessaires à la production anglaise. C’est ainsi que le coton, qui était déjà travaillé en Inde, a été réservé aux manufactures anglaises, conduisant à l’appauvrissement des régions indiennes anciennement productrices. La colonisation a permis à Londres de contrôler leur production, en les autorisant à produire des matières premières, mais à faire du commerce uniquement avec la métropole, pour tous les produits qui ne pouvaient pas être fabriqués en Angleterre[25]. L’industrialisation anglaise profite des ressources extérieures en provenance des colonies, soumises à un échange inégal avec la métropole. La main d’œuvre est sous-payée et l’esclavage sévit encore. Dans ces conditions, l’industrie anglaise connaît un avantage économique considérable dans tous les domaines[26].
Dans ce contexte de protection stratégique, à la fois commerciale et militaire, l’Angleterre dispose au XVIIIe siècle, de la plus grande flotte commerciale mondiale, dominant ainsi le rival hollandais sur les réseaux maritimes commerciaux après quatre guerres anglo-hollandaises, et de la plus grande puissance militaire sur les mers et les océans.
Les interactions entre guerre et économie produisent une dynamique favorable à la fois à la puissance militaire et à la richesse nationale. Certes, les conquêtes accroissent les richesses, et les richesses accroissent les opportunités de conquêtes, mais le système mercantiliste repose aussi sur des mécanismes plus subtils. Par exemple, les monopoles accordés aux compagnies nationales pour le commerce avec les colonies (comme le Navigation Act de Cromwell) permettent l’expansion de la flotte marchande du pays, et réduisent les opportunités de construction rentable de navires pour les pays adverses. Le commerce soutenu par une forte armée en ces temps de pirates et surtout de corsaires permet donc la maîtrise des mers et inversement. En somme, le mercantilisme anglais est fondé sur la protection des industries nationales par des taxes et des droits de douane élevés, par la mise en place de monopoles et privilèges réservés aux compagnies maritimes nationales, par l’essor de la construction navale et une politique coloniale fondée sur une forme de préférence impériale avantageant les activités économiques de la métropole au détriment de celles des colonies. L’empire britannique, après avoir réussi son industrialisation, devient l’économie dominante et elle a construit un Commonwealth au contenu très diversifié, selon des modalités qui mettent en évidence un plus grand respect pour les colonies de population à peau blanche que pour les autres. Plus tard, l’Australie, les Etats-Unis et le Canada obtinrent même des revenus par habitants supérieurs à ceux de la métropole. Ce qui n’était vraiment pas le cas pour les autres colonies.
« La guerre est le père de toutes choses et de toutes choses il est roi », affirmait Héraclite (l’obscur) au Ve siècle avant JC. Les contradictions, les querelles et les conflits sont innés à la vie sur Terre, car le logos (tout est un) inclut le monde humain et le monde naturel, il n’y a pas de séparation entre la cosmologie, la politique ou la vie sociale. Le polemos (guerre, conflit, querelle, discorde, différends) est universel. L’harmonie naît de la confrontation et de l’ajustement des contraires, du principe de mouvement et de génération de toutes choses. La paix est discorde, comme la justice, car elles impliquent nécessairement leur contraire, la guerre et l’injustice. Ce qui est contraire est utile. « Il faut savoir que la guerre est universelle, et la joute justice, et que, engendrées, toutes choses le sont par la joute, et par elle nécessitées »[5]. Si l’on suit la pensée d’Héraclite, la guerre et l’économie (terme conceptualisé par Xénophon, un élève de Socrate, donc postérieur à l’analyse d’Héraclite) sont donc étroitement associées. Chez les Grecs, l’économie (qui est accusée d’amoralité et d’égoïsme) est un sous ensemble de l’organisation de la cité, qui n’est pas celui qui porte les plus belles valeurs.
Platon (428-347 av. JC)[6] va définir sa société communiste sur la base de la reconnaissance de trois classes, d’abord, celle des agriculteurs, commerçants, artisans, puis celle les guerriers, enfin celle des chefs, ceux qui dirigent l’ensemble de la société. C’est une question de statut, lequel n’implique nullement un confort matériel différent, car le partage des biens, l’application de la morale et de la justice, l’égalité des fortunes et l’encadrement du marché par l’Etat sont les règles centrales de la cité idéale qui comprend 5040 citoyens. L’égalité de traitement économique et juridique est un principe de base. Il s’agira d’organiser la population et de la contrôler (eugénisme, droit d’ainesse, droit d’obtenir un enfant en cas d’infertilité). De fait, Platon ne mentionne pas les esclaves, pourtant très nombreux, ni les enfants, ni ceux qui n’ont pas le statut de citoyen[7]. Or, la grande partie de l’activité économique était assurée par les esclaves. Dans sa pensée originelle, l’esclavage n’existait pas dans la Cité car les citoyens, en fonction de leurs aptitudes pouvaient assurer l’ensemble des activités satisfaisant les besoins particuliers et collectifs des citoyens. Plus tard (Les Lois)[8], il n’abordera pas la question de la même manière et il acceptera l’idée que l’esclavage peut être une solution économique à la vie collective. Il évite d’aborder la question du travail des esclaves dans la production des ressources au profit du bon fonctionnement de la Cité, et la répartition inégalitaire qu’ils reçoivent en échange au bénéfice des citoyens.
Au regard des pays étrangers, il distingue la guerre avec les Barbares, des conflits et dissensions entre cités grecques, dont les citoyens ne peuvent être réduits en esclavage. Sa société communiste renie la démocratie athénienne, laquelle donne la victoire aux citoyens incapables de gouverner et de maintenir le fonctionnement de la Cité idéale. En outre, l’excès de liberté dans un régime démocratique aboutit à accorder aux étrangers quasiment autant de droits qu’aux citoyens, avec la tentation inhérente démagogique de supprimer l’esclavage. Les gardiens de la société, les chefs, doivent posséder ou acquérir des vertus collectives suffisantes et spécifiques pour conduire à l’harmonie collective[9]. Les guerriers et les chefs doivent garder leurs vertus morales, donc ils ne doivent avoir aucun contact avec les affaires, nécessairement corruptrices, d’argent et de négoce. La justice sociale est fondée sur le mérite. Il imagine une cité parfaite qui repose sur le partage des biens (« communisme » de Platon, sans propriété privée), la morale et la justice. Dans la cité réelle, Platon insiste sur la nécessité d’établir l’égalité des fortunes et de corriger les inégalités par la redistribution car les non possédants sont une perpétuelle source de révolution. En fait, il recherche l’efficacité et non la réelle égalité.
La recherche d’un système politique idéal suppose l’harmonisation de la Société (la Cité) et de son contenu (l’individu). Platon décrit longuement les gardiens de la Cité et les vertus qu’ils devraient posséder. Cette conception platonicienne conduit à une hiérarchie principalement définie par les héritages. La Cité n’est pas fondée sur un consensus des citoyens, elle est imposée par le ou les chefs qui défendent la raison et la vérité dans le cadre complémentaire d’une sacralisation religieuse et du refus d’expression des inimitiés, notamment envers les autres cités grecques. Elle interdit l’initiative individuelle, promeut la censure, rigidifie l’éducation et l’innovation, contrôle et distingue la procréation de l’amour, établit des règles restrictives et conduit à un contrôle social qui pourrait s’apparenter à une forme de totalitarisme. Platon définit un mode quasi autarcique dans lequel toute évolution est jugée décadente et la guerre offensive condamnée.
Aristote va critiquer les constitutions platoniciennes de la République et des Lois, jugées contradictoires et incompatibles avec le monde humain tel qu’il existe. Pour Aristote, le monde est fait de profonds changements, lesquels ne peuvent pas toujours être maitrisés par les hommes. Il n’y a pas de modèle idéal, seule l’expérience peut fournir des informations utiles pour l’avenir[10]. Aristote définit les conditions naturelles de la vie politique et sociale, avec des règles claires de rapport de rangs, le mari et la femme, les parents et les enfants, mais aussi entre le maître et l’esclave. Chez l’homme le courage est une vertu de commandement, chez la femme une vertu de subordination. Le bonheur suppose que l’individu dispose, privativement, de biens matériels. La propriété privée est pour lui synonyme de paix sociale car les hommes ne prennent pas soin de ce qui ne leur appartient pas directement. Aristote opère également une distinction entre l’économie (qui signifie l’autoconsommation, et donc le travail directement pour se nourrir) de la chrématistique (l’acquisition de richesses, et donc la consommation). Il y a une façon naturelle d’acquérir des biens : c’est l’agriculture, la chasse, et la pêche car ces dons de la nature on été fait offerts à l’utilisation et à la consommation des l’homme. En revanche, le commerce est une activité non naturelle elle est donc condamnable. Toutes les activités économiques dépendent principalement du résultat du travail ; or, le travail est incompatible avec le véritable objet de l’homme. Pour dénouer cette contradiction, Aristote fait appel à l’esclavagisme, lequel est justifié par l’infériorité naturelle de certains hommes et populations. L’activité économique a besoin de la subordination de esclaves, mais aussi des femmes. Les Grecs avaient trois manières de s’approvisionner en esclaves : le commerce, la piraterie, mais aussi la guerre avec son butin de prisonniers.
Cependant, il faut lutter contre les tendances à l’inimitié à l’égard des autres et la guerre doit être évitée. Certes, la désignation d’un ennemi externe est parfois nécessaire pour l’unité de la Cité, mais elle ne doit pas conduire à une lutte acharnée conduisant à des destructions dommageables et à des résultats capables de remettre en cause le principe d’autarcie. La guerre n’est cependant pas écartée, notamment si elle est nécessaire pour recouvrer des valeurs collectives dans une autarcie altérée. Qu’elle soit offensive ou défensive, elle est un moyen pour recouvrer la paix. Aristote n’engage pas la Cité à développer des conquêtes, mais il souhaite aussi que celle-ci se protège par les armes. Il réclame une utilisation mesurée et opportune de la puissance militaire. La guerre est fondamentalement un acte économique particulier de prédation et d’investissement avec la main d’œuvre des esclaves. Guerre et économie sont étroitement associés. Pour autant, il considère que l’objet de la guerre, c’est la paix. Indépendamment de la complexité de l’histoire de l’humanité, la guerre a toujours servi la prédation du vainqueur, laquelle ne se limitait pas aux biens matériels, mais aussi à la mise en esclavage des vaincus. C’était un moyen de production essentiel, pour permettre aux citoyens de travailler leurs compétences et leur rôle dans la société. L’esclavage est sans doute l’une des plus vieilles institutions de l’humanité. Privé de son identité, l’esclave était doté d’un statut juridique spécifique dans la société ; il était privé de son identité et de sa liberté, selon des règles différenciées dans le temps et dans l’espace.
Dès l’origine, la chrétienté ne s’oppose pas à l’esclavage[11]. Pour Saint Paul, tous les baptisés, qu’ils soient Grecs ou Juifs, hommes libres ou esclaves, ne forment qu’un seul corps nourris par le même esprit de Dieu. Il recommande aux esclaves l’obéissance à leurs maîtres et leur rappelle que le Royaume des Cieux leur est ouvert. Les êtres humains restent libres dans leur soumission à Dieu. Pendant tout le Moyen-Age, l’esclavage sera accepté par l’Eglise, comme un élément incontournable du destin des hommes. La guerre elle-même n’est pas rejetée, elle est même parfois revendiquée.
Concernant la guerre elle-même, pour Saint Augustin (354-430, après JC.), « on ne cherche pas la paix pour faire la guerre, mais on fait la guerre pour obtenir la paix. Sois donc pacifique en combattant, afin de conduire ceux que tu connais au bienfait de la paix, en remportant sur eux la victoire ». Cette idée sera poursuivie par Saint Thomas d’Aquin (1224-1274) pour lequel « une guerre est juste si sa cause est juste et qu’elle poursuit le Bien Commun ». De même, l’économie doit répondre aux principes religieux. Thomas d’Aquin va défendre la notion du « juste prix » et de l’interdiction du taux d’intérêt (car le temps appartient à Dieu, le taux d’intérêt est le pris du temps et on ne peut pas vendre ce qui ne nous appartient pas). Il va défendre le principe de la propriété, mais il est obligé de dire que se servir d’un bien d’autrui que l’on a dérobé dans un cas d’extrême nécessité n’est pas un vol à proprement parler. En reprenant la pensée aristotélicienne, que la propriété privée seule permet de mettre de l’ordre, car chacun sait ce qu’il doit faire. En revanche, l’accumulation des richesses ne doit pas être une fin en soi L’objectif est de trouver un système économique compatible avec les doctrines chrétiennes de piété et justice. L’esclavage comme ressource humaine n’est pas condamnable, il a été institué en punition des péchés par Dieu tout-puissant. Il faudra attendre la fin du XIXe siècle (1888), pour que le Pape Léon III, favorable aux mouvements anti-esclavagistes, condamne l’esclavage[12].
Ces idées concernant la guerre seront clairement prolongées par Macchiavel (1513)[13], pour lequel, une guerre est juste lorsqu’elle est nécessaire. A qui ? Au Prince. C’est une pensée nouvelle, qui annonce le mercantilisme, la première théorie économique conçue telle quelle, sans référence nécessaire aux valeurs religieuses. La guerre est au cœur de l’action gouvernementale, la stabilité politique est plus essentielle que l’enrichissement national. Les forces armées assurent la supériorité de l’Etat et toutes les lois et règles morales ne peuvent survivre sans le soutien d’une force militaire puissante. L’économie c’est l’art d’enrichir le Prince et le royaume, dans une optique de puissance, c’est-à-dire une optique militaire. La force militaire est plus importante que la richesse des Nations, même si la guerre est un facteur essentiel de la redistribution des richesses dans le monde[14]. La militarisation de la société est nécessaire à la fois pour gérer le pays, mais aussi pour maintenir la cohésion sociale. La guerre est un moyen d’achever les buts politiques et économiques du Prince. La force économique est utile pour disposer des moyens nécessaires pour gagner la guerre et assurer la toute puissance du Prince. L’objectif n’est pas l’amélioration de la situation économique et sociale des citoyens, il est dans la volonté de domination qui est inscrite dans la nature même de l’Etat. L’économie est un moyen, ce n’est pas le but ultime. Machiavel va inspirer les thèses mercantilistes.
Les phénomènes économiques sont alors conçus dans le cadre de l’Etat ; c’est une théorie d’économie politique laïque, qui souligne les rapports de force entre les Etats et leur volonté de s’enrichir, notamment par l’acquisition de l’or et la mise en place d’une organisation économique efficace, sans crainte d’utiliser des stratégies qui appauvrissent les Etats voisins.
Ces conceptions vont être battues en brèche avec les grandes découvertes et la Renaissance[15]. Le mercantilisme marque la fin de ces représentations ancestrales. Il apparaît dans un contexte intellectuel où l’humanité s’ouvre de nouveau aux sciences et conteste parfois les croyances défendues par l’Eglise (Copernic, Galilée).
Le mercantilisme
Jusqu’au XVIe siècle, la théorie économique tient peu de place, elle n’existe pas vraiment en tant que telle. L’émergence d’idées mercantilistes coïncide avec la montée en puissance des États nations. Au départ, le mercantilisme n’est pas un courant de pensée homogène, mais il va contribuer à débattre le l’organisation économique d’un pays dans le débat public. Il se caractérise par la course étatique à la richesse et à la puissance, par la recherche d’indépendance, voire d’autarcie, et la mise en place d’un processus plus ou moins sophistiqué de prédation. Les objectifs économiques portent sur la volonté des acteurs économiques de s’enrichir et sur la possession de stocks d’or comme expression de puissance et de la richesse du Prince, à l’intérieur et à l’extérieur du Royaume. L’Etat devient un acteur économique déterminant, qui peut encourager l’essor des activités de production, notamment manufacturières, Les politiques économiques proposées diffèrent en fonction de l’état des connaissances, mais aussi de l’histoire guerrière des Etats. Cependant, s’instaure une vision dynamique d’une action publique destinée, par tous les moyens, à donner les instruments de puissance au Prince. Afin de limiter la dépendance vis-à-vis des marchands étrangers, il est recommandé d’annexer les territoires qui fourniront les richesses dont la métropole ne dispose pas. Pour gagner la guerre économique, les mercantilistes préconisent l’expansion militaire, à la fois contre les Etats puissants qui contestent le pouvoir de l’Etat, mais aussi contre les territoires lointains qu’il convient de piller ou de coloniser.
Le mercantilisme n’est pas une théorie économique unifiée[16]. Les mercantilistes bullionistes développent leurs stocks de richesse pour le Prince, par le colonialisme, l’impérialisme et la prédation. Le « mercantilisme colbertien » propose l’autarcie comme principe, avec une dépendance limitée aux importations qui créent une dépendance économique de la Nation et l’essor des industries nationales et des exportations pour accroître le pouvoir royal. Enfin, le mercantilisme « anglais » croit d’abord à l’essor du commerce national, avec une flotte militaire et commerciale britannique dominante par rapport à la puissance hollandaise, grâce notamment aux guerres anglo-hollandaises. Le colonialisme est préconisé et institué pour réduire les dépendances économiques nationales et contraindre les Etats dominés à éviter toute concurrence avec les biens et services produits sur le sol de la métropole.
Les principes : L’argent fait le bonheur et la puissance des Princes
Certains mercantilistes conçoivent le système économique comme un jeu à somme nulle, où le gain réalisé par un agent se traduit par la perte pour les autres agents. Comme le dit à l’époque Jean Bodin : « Il n’y a personne qui gagne qu’un autre n’y perde » (Les Six livres de la République). De ce fait, toute politique économique bénéficiant à un groupe d’individus, étant par définition néfaste à un autre, l’économie intérieure n’a que très peu d’effet sur l’augmentation du bien-être social général. Et puisque le commerce intérieur n’augmente pas ou peu la richesse nationale, il est donc justifié et souhaitable de donner la priorité au commerce extérieur pour répondre à cet impératif.
Le rôle des États-nations va croissant. Durant cette période, d’importantes quantités d’or et d’argent affluent des colonies espagnoles du Nouveau Monde vers l’Europe. À l’origine, pour les auteurs bullionistes, tels que Jean Bodin ou Thomas Gresham , la richesse et le pouvoir de l’État sont mesurés par la quantité d’or qu’il possède. Chaque nation doit accroître son pouvoir en accroissant ses réserves d’or aux dépens des autres nations. La prospérité d’un État est censée être mesurée par la richesse accumulée par son gouvernement, sans référence au revenu national. Un pays riche est celui qui possède le plus d’argent et d’or. Cet intérêt pour les réserves d’or et d’argent s’explique en partie par l’importance de ces matières premières en temps de guerre. Les armées comprennent nombre de mercenaires qui sont payés en or. Ainsi le mercantiliste français Antoine de Montchrestien explique en 1615 : « Il est impossible de faire la guerre sans hommes, d’entretenir des hommes sans soldes, de fournir à leur solde sans tributs, de lever des tributs sans commerce. »[17]. L’Espagne et le Portugal, possesseurs des principales mines destinées à l’Europe, en ont prohibé l’exportation sous les peines les plus graves, ou l’ont assujettie à des droits énormes. Pour les autres pays, l’excédent commercial est l’objectif économique majeur, la principale méthode d’acquisition de ces matières premières. Il revient donc à l’État, en exportant davantage qu’il n’importe, de tout faire pour enregistrer une « balance du commerce » (ce qui correspond, de nos jours, à la balance commerciale) excédentaire, soit une entrée nette de richesses, traduites en or ou autres métaux précieux. Les « bullionistes » prescrivaient en outre la mise en place de taux d’intérêt élevés pour encourager les investisseurs à placer leur argent dans le pays.
Les mercantilistes recherchent le développement économique comme une opportunité pour enrichir l’Etat au moyen d’un commerce extérieur dégageant un solde positif grâce à des actions économiques et commerciales pertinentes des autorités publiques. L’Etat a la responsabilité d’accroître constamment la richesse nationale, grâce au protectionnisme, à l’innovation industrielle et commerciale, au soutien apporté à l’exportation et aux victoires militaires. Les relations économiques ne répondent pas à une politique de marché libre, elles sont souvent forcées. Alors que le stock de richesses est considéré comme relativement fixe, la seule façon d’accroître la richesse d’un pays ne peut se faire qu’au détriment d’un autre. Du XVIe au XVIIIème, les idées mercantilistes vont justifier l’exercice des rapports de force qui peuvent conduire à des conflits longs et à des guerres, lesquelles apportent parfois une solution à la question de la puissance économique relative des Etats. C’est l’essor du colonialisme et de l’impérialisme. De nombreuses guerres, dont les guerres anglo-hollandaises, franco-hollandaise, et franco-anglaise se déclenchent sur la base d’un « nationalisme économique » destiné à accroître la puissance du Prince.
Les Nations puissantes doivent s’emparer des territoires disposant de matières premières ou importateurs de produits nationaux afin de limiter la dépendance à l’égard d’un pays, qu’il soit puissant ou non. Il s’agit de vivre le plus possible en autarcie au regard des importations, mais aussi de produire plus que les besoins du pays pour exporter et accroître les stocks d’or du Prince. Les expéditions occidentales vont alors se développer dans le monde entier, avec la création de la Compagnie anglaise des Indes orientales par l’Angleterre (1600) puis la riposte des Provinces Unies avec la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (1602), la France réagit à son tour par la création de la compagnie française des Indes orientales (1664).
Le mercantilisme ibère, dit bullioniste
Le mercantilisme bullioniste, matrice originelle, considère que les métaux précieux (notamment l’or détenu en stock) représentent la
richesse
par excellence du fait de leur caractère impérissable. En 1503, la Casa de Contratación, un organisme chargé de réglementer le trafic entre l’Espagne et les nouvelles colonies, est créé à Séville. Il est chargé de prélever une taxe correspondant au cinquième du commerce avec les Indes occidentales (Quinto Real) et de collecter les informations sur les découvertes des explorateurs.
Sur cette base, l’Etat puissant doit empêcher les métaux précieux à sortir de son territoire et, au contraire, il doit en accroître la quantité disponible à l’intérieur du Royaume à la disposition du Prince. Sous les règnes de Charles Quint et de Philippe II, l’Espagne va s’engager résolument dans les actions colonialistes et impérialistes. Dans ce contexte de pensée, l’Espagne va partir à la conquête de l’Amérique (aujourd’hui appelée latine). Dès le début, la conquête s’inscrit violemment dans la volonté de prédation des terres et des biens des autochtones. La maison royale accorde aux conquistadores le droit de s’approprier les terres en échange de 20 % des butins et trésors ainsi obtenus[18]. La supériorité technologique de l’offensive, ainsi que les maladies importées d’Europe, les croyances (comme le mythe de Quetzalcoatl) ou les divisions des Amérindiens ont permis des conquêtes rapides[19], favorisant un esprit de prédation violent. Dès le départ, Christophe Colomb a mesuré la naïveté des autochtones, qu’il décrit sans armes, ne connaissant pas le fer, faciles à asservir et à en faire de bons serviteurs. De fait, les conquêtes furent facilitées par les stratégies militaires et psychologiques grâce à l’aide des hostilités entre Amérindiens, eux-mêmes en conflits internes ou en révoltes contre leurs dirigeants jugés trop cruels. En 1521, trois ans après son arrivée, Cortès devient gouverneur de l’empire Aztèque. Dix ans plus tard, grâce à un coup d’audace et à la traitrise, Pizzaro s’empare de l’empire des Incas. Les Conquistadors s’approprient les terres et les mines, et ils pillent les richesses des autochtones. L’or des Antilles, puis du Pérou, enfin de Colombie, et l’argent du Mexique et de la Bolivie furent ensuite importés en Espagne. Les mines fournissent rapidement 80 % de la production mondiale d’argent (dont 1/5e pour le Roi).
A la Renaissance, l’âge d’or espagnol, sa puissance apparente naît de l’abondance de métaux précieux importés et entassés. Disposant des principales mines qui fournissent ces métaux à l’Europe, l’Etat va contrôler le commerce[20], et en limiter, voire prohiber, l’exportation, en instituant des droits de taxes douanières considérables. Dans ces conditions, les promoteurs des voyages transatlantiques, souvent nobles, vont s’enrichir rapidement et les inégalités de ressources et de fortune à l’intérieur du pays vont alors croître considérablement. Les grandes propriétés agricoles (latifundia) vont se développer, surtout à partir du XVIIe siècle, tournée vers une production extensive, sans recherche d’exploitation optimale, au regard des revenus conséquents de leurs propriétaires, peu incités à s’engager dans un système productif agricole et industriel, plus aléatoire que le pillage des ressources naturelles de l’Amérique. Entre la métropole et les colonies, les rapports sont de moins en moins harmonieux, car ces dernières se voient interdire de commercer avec d’autres Nations ou de créer des industries susceptibles de concurrencer les produits espagnols. Le travail forcé est de moins en moins admis par les autochtones et les mines progressivement s’épuisent, ce qui conduit la couronne d’Espagne à augmenter les taxes diverses, conduisant progressivement à une récession économique de ces colonies. L’Espagne va s’appauvrir, avec les migrations de forces vives vers l’Amérique latine, mais aussi avec la thésaurisation des métaux précieux, qui empêche l’investissement agricole et industriel.
L’exploitation des Amérindiens est violente. Un demi siècle, après leur défaite, il ne reste plus qu’un million d’Incas, sur 12 millions. De manière plus générale, la population amérindienne s’effondre, passant d’environ 80 millions d’habitants au début du XVIe siècle à environ 12 millions cent ans plus tard, les populations étant laminées par les guerres, les conditions de travail et les maladies importées par les colons. Pourtant ne cédule royale de 1503, reconnaissait la liberté des Indiens et leur capacité à recevoir un salaire de leurs maîtres. Cependant, le système de « l’encomienda » va s’étendre sur l’ensemble des territoires occupés par l’Espagne et s’écarter des règles de la cédule royale. C’est un droit de seigneurie (tribut de métaux précieux, corvées, travail forcé, en échange de l’évangélisation et de la protection de leurs maîtres) sur les communautés indiennes qui ressemblent de fait, à une situation d’esclavage. Dix années plus tard, les lois de Burgos imposent aux Espagnols de meilleures conditions de travail pour leurs Indiens, mais ni la loi, ni la bulle du pape Paul III qui condamne l’esclavage des Indiens en affirmant leurs droits à la liberté et à la propriété, ne furent respectées. Un demi siècle plus tard, les exactions des conquistadors espagnols, sans cesse révélées par maints humanistes, sont révélées par Bartolomé de Las Casas lui-même ancien « encommendero ». Charles Quint prendra les Indiens sous la protection de la couronne d’Espagne, mais la violence des « encommenderos » ne permit guère l’application de cette règle. En 1550, lors de la Controverse de Valladolid qui l’oppose au théologien Juan Ginés de Sepúlveda (lequel, reprenant les arguments d’Aristote, considère que la conquête institutionnelle est un devoir moral au regard de l’immaturité, l’amoralité et l’idolâtrie des autochtones) il parvient à imposer l’idée selon laquelle les autochtones ont une âme et sont donc sujets de droit. Pour Las Casas, toutes les sociétés sont humaines et dignes d’exister et il est outrageux de vouloir convertir par la force, et non par l’évangile. Pour de Sepùlveda, les sacrifices humains et l’anthropophagie témoignent de l’arriération de ces civilisations et explique leur mise en tutelle afin de les empêcher à violer les lois de la morale. En outre, le Christ a donné aux chrétiens l’ordre d’évangéliser le monde. La controverse est restée célèbre, mais aussi elle a eu pour conséquence de poser la question de l’esclavage et de l’exploitation des plus faibles communautés, au regard du respect de la nature humaine.
L’importation d’or et d’argent du Nouveau Monde stimule la croissance immédiate, mais elle provoque aussi l’apparition d’une forte inflation. Les nouveaux riches sont aussi friands des produits importés plus fastueux. Les finances royales sont dilapidées par les guerres et le faste impérial, ce qui conduit le roi à souscrire des prêts à taux élevés auprès de banquiers italiens et allemands et à obliger leurs riches sujets à souscrire des obligations d’Etat à faible rendement. L’Espagne va connaître un lent mais solide déclin dès le début du XVIIe siècle, malgré (ou à cause de) la domination militaire en Europe et du développement de colonies de peuplement. L’accumulation de métaux précieux, souvent dépensés par les plus riches pour honorer les dettes envers les fournisseurs et banquiers d’Allemagne ou d’Italie, ne favorise pas le développement de la métropole, elle constitue plutôt un accélérateur à l’activité économique et préindustrielle des pays voisins. Cette politique non seulement conduit à un manque d’investissement sur le territoire national qui se conjugue à une forte inflation, mais conduit aussi au dépeuplement de ses forces vives au bénéfice du Nouveau Monde. Le choix d’une domination à la fois outre-mer, en Europe et contre les protestants engendre de coûteuses dépenses militaires. En 1627, l’Etat espagnol ne peut éviter la banqueroute[21]. Incapable de réduire les dépenses somptuaires, de mettre à contribution les plus riches et à stimuler l’économie nationale (du fait des facteurs de thésaurisation), la couronne royale a plusieurs fois été en cessation de paiement, ce qui n’a fait qu’accroître sa dette et le coût de la dette avec les banques étrangères. L’Espagne n’était plus maîtresse de son destin économique et financier. Plus grande puissance coloniale mondiale au XVIe siècle, avec son invincible armada, l’Espagne va connaître progressivement un déclin marqué et constater que les puissances anglaises, française ou hollandaises la dépasser économiquement, technologiquement, militairement.
Le mercantilisme français
En France, le mercantilisme voit le jour au début du XVIe siècle, peu de temps après l’affermissement de la monarchie. En 1539, un décret royal interdit l’importation de marchandises à base de laine d’’Espagne et d’une partie de la Flandre. L’année suivante, des restrictions sont imposées à l’exportation d’or. Des mesures protectionnistes se multiplient tout au long du siècle. Au début du XVIIe siècle, Antoine de Montchrestien a conçu le premier manuel d’économie politique, un néologisme d’alors, titre de son livre principal. Il se propose de construire une réflexion économique destinée à comprendre les processus de la production nationale et de la distribution des richesses. Il traite recommande l’intervention économique soutenue de l’Etat, d’abord pour créer des manufactures, développer le commerce et l’industrie à côté de l’agriculture et enfin pour instituer une forme de travail obligatoire et réglementer les professions. L’objectif est d’engager le développement des activités économiques de la Nation et de se protéger, par les droits de douane, de la concurrence des produits étrangers, dans l’intérêt bien compris de l’enrichissement de l’Etat. A l’intérieur du Royaume, il préconise la concurrence intérieure pour stimuler l’industrie, mais il ne l’accepte pas face aux entreprises étrangères. Celles-ci n’ont pour but que d’affaiblir la Nation, la rendre dépendante et lui prendre ses richesses. Son protectionnisme est institué sur les biens produits en France, mais il peut admettre le libre-échange pour les biens pour lesquels la France n’a pas de disponibilités en termes de production ou de ressources naturelles.
Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), Contrôleur général des finances pendant dix-huit ans (1665-1683), est le principal instigateur des idées mercantilistes en France, ce qui conduit certains à parler de colbertisme pour désigner le mercantilisme français. Il fait de l’État un promoteur actif dans la sphère du Commerce, mais aussi de l’Industrie. Sous sa direction, le gouvernement français s’implique de façon importante dans l’économie afin d’accroître la production nationale, mais aussi les exportations, en créant des Manufactures, voire des « villages-usines » destinées à l’exportation de produits de luxe. Il s’agit d’être concurrentiel, dominant. Dans sa conception, la puissance du Prince constitue l’objectif principal de toutes les actions politiques et économiques.
Afin de maximiser la production, l’application de la loi d’airain est recommandée. Il s’agit de fournir un revenu minimum, celui qui permet la simple subsistance des agriculteurs et des ouvriers. Les travailleurs sont considérés alors comme une forme de capital humain qu’il faut savoir maintenir en vie sans lui offrir d’autres objectifs qu’un travail de survie. Un revenu supérieur des « travailleurs » conduit nécessairement à une recherche de vie sociale plus élaborée, une aspiration vers du temps libre ou d’éducation susceptible de développer à la fois la paresse et des contestations, que la précarité de la situation sociétale leur interdit. En France, les enfants âgés de six ans travaillaient dans les manufactures d’État et l’esclavage dans les colonies est maintenu.
Colbert fait construire un important réseau de routes et canaux pour abaisser les obstacles au commerce et il réduit les droits de douane intérieurs. L’Etat développe des monopoles nationaux et contrôle les propriétaires privés des moyens de production. Les compagnies de commerce sont considérées comme des armées du roi, qui doivent vaincre les « armées économiques étrangères ». Dans ce contexte, les manufactures ne sont que des fournisseurs de produits, qui permettent d’assurer la dépendance des pays étrangers aux productions françaises et d’accroître le trésor de l’Etat. Les politiques menées par Colbert ont été dans l’ensemble efficaces, et elles ont permis à l’industrie et à l’économie françaises de croître considérablement durant cette période, faisant de la France une des plus grandes puissances européennes. Cependant, sa politique restrictive concernant les échanges internationaux et la faiblesse de la demande intérieure consécutive aux conditions de travail déplorables du pays ne permettent guère aux citoyens d’améliorer leur situation, dans une période où les Rois continuent à exercer à grand frais leur « droit de guerre ». A la mort de Colbert, l’Angleterre et la Hollande devancent toujours la France. Adam Smith contestera fortement l’action de Colbert en considérant que l’organisation d’une économie au seul service du Prince ne permet pas le développement économique et nuit, à terme, à la puissance de l’Etat.
Le mercantilisme anglais
Les Anglais croient à l’essor de l’industrie et au commerce international comme vecteur de puissance de l’Etat. Le commerce extérieur est une source abondante de richesse pour un pays à condition de dégager un excédent de la balance commerciale, laquelle suppose d’investir dans des activités économiques à forts rendements. La stratégie industrielle de l’Angleterre est claire. Dès 1485, selon la formule d’Henry VII, il s’agit « d’exporter des biens manufacturés et d’importer des produits bruts », cette phrase résumant l’essentiel de ce que sera la politique industrielle anglaise et sa future prospérité. Dans ce contexte, le mercantilisme anglais prône un contrôle du commerce international en vue d’encourager les exportations par des subventions et de limiter les importations par la mise en œuvre de taxes. Dans ces conditions, l’économie nationale est privilégiée, non pas seulement par une action directe sur la production elle-même, mais par des règles et lois qui privilégient et soutiennent les investisseurs nationaux, accompagnés dans leurs relations commerciales avec leurs clients et fournisseurs par la puissante Royal Navy. La compétition économique dans le domaine des ressources de matières premières est fortement réduite par l’interdiction d’exportation de certaines d’entre elles. Au plan intérieur, contrairement aux mercantilistes espagnols, l’idée principale était l’utilisation de toutes les terres pour l’agriculture, en vue d’améliorer l’autonomie alimentaire du pays et d’optimiser la production nationale.
La promulgation de règlements et de législations mercantilistes a surtout été engagée au milieu du XVIIe siècle, engagée, notamment pendant la période du « Long Parliament » (1640-1660)[22] de Cromwell. Un embargo a d’abord été décidé à l’encontre de trois colonies encore sous contrôle royal, la Barbade, les Bermudes et la Virginie. Il a ensuite été décidé de collecter une taxe de 15% sur les navires marchands battant pavillon anglais, destinée à la protection des convois nécessaires au commerce anglais et pour renforcer la marine de guerre. La loi sur la navigation (Navigation Act, 1651)[23] mise en place par le gouvernement anglais, interdit aux commerçants étrangers de faire du commerce intérieur en Angleterre, colonies comprises. Cette décision va conduire au développement de la construction navale nationale, un secteur particulièrement intéressant pour engager un processus d’innovation favorable à l’émergence structurelle d’un développement économique national. La Barbade, gérée par l’opposition royaliste, était un pays producteur opulent de sucre. Il s’agissait donc d’interdire son exportation par les navires hollandais et de réserver cette activité à la flotte commerciale anglaise. Ce sera l’objet de la première guerre anglo-hollandaise.
Cette politique a été maintenue pendant les périodes royales des Tudor et des Stuart. Si le contrôle royal direct sur l’économie nationale n’était pas aussi fort qu’en France, réduit par le principe de la Common law[24], son action indirecte par les lois du Parlement fournissait aux commerçants anglais des moyens d’action et de pression qui leur a permis de dominer progressivement les mers, souvent avec l’aide de moyens militaires destinés à contraindre les fournisseurs et clients étrangers. La politique coloniale avait pour objectif de garantir de nouveaux marchés et d’opérer des importations des matières premières nécessaires à la production anglaise. C’est ainsi que le coton, qui était déjà travaillé en Inde, a été réservé aux manufactures anglaises, conduisant à l’appauvrissement des régions indiennes anciennement productrices. La colonisation a permis à Londres de contrôler leur production, en les autorisant à produire des matières premières, mais à faire du commerce uniquement avec la métropole, pour tous les produits qui ne pouvaient pas être fabriqués en Angleterre[25]. L’industrialisation anglaise profite des ressources extérieures en provenance des colonies, soumises à un échange inégal avec la métropole. La main d’œuvre est sous-payée et l’esclavage sévit encore. Dans ces conditions, l’industrie anglaise connaît un avantage économique considérable dans tous les domaines[26].
Dans ce contexte de protection stratégique, à la fois commerciale et militaire, l’Angleterre dispose au XVIIIe siècle, de la plus grande flotte commerciale mondiale, dominant ainsi le rival hollandais sur les réseaux maritimes commerciaux après quatre guerres anglo-hollandaises, et de la plus grande puissance militaire sur les mers et les océans.
Les interactions entre guerre et économie produisent une dynamique favorable à la fois à la puissance militaire et à la richesse nationale. Certes, les conquêtes accroissent les richesses, et les richesses accroissent les opportunités de conquêtes, mais le système mercantiliste repose aussi sur des mécanismes plus subtils. Par exemple, les monopoles accordés aux compagnies nationales pour le commerce avec les colonies (comme le Navigation Act de Cromwell) permettent l’expansion de la flotte marchande du pays, et réduisent les opportunités de construction rentable de navires pour les pays adverses. Le commerce soutenu par une forte armée en ces temps de pirates et surtout de corsaires permet donc la maîtrise des mers et inversement. En somme, le mercantilisme anglais est fondé sur la protection des industries nationales par des taxes et des droits de douane élevés, par la mise en place de monopoles et privilèges réservés aux compagnies maritimes nationales, par l’essor de la construction navale et une politique coloniale fondée sur une forme de préférence impériale avantageant les activités économiques de la métropole au détriment de celles des colonies. L’empire britannique, après avoir réussi son industrialisation, devient l’économie dominante et elle a construit un Commonwealth au contenu très diversifié, selon des modalités qui mettent en évidence un plus grand respect pour les colonies de population à peau blanche que pour les autres. Plus tard, l’Australie, les Etats-Unis et le Canada obtinrent même des revenus par habitants supérieurs à ceux de la métropole. Ce qui n’était vraiment pas le cas pour les autres colonies.
Les critiques progressives
Deux formes de critiques sont formulées aux XVIIe et XVIIIe siècles contre les politiques mercantilistes, les premières contestant les politiques économiques conduites, les autres situant la guerre dans un contexte où l’économie ne joue pas un rôle central dans les décisions de l’Etat.
La contestation des théories mercantilistes
C’est dans ce contexte de guerre commerciale que le juriste néerlandais Hugo Grotius (1583-1645) est à l’origine de l’idée d’un droit international, notamment en formulant le principe selon lequel les océans et mers constituent un espace territorial commun qui donne toute liberté aux Nations de l’utiliser pour le commerce maritime. Les Etats appartiennent à une société internationale, laquelle a amassé au fil du temps un système de normes, lequel est fondé sur des habitudes de comportement entre les Nations et non à des lois. Il conteste la mise en place de la « loi du plus fort ». Certes, les Etats s’intéressent d’abord à leurs propres intérêts et à ceux de leurs sujets, mais dans l’espace de la Chrétienté la débauche de guerre des Etats européens les rapproche des nations barbares, sans aucune référence aux droits humains et au droit divin. Certes les causes des guerres sont nombreuses, notamment la propriété, les contrats, les successions au trône, les alliances et la puissance, mais il faut définir des règles qui pourraient conduire à limiter l’usage des guerres par les Rois.
Le philosophe historien David Hume (1711-1776), au début de la montée en puissance et de la stabilité politique de la Grande-Bretagne, souligne les évolutions positives du Parlement dans sa relation avec le souverain, l’importance des questions religieuses et de la révolution financière, facteurs jugés essentiels au développement économique. Il prône la modération comme fondement de la stabilité politique et des libertés. David Hume s’attaquera directement à la théorie mercantiliste en tentant d’en montrer les failles théoriques. Selon les mercantilistes, le commerce international doit servir à remplir les caisses de l’État. Il faut donc que la balance commerciale soit excédentaire. David Hume tente de démontrer que sur le long terme une balance commerciale est toujours globalement équilibrée. Ainsi, lorsqu’une nation a une balance excédentaire, la forte rentrée de monnaie provoque l’inflation et donc une perte de compétitivité qui se traduit par une balance commerciale devenant déficitaire. La guerre économique livrée par les mercantilistes relève donc pour lui d’une erreur théorique.
David Hume se propose d’analyser l’histoire de l’Angleterre, notamment depuis la République de Cromwell. La République a été officiellement établie en février 1649 (1649-1653). Le Parlement était très affaibli et divisé face à l’armée. Après l’exécution du Roi, Cromwell se présente comme l’unique source de stabilité dans le pays, le seul moyen d’éviter le déclenchement d’une autre guerre civile. Les victoires obtenues par l’armée en Irlande, en Ecosse et la soumission des colonies en Amérique avaient eu comme résultat le renforcement du pouvoir militaire plutôt que celui du parlement qui avait pourtant engagé ces guerres. La fin du conflit entre le parlement et l’armée aboutit à la dissolution de la République et à l’avènement du Protectorat. Dans ce contexte, après avoir sollicité une coalition, puis une alliance défensive, une guerre contre la Hollande apparût comme un dérivatif acceptable aux conflits internes. Hume ramène les choix de la politique étrangère à la logique des rapports de forces internes. Le conflit fut précédé par la promulgation du célèbre Acte de Navigation d’octobre 1651, par lequel les Anglais avaient l’intention de protéger leurs intérêts commerciaux et industriels. Historiquement la Hollande était le pays du commerce, sa richesse dépendait de sa capacité de transporter les marchandises d’un lieu à un autre à travers le globe. Une telle activité demandait avant tout un état de paix. Les avantages de la guerre dépassèrent indirectement les pertes, du fait des pertes du commerce maritime subies par les Hollandais, du contenu du traité de paix que ces derniers furent obligés de signer, et du prestige international acquis par l’Angleterre. Hume ne nie pas les effets économiquement positifs de la guerre.
Pour les autres guerres, la monarchie étant restaurée depuis le printemps 1660, avec la certitude de la stabilité politique, le Parlement considéra les torts provoqués par les Hollandais au développement du commerce anglais. Il lui a semblé qu’il fallait alors défendre les intérêts de la Couronne, même si les hostilités étaient plutôt déclenchées par les britanniques, notamment le long de la côte occidentale africaine et en Amérique du nord. Il s’agissait clairement d’une guerre d’intérêt économique. L’Angleterre était tournée vers la mer. Disposant d’un pouvoir naval supérieur à celui des Hollandais, la guerre semblait une opération économiquement avantageuse, à condition de la gagner. Pour Hume, la question est de savoir ce qui est juste pour le bien-être d’un Etat, un choix qui appartient à la sphère politique, avec le soutien des forces armées dans le cas d’un conflit militaire. La décision de la guerre est dangereuse, car le résultat n’est pas nécessairement celui qui est espéré, tout en faisant augmenter la dette publique, ce qui constitue le meilleur moyen pour affaiblir la puissance de l’Etat. La guerre ne constitue pas la solution à tous les problèmes politiques, même si elle ravive le patriotisme des citoyens ainsi que l’unité nationale. C’est toujours une défaite par rapport à l’homme civilisé. En outre, l’activité commerciale internationale provoque des conflits économiques graves entre les Etats. Il serait préférable de trouver des solutions communes qui agréeraient aux deux Etats, car le conflit n’est pas le meilleur moyen pour le progrès économique. Il faut battre ses concurrents directement sur les marchés internationaux, grâce à une économie prospère. Dans ces guerres avec la Hollande, l’Angleterre s’est isolée et le Traité de Breda ne lui offrit, in fine, que le territoire de New York. Enfin, elle a oublié son ennemi naturel, la France, son vrai rival avec sa population, son papisme et la capacité de ce pays de modifier l’équilibre européen (balance of power). Pour Hume, l’alliance de Londres avec la France lors de la troisième guerre contre la Hollande était alors une erreur politique.
L’économie politique n’est pas le facteur déterminant de la guerre
La théorie de Hobbes (1588-1679)[27], dans le Léviathan (1651), est intéressante de ce point de vue : si l’état de nature (caractérisé par l’absence de tout pouvoir politique et de lois) est un état de guerre (chacun contre chacun, l’homme est un loup pour l’homme, dans un système d’égalité des chances), les hommes peuvent en sortir grâce à l’institution d’un Etat rationnel, chargé d’exercer la violence à leur place. Il conteste le pouvoir divin (il sera d’ailleurs accusé d’athéisme), car la société est créée par l’homme pour les hommes. La théorie du contrat d’un souverain avec ses sujets permet de passer de l’état de nature à la société, de la guerre perpétuelle à la paix. C’est en toute liberté que les hommes échangent individuellement leur liberté contre la sécurité et une vie moins violente au quotidien, au profit du pouvoir absolu d’un roi dont la principale fonction est d’assurer la paix interne et externe. Une révolte serait susceptible de faire revenir l’humanité à l’état de nature, ce qu’elle ne peut accepter. C’est le dernier recours. La paix, c’est d’abord l’absence de guerre (ce que contestera Spinoza), car les Etats sont en constante situation de guerre potentielle. A l’état social, l’homme est un dieu pour l’homme. Le pouvoir, même arbitraire ou despotique, est le garant de la stabilité sociale. Dans cette analyse, les conditions économiques ne sont que très faiblement prises en compte.
Pour Spinoza[28] (1632-1677), la guerre est une compétence discrétionnaire de la souveraineté nationale. La paix ne peut pas se décider par une seule Nation, il faut être deux, a minima. Le droit de guerre et le recours à la force pour régler les conflits constituent de fait une défaite du droit. Il n’existe pas de juge suprême capable de trancher les différends entre les Etats, surtout pas la religion qui doit être soumise aux lois des Etats applicables à tous les hommes, à charge pour elle de s’occuper des âmes en pratiquant la justice et la charité. En revanche, si les sujets ne prennent pas les armes alors qu’ils sont sous l’empire de la terreur à l’intérieur de la Cité sans conflit avec le monde extérieur, alors ni la paix, ni la guerre ne règnent. La paix n’est pas la simple absence de guerre, c’est une vertu qui trouve son origine dans la force d’âme. L’inertie des sujets serviles conduits comme un troupeau ne permet pas la réalisation d’une vie proprement humaine, elle s’apparente à celle des animaux, ce qui n’est pas une vie gérée par la raison, la force de l’âme ou la vie vraie. La paix doit être libre et relever de la volonté des citoyens de la Cité. La non-agression entre les citoyens n’est pas nécessairement un signe de paix si elle est née de la terreur ou si elle conduit à la solitude (désert humain où chacun se sent seul à l’intérieur de la société) par l’absence réelle d’association. La paix ne s’accorde pas avec la soumission, car l’existence humaine ne peut se limiter aux fonctions biologiques nécessaires à sa survie. La finalité de l’Etat, fondée sur la raison, réside dans sa capacité à assurer à chaque citoyen une existence proprement humaine en lui donnant les moyens d’exprimer sa volonté et les vertus de son âme, à empêcher toute forme de guerre civile et à conduire les sujets, dotés de raison, vers un bonheur individuel et social accompli. Contrairement à Hobbes, le pouvoir absolu n’est pas une garantie de paix civile, la seule paix acceptable et durable doit être libre. L’Etat est d’autant plus puissant que ses citoyens sont libres d’exprimer leurs idées et de juger les pouvoirs civils ou religieux en place. Il faut constituer un état de droit, qui s’applique à chaque membre. Le jugement personnel d’un homme ne peut faire l’objet de répression de la part de l’Etat démocratique, mais les lois s’imposent à lui. De même aucune croyance religieuse ne peut devenir officielle dans un Etat, car tous les points de vue peuvent et doivent cohabiter. La tolérance est un principe absolu, elle doit triompher de l’intolérance, à condition que celle-ci demeure au niveau de la pensée et même de la parole. En revanche, les actions qui portent atteintes à l’ordre public sont inexcusables et doivent être sanctionnées. Dans cette pensée spinozienne, la guerre sort du domaine étroit de l’économie.
Pour Locke[29], l’homme, naturellement tourné vers la bienveillance et la raison, est d’abord un être social, dans le cadre des lois naturelles pacifiques. Cependant pour vivre ensemble dans un ensemble d’insécurité dû principalement à une rationalité imparfaite, il ne peut éviter les conflits et la guerre. C’est la raison, seule, qui les ramène à la paix. L’Etat ne peut cependant pas se maintenir tel quel s’il n’a pas le soutien des citoyens. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) va reprendre cette conception en l’étayant. La guerre n’appartient pas à l’ordre de la nature, mais de l’état social, lequel implique que la loi domine la force. La guerre est une relation d’Etat à Etat. Elle est un produit de la civilisation, qui s’inscrit dans la logique des rapports de force et d’intérêt. La tyrannie et la guerre constituent les deux plus grands fléaux de l’humanité. Dans un manuscrit inachevé sur les « Principes du droit de la guerre », il reproche à Hobbes de n’avoir pas compris la nature même de la guerre, laquelle apparaît avec l’Etat, et à Grotius dans la définition d’un droit international compris comme l’établissement de la paix ou de la guerre par le droit. Or, le droit peut justifier les inégalités et la dépendance, ce qui peut produire des conflits internes de nature guerrière. Un traité social dicté par la nature n’a pas de sens. Il s’agit de mettre au point un idéal républicain fondé sur la renonciation aux droits naturels au profit d’un Etat qui aura pour objectif d’abord le bien-être de ses citoyens, puis la conciliation entre l’égalité et la liberté et enfin la création d’une religion civile. L’institution d’un gouvernement est l’expression d’une volonté générale. Le contrat social suppose l’abandon définitif et total des droits naturels de chaque individu en échange des droits qui sont associés à la citoyenneté d’un Etat. En démocratie, la souveraineté est inaliénable et indivisible, elle s’incarne dans le corps politique. Le peuple reste tout-puissant, il contrôle le législateur ; ce dernier aura pour objectif de défendre l’intérêt général (qui n’est pas la simple somme des intérêts individuels) contre les intérêts particuliers des groupements d’intérêts. La justice rompt avec le droit du plus fort. Ce type de démocratie est un idéal à suivre, mais celui-ci ne pourra sans doute jamais être atteint. Il ne croit pas au « droit international », car il est difficile de punir un Etat souverain. La guerre n’a pas pour objectif de détruire une population, elle veut broyer et anéantir la volonté générale d’un Etat ennemi. L’économie, même politique, n’est pas directement considérée dans cette pensée. Elle semble quasiment exclue de la réflexion.
Les philosophes des Lumières vont critiquer le système mercantiliste. Dans De l’esprit des lois (1748), Montesquieu[30] considère que Commerce et Paix vont toujours de pair. Là où il y a commerce, les moeurs s’adoucissent. Lorsque les Nations échangent des biens et services, elles se rendent mutuellement dépendantes. Dans ce cas, les raisons de la guerre s’estompent. L’effet naturel du commerce est de porter à la paix. Cette conception va progressivement l’emporter. Certes, le mercantilisme et le libéralisme veulent à la fois l’enrichissement de la Nation et sa puissance, mais pour l’un c’est la puissance qui est essentielle pour la richesse, alors que pour l’autre c’est la richesse qui apportera la puissance.
L’analyse libérale et classique va s’imposer, avec des évolutions progressives dues principalement aux philosophes, pendant presque trois siècles. C’est avec l’ouvrage d’Adam Smith sur la Richesse des Nations en 1776[31] que la théorie classique de l’économie va s’imposer et modifier la relation entre le pouvoir politique et l’analyse économique. La guerre a souvent été jugée comme inscrite dans les gênes des hommes. Jusqu’à la publication de la Richesses des Nations d’Adam Smith, la théorie économique reposait principalement sur les études philosophiques, religieuses et mercantilistes. Avec Adam Smith, la recherche de la puissance du Roi n’est pas un objectif soutenable, car le libre-échange permet un développement économique généralisé. A ce titre, il condamne non seulement la guerre coloniale, mais aussi l’esclavage qui réduit la liberté de chaque individu.
La pensée économique dominante a ensuite évolué, mais elle a soutenu le capitalisme et l’économie de marché, considérant qu’elle constituait plutôt un système pacifiste et juste. Pour la théorie du libre-échange, l’économie oppose des concurrents, non des ennemis. La compétition économique cherche à produire et vendre, alors que la guerre a pour objet d’imposer sa loi sur les personnes ou les territoires pour y établir, en principe, une autorité durable, celle du vainqueur se substituant à celle du vaincu. Les entreprises des économies de marché cherchent d’abord à produire pour des consommateurs, à gagner des parts de marchés, à faire des profits en engageant des innovations multiformes qui sont des signes importants du progrès économique. En revanche, l’économie libérale est, par définition, une quête continue de puissance et de profits, motivée par les intérêts les plus ambitieux vers les plus sordides. L’économie libérale se présente en général comme « moralement » neutre, elle ne connaît, dans sa forme extrême, que l’utilité de l’essor des profits des firmes.
Les théories hétérodoxes ont cherché à modifier ou à supprimer le capitalisme, lequel n’a pas éradiqué les guerres mondiales, les conflits économiques entre Etats ou l’exploitation de type esclavagiste des travailleurs. Les économistes de l’impérialisme ou du socialisme ont condamné la guerre économique de la concurrence exacerbée de grandes entreprises, soutenues plus ou moins secrètement par la puissance militaire et économique des Etats développés d’origine. Dans ces conditions, la guerre est inscrite dans les fibres du capitalisme. La guerre se propose d’imposer des règles de vie commune que les deux ennemis ne peuvent, ni ne veulent, partager ou concilier. Une guerre, fondée sur une croyance collective réciproque et opposée, a, normalement (Guerre de 100 ans comprise), un début et une fin. Cependant, la lecture de l’histoire économique du monde et l’actualité stratégique d’aujourd’hui conduit à l’intervention des Etats dans l’ordre économique, en appliquant la notion de « patriotisme économique », représenté aux Etats-Unis de Donald Trump par le slogan « America first »[32]. C’est un retour apparent en arrière, vers une forme nouvelle de mercantilisme, qui s’exprime cette fois, sous le couvert de la globalisation, dans le domaine de la domination du droit américain sur le droit mondial[33].
Bibliographie
Aristote , Ethique à Nicomaque, Ellipse, Paris, 2001.
Aristote, La Politique, https://fr.wikisource.org/wiki/La_Politique/Traduction_Barth%C3%A9lemy-Saint-Hilaire
Bachofen, B., Spector,C. (2008), Principes du droit de la guerre – Ecrits sur la paix perpétuelle, Paris, Vrin, 2008, 342 p.
Bensahel, L., Fontanel, J. (1992), La guerre économique, ARES, Vol XIII, 4, Grenoble, 1992
Bodin, J. (1576, 1993) Les Six Livres de la République, Le Livre de Poche n°4619. Librairie générale française, Paris.
Coulomb, F. (1998), Adam Smith, economist of defence, Defence and Peace Economics, 9(1), 299-316).
Coulomb, F., Fontanel, J. (2003), The economic thought on war and peace, The UNESCO Encyclopedia of Life, Paris.
Coulomb, F., Fontanel, J. (2003), Disarmament : acentury of economic thought, Defence and Peace Economics, 14(3), 193-208.
Coulomb, F., Fontanel, J. (2008), The birth of the political economy or the economy at the heart of politics. Mercantilism, Defence and Peace Economics, 2008.
Fontanel, J. (1978), Présentations thématiques et formalisées de la Richesse des Nations Revue Economique, Mai 1978 (27 pages)
Fontanel, J., Coulomb, F. (2008), The genesis of economic thought concerning war and peace, Defence and Peace Economics, Vol. 19(5), October.
Fontanel, J., Hébert, J-P., Samson, I. (2008), The birth of the molitical economy or the economy in the heart of politics : Mercantilism, Defence and Peace Economics, Vol. 19(5), October.
Fontanel, J. (2017), Les Etats-Unis, sanctuaire du capitalisme. Un siècle de leardership américain en questions. PSEI, Paix, Sécurité Européenne et Internationale, n°7. Nice.
Fontanel, J. (2019), Différends, conflits et guerre économiques, PSEI, Paix et Sécurité Européenne et Internationale, n°11.
Fontanel, J., Sushcheva, N. (2019), L’arme économique du droit extraterritorial américain, La menace politique, stratégique et économique du leadership américain sur l’ensemble des économies nationales et des entreprises dans le monde. Hal-02144089. CNRS.
Hobbes (1651, 1998), Leviathan, World’s Classics, Oxford.
Macchiavelli, N. (1513), 1961), The Prince, Penguin Book, London.
Manon, S. (2014), Héraclite. Polemos est le père de toutes choses ».
https://www.philolog.fr/heraclite-polemos-est-le-pere-de-toutes-choses/
Montchrestien, A. (1615), Traicté de l’économie politique, Edition Plon, Paris 1889.
Montesquieu (1758, 1995), De l’Esprit des lois, Gallimard, 2 volumes, Paris.
Platon, La République. Folio Essai, Gallimard, Paris, 1993.
Platon, Les lois, Folio Essai, Gallimard, Paris, 1997.
Saby, B., Saby, D. (2016), Compétitivité, mercantilisme et guerre économique. L’Harmattan, Paris.
Saby,B., Saby, S. (2019), La science économique, paravent de la guerre économique.
Silberner, E. (1939), la guerre dans la pensée économique du XVIe au XVIIIe siècle, Ed. Sirey, Paris.
Smith, R., Fontanel, J. (2008), International security, defence economics and the powers of Nations, in « War, Peace and Security » (Fontanel, J., Chatterji, M. Editors), Contributions to Conflict Management, Peace Economics and Development, Emerald, Bingley, UK.
Spinoza, B. (1677, 1994), L’Ethique, Gallimard, France.
[1] Smith, A. (1776, 2000), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Edwin Cannan, Modern Library Paperback Classics. Coulomb, F. (1998), Adam Smith, economist of defence, Defence and Peace Economics, 9(1), 299-316). Fontanel, J. (1978), Présentations thématiques et formalisées de la Richesse des Nations Revue Economique, Mai 1978 (27 pages). Coulomb, F. (1998), Adam Smith, economist of defence, Defence and Peace Economics, 9(1), 299-316).
[2] Saby,B., Saby, S. (2019), La science économique, paravent de la guerre économique. Saby, B., Saby, D. (2016), Compétitivité, mercantilisme et guerre économique. L’Harmattan, Paris.
[3] Bensahel, L., Fontanel, J. (1992), La guerre économique, ARES, Vol XIII, 4, Grenoble, 1992
Fontanel, J. (2019), Différends, conflits et guerre économiques, PSEI, Paix et Sécurité Européenne et Internationale, n°11.
[4] Silberner, E. (1939), la guerre dans la pensée économique du XVIe au XVIIIe siècle, Ed. Sirey, Paris.
[5] Manon, S. (2014), Héraclite. Polemos est le père de toutes choses ».https://www.philolog.fr/heraclite-polemos-est-le-pere-de-toutes-choses/
[6] Platon La République, http://ugo.bratelli.free.fr/Platon/PlatonRepublique.pdf
[7] En 317, le recensement des citoyens, organisé par Démétrios de Phalère, dénombre 21000 citoyens, autant d’étrangers habitant Athènes et 400 .000 esclaves.
[8] Platon (350, av. JC), Les Lois, https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Lois_(trad._Cousin)
[9] On sélectionne rigoureusement les individus dès leur plus jeune âge pour récupérer ceux qui méritent d’appartenir aux classes supérieures.
[10] Aristote , Ethique à Nicomaque, Ellipse, Paris, 2001.
Aristote ( ), La Politique, https://fr.wikisource.org/wiki/La_Politique/Traduction_Barth%C3%A9lemy-Saint-Hilaire
[11] Il faut rappeler que l’esclavage n’était pas seulement appliqué aux habitants d’Afrique. Par exemple, les Vénitiens achetaient des prisonniers slaves aux Saxons pour les réduire à l’esclavage.
[12] Il est paradoxal de constater que les théologiens du XVIe siècle ont demandé et obtenu du pape l’abolition de l’esclavage des Indiens, sans l’étendre à toutes les autres populations, notamment les personnes à peaux noires.
[13] Macchiavelli, N. (1513), 1961), The Prince, Penguin Book, London.
[14] Coulomb, F., Fontanel, J. (2008), The birth of the political economy or the economy at the heart of politics. Mercantilism, Defence and Peace Economics, 2008.
[15] Silberner, E. (1939), La guerre dans la pensée économique du XVIe au XVIIIe siècle. Ed. Sirey, Paris.
[17] Montchrestien, A. (1615), Traicté de l’économie politique, Edition Plon, Paris 1889.
[18] Certains Aztèques verront dans l’apparition de Cortès la réincarnation de leur Dieu.
[19] Hernan Cortès et Francisco Pizarro vont conquérir respectivement les Aztèques du Mexique moins de 4 ans (1519–1521, et les Incas du Pérou en moins de 3 ans (1532-1534) Pérou des Incas entre 1532 et 1534
[20] En 1503, la Casa de Contratación est créé à Séville en vue de réglementer le trafic entre l’Espagne et les nouvelles colonies. Il prélève une taxe de l’ordre de 20% sur le commerce avec les Indes, et il collecte les informations sur les nouvelles découvertes lointaines.
[21] En effet, Philippe II a du mal à financer ses dépenses dues à la construction de palais, à l’entretien des grands d’Espagne et aux guerres contre la France, les Turcs, l’Angleterre et les Flamands révoltés. Les prêteurs attendent qu’arrivent les métaux d’Amérique.
[22] Les compagnies anglaises ont progressivement obtenu de l’Etat un monopole d’importation (Produits baleiniers pour la Compagnie du Groenland) ou le contrôle des importations des produits en provenance de l’empire ottoman pour la Compagnie du Levant.
[23] L’ensemble de ces actes sera supprimé en 1849.
[24] Caractérisée par l’absence de lois codifiées, les décisions judiciaires comme source importante et exécutoire de la loi et une liberté contractuelle étendue
[25] Cette préférence royale sera sans doute la base des tensions avec les colonies, lesquelles conduiront à la guerre d’indépendance des Etats-Unis et aux nombreuses guerres en Inde.
[26]Le coton importé (Etats-Unis, puis Inde) offre la possibilité de réduire l’élevage des moutons pour la laine et d’utiliser ces terres libérées en terres directement agricoles.
[27] Hobbes (1651, 1998), Leviathan, World’s Classics, Oxford.
[28] Spinoza (1994), L’Ethique, Gallimard, Paris.
[29] Locke,(1690, 1960), The Second Treatise of Government, subtitled An essay concerning the True original Extent and Znd of Civil Government, presented by P. Laslett, Cambridge University Press, Cambridge.
[30] Montesquieu (1758, 1995), De l’Esprit des lois, Gallimard, 2 volumes, Paris.
[31] Smith, A. (1776, 2000), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Edwin Cannan, Modern Library Paperback Classics. Coulomb, F. (1998), Adam Smith, economist of defence, Defence and Peace Economics, 9(1), 299-316). Fontanel, J. (1978), Présentations thématiques et formalisées de la Richesse des Nations Revue Economique, Mai 1978 (27 pages). Coulomb, F. (1998), Adam Smith, economist of defence, Defence and Peace Economics, 9(1), 299-316).
[32] Fontanel, J. (2017), Les Etats-Unis, sanctuaire du capitalisme. Un siècle de leardership américain en questions. PSEI, Paix, Sécurité Européenne et Internationale, n°7. Nice.
[33] Fontanel, J., Sushcheva, N. (2019), L’arme économique du droit extraterritorial américain, La menace politique, stratégique et économique du leadership américain sur l’ensemble des économies nationales et des entreprises dans le monde. Hal-02144089. CNRS.
La contestation des théories mercantilistes
C’est dans ce contexte de guerre commerciale que le juriste néerlandais Hugo Grotius (1583-1645) est à l’origine de l’idée d’un droit international, notamment en formulant le principe selon lequel les océans et mers constituent un espace territorial commun qui donne toute liberté aux Nations de l’utiliser pour le commerce maritime. Les Etats appartiennent à une société internationale, laquelle a amassé au fil du temps un système de normes, lequel est fondé sur des habitudes de comportement entre les Nations et non à des lois. Il conteste la mise en place de la « loi du plus fort ». Certes, les Etats s’intéressent d’abord à leurs propres intérêts et à ceux de leurs sujets, mais dans l’espace de la Chrétienté la débauche de guerre des Etats européens les rapproche des nations barbares, sans aucune référence aux droits humains et au droit divin. Certes les causes des guerres sont nombreuses, notamment la propriété, les contrats, les successions au trône, les alliances et la puissance, mais il faut définir des règles qui pourraient conduire à limiter l’usage des guerres par les Rois.
Le philosophe historien David Hume (1711-1776), au début de la montée en puissance et de la stabilité politique de la Grande-Bretagne, souligne les évolutions positives du Parlement dans sa relation avec le souverain, l’importance des questions religieuses et de la révolution financière, facteurs jugés essentiels au développement économique. Il prône la modération comme fondement de la stabilité politique et des libertés. David Hume s’attaquera directement à la théorie mercantiliste en tentant d’en montrer les failles théoriques. Selon les mercantilistes, le commerce international doit servir à remplir les caisses de l’État. Il faut donc que la balance commerciale soit excédentaire. David Hume tente de démontrer que sur le long terme une balance commerciale est toujours globalement équilibrée. Ainsi, lorsqu’une nation a une balance excédentaire, la forte rentrée de monnaie provoque l’inflation et donc une perte de compétitivité qui se traduit par une balance commerciale devenant déficitaire. La guerre économique livrée par les mercantilistes relève donc pour lui d’une erreur théorique.
David Hume se propose d’analyser l’histoire de l’Angleterre, notamment depuis la République de Cromwell. La République a été officiellement établie en février 1649 (1649-1653). Le Parlement était très affaibli et divisé face à l’armée. Après l’exécution du Roi, Cromwell se présente comme l’unique source de stabilité dans le pays, le seul moyen d’éviter le déclenchement d’une autre guerre civile. Les victoires obtenues par l’armée en Irlande, en Ecosse et la soumission des colonies en Amérique avaient eu comme résultat le renforcement du pouvoir militaire plutôt que celui du parlement qui avait pourtant engagé ces guerres. La fin du conflit entre le parlement et l’armée aboutit à la dissolution de la République et à l’avènement du Protectorat. Dans ce contexte, après avoir sollicité une coalition, puis une alliance défensive, une guerre contre la Hollande apparût comme un dérivatif acceptable aux conflits internes. Hume ramène les choix de la politique étrangère à la logique des rapports de forces internes. Le conflit fut précédé par la promulgation du célèbre Acte de Navigation d’octobre 1651, par lequel les Anglais avaient l’intention de protéger leurs intérêts commerciaux et industriels. Historiquement la Hollande était le pays du commerce, sa richesse dépendait de sa capacité de transporter les marchandises d’un lieu à un autre à travers le globe. Une telle activité demandait avant tout un état de paix. Les avantages de la guerre dépassèrent indirectement les pertes, du fait des pertes du commerce maritime subies par les Hollandais, du contenu du traité de paix que ces derniers furent obligés de signer, et du prestige international acquis par l’Angleterre. Hume ne nie pas les effets économiquement positifs de la guerre.
Pour les autres guerres, la monarchie étant restaurée depuis le printemps 1660, avec la certitude de la stabilité politique, le Parlement considéra les torts provoqués par les Hollandais au développement du commerce anglais. Il lui a semblé qu’il fallait alors défendre les intérêts de la Couronne, même si les hostilités étaient plutôt déclenchées par les britanniques, notamment le long de la côte occidentale africaine et en Amérique du nord. Il s’agissait clairement d’une guerre d’intérêt économique. L’Angleterre était tournée vers la mer. Disposant d’un pouvoir naval supérieur à celui des Hollandais, la guerre semblait une opération économiquement avantageuse, à condition de la gagner. Pour Hume, la question est de savoir ce qui est juste pour le bien-être d’un Etat, un choix qui appartient à la sphère politique, avec le soutien des forces armées dans le cas d’un conflit militaire. La décision de la guerre est dangereuse, car le résultat n’est pas nécessairement celui qui est espéré, tout en faisant augmenter la dette publique, ce qui constitue le meilleur moyen pour affaiblir la puissance de l’Etat. La guerre ne constitue pas la solution à tous les problèmes politiques, même si elle ravive le patriotisme des citoyens ainsi que l’unité nationale. C’est toujours une défaite par rapport à l’homme civilisé. En outre, l’activité commerciale internationale provoque des conflits économiques graves entre les Etats. Il serait préférable de trouver des solutions communes qui agréeraient aux deux Etats, car le conflit n’est pas le meilleur moyen pour le progrès économique. Il faut battre ses concurrents directement sur les marchés internationaux, grâce à une économie prospère. Dans ces guerres avec la Hollande, l’Angleterre s’est isolée et le Traité de Breda ne lui offrit, in fine, que le territoire de New York. Enfin, elle a oublié son ennemi naturel, la France, son vrai rival avec sa population, son papisme et la capacité de ce pays de modifier l’équilibre européen (balance of power). Pour Hume, l’alliance de Londres avec la France lors de la troisième guerre contre la Hollande était alors une erreur politique.
L’économie politique n’est pas le facteur déterminant de la guerre
La théorie de Hobbes (1588-1679)[27], dans le Léviathan (1651), est intéressante de ce point de vue : si l’état de nature (caractérisé par l’absence de tout pouvoir politique et de lois) est un état de guerre (chacun contre chacun, l’homme est un loup pour l’homme, dans un système d’égalité des chances), les hommes peuvent en sortir grâce à l’institution d’un Etat rationnel, chargé d’exercer la violence à leur place. Il conteste le pouvoir divin (il sera d’ailleurs accusé d’athéisme), car la société est créée par l’homme pour les hommes. La théorie du contrat d’un souverain avec ses sujets permet de passer de l’état de nature à la société, de la guerre perpétuelle à la paix. C’est en toute liberté que les hommes échangent individuellement leur liberté contre la sécurité et une vie moins violente au quotidien, au profit du pouvoir absolu d’un roi dont la principale fonction est d’assurer la paix interne et externe. Une révolte serait susceptible de faire revenir l’humanité à l’état de nature, ce qu’elle ne peut accepter. C’est le dernier recours. La paix, c’est d’abord l’absence de guerre (ce que contestera Spinoza), car les Etats sont en constante situation de guerre potentielle. A l’état social, l’homme est un dieu pour l’homme. Le pouvoir, même arbitraire ou despotique, est le garant de la stabilité sociale. Dans cette analyse, les conditions économiques ne sont que très faiblement prises en compte.
Pour Spinoza[28] (1632-1677), la guerre est une compétence discrétionnaire de la souveraineté nationale. La paix ne peut pas se décider par une seule Nation, il faut être deux, a minima. Le droit de guerre et le recours à la force pour régler les conflits constituent de fait une défaite du droit. Il n’existe pas de juge suprême capable de trancher les différends entre les Etats, surtout pas la religion qui doit être soumise aux lois des Etats applicables à tous les hommes, à charge pour elle de s’occuper des âmes en pratiquant la justice et la charité. En revanche, si les sujets ne prennent pas les armes alors qu’ils sont sous l’empire de la terreur à l’intérieur de la Cité sans conflit avec le monde extérieur, alors ni la paix, ni la guerre ne règnent. La paix n’est pas la simple absence de guerre, c’est une vertu qui trouve son origine dans la force d’âme. L’inertie des sujets serviles conduits comme un troupeau ne permet pas la réalisation d’une vie proprement humaine, elle s’apparente à celle des animaux, ce qui n’est pas une vie gérée par la raison, la force de l’âme ou la vie vraie. La paix doit être libre et relever de la volonté des citoyens de la Cité. La non-agression entre les citoyens n’est pas nécessairement un signe de paix si elle est née de la terreur ou si elle conduit à la solitude (désert humain où chacun se sent seul à l’intérieur de la société) par l’absence réelle d’association. La paix ne s’accorde pas avec la soumission, car l’existence humaine ne peut se limiter aux fonctions biologiques nécessaires à sa survie. La finalité de l’Etat, fondée sur la raison, réside dans sa capacité à assurer à chaque citoyen une existence proprement humaine en lui donnant les moyens d’exprimer sa volonté et les vertus de son âme, à empêcher toute forme de guerre civile et à conduire les sujets, dotés de raison, vers un bonheur individuel et social accompli. Contrairement à Hobbes, le pouvoir absolu n’est pas une garantie de paix civile, la seule paix acceptable et durable doit être libre. L’Etat est d’autant plus puissant que ses citoyens sont libres d’exprimer leurs idées et de juger les pouvoirs civils ou religieux en place. Il faut constituer un état de droit, qui s’applique à chaque membre. Le jugement personnel d’un homme ne peut faire l’objet de répression de la part de l’Etat démocratique, mais les lois s’imposent à lui. De même aucune croyance religieuse ne peut devenir officielle dans un Etat, car tous les points de vue peuvent et doivent cohabiter. La tolérance est un principe absolu, elle doit triompher de l’intolérance, à condition que celle-ci demeure au niveau de la pensée et même de la parole. En revanche, les actions qui portent atteintes à l’ordre public sont inexcusables et doivent être sanctionnées. Dans cette pensée spinozienne, la guerre sort du domaine étroit de l’économie.
Pour Locke[29], l’homme, naturellement tourné vers la bienveillance et la raison, est d’abord un être social, dans le cadre des lois naturelles pacifiques. Cependant pour vivre ensemble dans un ensemble d’insécurité dû principalement à une rationalité imparfaite, il ne peut éviter les conflits et la guerre. C’est la raison, seule, qui les ramène à la paix. L’Etat ne peut cependant pas se maintenir tel quel s’il n’a pas le soutien des citoyens. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) va reprendre cette conception en l’étayant. La guerre n’appartient pas à l’ordre de la nature, mais de l’état social, lequel implique que la loi domine la force. La guerre est une relation d’Etat à Etat. Elle est un produit de la civilisation, qui s’inscrit dans la logique des rapports de force et d’intérêt. La tyrannie et la guerre constituent les deux plus grands fléaux de l’humanité. Dans un manuscrit inachevé sur les « Principes du droit de la guerre », il reproche à Hobbes de n’avoir pas compris la nature même de la guerre, laquelle apparaît avec l’Etat, et à Grotius dans la définition d’un droit international compris comme l’établissement de la paix ou de la guerre par le droit. Or, le droit peut justifier les inégalités et la dépendance, ce qui peut produire des conflits internes de nature guerrière. Un traité social dicté par la nature n’a pas de sens. Il s’agit de mettre au point un idéal républicain fondé sur la renonciation aux droits naturels au profit d’un Etat qui aura pour objectif d’abord le bien-être de ses citoyens, puis la conciliation entre l’égalité et la liberté et enfin la création d’une religion civile. L’institution d’un gouvernement est l’expression d’une volonté générale. Le contrat social suppose l’abandon définitif et total des droits naturels de chaque individu en échange des droits qui sont associés à la citoyenneté d’un Etat. En démocratie, la souveraineté est inaliénable et indivisible, elle s’incarne dans le corps politique. Le peuple reste tout-puissant, il contrôle le législateur ; ce dernier aura pour objectif de défendre l’intérêt général (qui n’est pas la simple somme des intérêts individuels) contre les intérêts particuliers des groupements d’intérêts. La justice rompt avec le droit du plus fort. Ce type de démocratie est un idéal à suivre, mais celui-ci ne pourra sans doute jamais être atteint. Il ne croit pas au « droit international », car il est difficile de punir un Etat souverain. La guerre n’a pas pour objectif de détruire une population, elle veut broyer et anéantir la volonté générale d’un Etat ennemi. L’économie, même politique, n’est pas directement considérée dans cette pensée. Elle semble quasiment exclue de la réflexion.
Les philosophes des Lumières vont critiquer le système mercantiliste. Dans De l’esprit des lois (1748), Montesquieu[30] considère que Commerce et Paix vont toujours de pair. Là où il y a commerce, les moeurs s’adoucissent. Lorsque les Nations échangent des biens et services, elles se rendent mutuellement dépendantes. Dans ce cas, les raisons de la guerre s’estompent. L’effet naturel du commerce est de porter à la paix. Cette conception va progressivement l’emporter. Certes, le mercantilisme et le libéralisme veulent à la fois l’enrichissement de la Nation et sa puissance, mais pour l’un c’est la puissance qui est essentielle pour la richesse, alors que pour l’autre c’est la richesse qui apportera la puissance.
L’analyse libérale et classique va s’imposer, avec des évolutions progressives dues principalement aux philosophes, pendant presque trois siècles. C’est avec l’ouvrage d’Adam Smith sur la Richesse des Nations en 1776[31] que la théorie classique de l’économie va s’imposer et modifier la relation entre le pouvoir politique et l’analyse économique. La guerre a souvent été jugée comme inscrite dans les gênes des hommes. Jusqu’à la publication de la Richesses des Nations d’Adam Smith, la théorie économique reposait principalement sur les études philosophiques, religieuses et mercantilistes. Avec Adam Smith, la recherche de la puissance du Roi n’est pas un objectif soutenable, car le libre-échange permet un développement économique généralisé. A ce titre, il condamne non seulement la guerre coloniale, mais aussi l’esclavage qui réduit la liberté de chaque individu.
La pensée économique dominante a ensuite évolué, mais elle a soutenu le capitalisme et l’économie de marché, considérant qu’elle constituait plutôt un système pacifiste et juste. Pour la théorie du libre-échange, l’économie oppose des concurrents, non des ennemis. La compétition économique cherche à produire et vendre, alors que la guerre a pour objet d’imposer sa loi sur les personnes ou les territoires pour y établir, en principe, une autorité durable, celle du vainqueur se substituant à celle du vaincu. Les entreprises des économies de marché cherchent d’abord à produire pour des consommateurs, à gagner des parts de marchés, à faire des profits en engageant des innovations multiformes qui sont des signes importants du progrès économique. En revanche, l’économie libérale est, par définition, une quête continue de puissance et de profits, motivée par les intérêts les plus ambitieux vers les plus sordides. L’économie libérale se présente en général comme « moralement » neutre, elle ne connaît, dans sa forme extrême, que l’utilité de l’essor des profits des firmes.
Les théories hétérodoxes ont cherché à modifier ou à supprimer le capitalisme, lequel n’a pas éradiqué les guerres mondiales, les conflits économiques entre Etats ou l’exploitation de type esclavagiste des travailleurs. Les économistes de l’impérialisme ou du socialisme ont condamné la guerre économique de la concurrence exacerbée de grandes entreprises, soutenues plus ou moins secrètement par la puissance militaire et économique des Etats développés d’origine. Dans ces conditions, la guerre est inscrite dans les fibres du capitalisme. La guerre se propose d’imposer des règles de vie commune que les deux ennemis ne peuvent, ni ne veulent, partager ou concilier. Une guerre, fondée sur une croyance collective réciproque et opposée, a, normalement (Guerre de 100 ans comprise), un début et une fin. Cependant, la lecture de l’histoire économique du monde et l’actualité stratégique d’aujourd’hui conduit à l’intervention des Etats dans l’ordre économique, en appliquant la notion de « patriotisme économique », représenté aux Etats-Unis de Donald Trump par le slogan « America first »[32]. C’est un retour apparent en arrière, vers une forme nouvelle de mercantilisme, qui s’exprime cette fois, sous le couvert de la globalisation, dans le domaine de la domination du droit américain sur le droit mondial[33].
Bibliographie
Aristote , Ethique à Nicomaque, Ellipse, Paris, 2001.
Aristote, La Politique, https://fr.wikisource.org/wiki/La_Politique/Traduction_Barth%C3%A9lemy-Saint-Hilaire
Bachofen, B., Spector,C. (2008), Principes du droit de la guerre – Ecrits sur la paix perpétuelle, Paris, Vrin, 2008, 342 p.
Bensahel, L., Fontanel, J. (1992), La guerre économique, ARES, Vol XIII, 4, Grenoble, 1992
Bodin, J. (1576, 1993) Les Six Livres de la République, Le Livre de Poche n°4619. Librairie générale française, Paris.
Coulomb, F. (1998), Adam Smith, economist of defence, Defence and Peace Economics, 9(1), 299-316).
Coulomb, F., Fontanel, J. (2003), The economic thought on war and peace, The UNESCO Encyclopedia of Life, Paris.
Coulomb, F., Fontanel, J. (2003), Disarmament : acentury of economic thought, Defence and Peace Economics, 14(3), 193-208.
Coulomb, F., Fontanel, J. (2008), The birth of the political economy or the economy at the heart of politics. Mercantilism, Defence and Peace Economics, 2008.
Fontanel, J. (1978), Présentations thématiques et formalisées de la Richesse des Nations Revue Economique, Mai 1978 (27 pages)
Fontanel, J., Coulomb, F. (2008), The genesis of economic thought concerning war and peace, Defence and Peace Economics, Vol. 19(5), October.
Fontanel, J., Hébert, J-P., Samson, I. (2008), The birth of the molitical economy or the economy in the heart of politics : Mercantilism, Defence and Peace Economics, Vol. 19(5), October.
Fontanel, J. (2017), Les Etats-Unis, sanctuaire du capitalisme. Un siècle de leardership américain en questions. PSEI, Paix, Sécurité Européenne et Internationale, n°7. Nice.
Fontanel, J. (2019), Différends, conflits et guerre économiques, PSEI, Paix et Sécurité Européenne et Internationale, n°11.
Fontanel, J., Sushcheva, N. (2019), L’arme économique du droit extraterritorial américain, La menace politique, stratégique et économique du leadership américain sur l’ensemble des économies nationales et des entreprises dans le monde. Hal-02144089. CNRS.
Hobbes (1651, 1998), Leviathan, World’s Classics, Oxford.
Macchiavelli, N. (1513), 1961), The Prince, Penguin Book, London.
Manon, S. (2014), Héraclite. Polemos est le père de toutes choses ».
https://www.philolog.fr/heraclite-polemos-est-le-pere-de-toutes-choses/
Montchrestien, A. (1615), Traicté de l’économie politique, Edition Plon, Paris 1889.
Montesquieu (1758, 1995), De l’Esprit des lois, Gallimard, 2 volumes, Paris.
Platon, La République. Folio Essai, Gallimard, Paris, 1993.
Platon, Les lois, Folio Essai, Gallimard, Paris, 1997.
Saby, B., Saby, D. (2016), Compétitivité, mercantilisme et guerre économique. L’Harmattan, Paris.
Saby,B., Saby, S. (2019), La science économique, paravent de la guerre économique.
Silberner, E. (1939), la guerre dans la pensée économique du XVIe au XVIIIe siècle, Ed. Sirey, Paris.
Smith, R., Fontanel, J. (2008), International security, defence economics and the powers of Nations, in « War, Peace and Security » (Fontanel, J., Chatterji, M. Editors), Contributions to Conflict Management, Peace Economics and Development, Emerald, Bingley, UK.
Spinoza, B. (1677, 1994), L’Ethique, Gallimard, France.
[1] Smith, A. (1776, 2000), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Edwin Cannan, Modern Library Paperback Classics. Coulomb, F. (1998), Adam Smith, economist of defence, Defence and Peace Economics, 9(1), 299-316). Fontanel, J. (1978), Présentations thématiques et formalisées de la Richesse des Nations Revue Economique, Mai 1978 (27 pages). Coulomb, F. (1998), Adam Smith, economist of defence, Defence and Peace Economics, 9(1), 299-316).
[2] Saby,B., Saby, S. (2019), La science économique, paravent de la guerre économique. Saby, B., Saby, D. (2016), Compétitivité, mercantilisme et guerre économique. L’Harmattan, Paris.
[3] Bensahel, L., Fontanel, J. (1992), La guerre économique, ARES, Vol XIII, 4, Grenoble, 1992
Fontanel, J. (2019), Différends, conflits et guerre économiques, PSEI, Paix et Sécurité Européenne et Internationale, n°11.
[4] Silberner, E. (1939), la guerre dans la pensée économique du XVIe au XVIIIe siècle, Ed. Sirey, Paris.
[5] Manon, S. (2014), Héraclite. Polemos est le père de toutes choses ».https://www.philolog.fr/heraclite-polemos-est-le-pere-de-toutes-choses/
[6] Platon La République, http://ugo.bratelli.free.fr/Platon/PlatonRepublique.pdf
[7] En 317, le recensement des citoyens, organisé par Démétrios de Phalère, dénombre 21000 citoyens, autant d’étrangers habitant Athènes et 400 .000 esclaves.
[8] Platon (350, av. JC), Les Lois, https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Lois_(trad._Cousin)
[9] On sélectionne rigoureusement les individus dès leur plus jeune âge pour récupérer ceux qui méritent d’appartenir aux classes supérieures.
[10] Aristote , Ethique à Nicomaque, Ellipse, Paris, 2001.
Aristote ( ), La Politique, https://fr.wikisource.org/wiki/La_Politique/Traduction_Barth%C3%A9lemy-Saint-Hilaire
[11] Il faut rappeler que l’esclavage n’était pas seulement appliqué aux habitants d’Afrique. Par exemple, les Vénitiens achetaient des prisonniers slaves aux Saxons pour les réduire à l’esclavage.
[12] Il est paradoxal de constater que les théologiens du XVIe siècle ont demandé et obtenu du pape l’abolition de l’esclavage des Indiens, sans l’étendre à toutes les autres populations, notamment les personnes à peaux noires.
[13] Macchiavelli, N. (1513), 1961), The Prince, Penguin Book, London.
[14] Coulomb, F., Fontanel, J. (2008), The birth of the political economy or the economy at the heart of politics. Mercantilism, Defence and Peace Economics, 2008.
[15] Silberner, E. (1939), La guerre dans la pensée économique du XVIe au XVIIIe siècle. Ed. Sirey, Paris.
[17] Montchrestien, A. (1615), Traicté de l’économie politique, Edition Plon, Paris 1889.
[18] Certains Aztèques verront dans l’apparition de Cortès la réincarnation de leur Dieu.
[19] Hernan Cortès et Francisco Pizarro vont conquérir respectivement les Aztèques du Mexique moins de 4 ans (1519–1521, et les Incas du Pérou en moins de 3 ans (1532-1534) Pérou des Incas entre 1532 et 1534
[20] En 1503, la Casa de Contratación est créé à Séville en vue de réglementer le trafic entre l’Espagne et les nouvelles colonies. Il prélève une taxe de l’ordre de 20% sur le commerce avec les Indes, et il collecte les informations sur les nouvelles découvertes lointaines.
[21] En effet, Philippe II a du mal à financer ses dépenses dues à la construction de palais, à l’entretien des grands d’Espagne et aux guerres contre la France, les Turcs, l’Angleterre et les Flamands révoltés. Les prêteurs attendent qu’arrivent les métaux d’Amérique.
[22] Les compagnies anglaises ont progressivement obtenu de l’Etat un monopole d’importation (Produits baleiniers pour la Compagnie du Groenland) ou le contrôle des importations des produits en provenance de l’empire ottoman pour la Compagnie du Levant.
[23] L’ensemble de ces actes sera supprimé en 1849.
[24] Caractérisée par l’absence de lois codifiées, les décisions judiciaires comme source importante et exécutoire de la loi et une liberté contractuelle étendue
[25] Cette préférence royale sera sans doute la base des tensions avec les colonies, lesquelles conduiront à la guerre d’indépendance des Etats-Unis et aux nombreuses guerres en Inde.
[26]Le coton importé (Etats-Unis, puis Inde) offre la possibilité de réduire l’élevage des moutons pour la laine et d’utiliser ces terres libérées en terres directement agricoles.
[27] Hobbes (1651, 1998), Leviathan, World’s Classics, Oxford.
[28] Spinoza (1994), L’Ethique, Gallimard, Paris.
[29] Locke,(1690, 1960), The Second Treatise of Government, subtitled An essay concerning the True original Extent and Znd of Civil Government, presented by P. Laslett, Cambridge University Press, Cambridge.
[30] Montesquieu (1758, 1995), De l’Esprit des lois, Gallimard, 2 volumes, Paris.
[31] Smith, A. (1776, 2000), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Edwin Cannan, Modern Library Paperback Classics. Coulomb, F. (1998), Adam Smith, economist of defence, Defence and Peace Economics, 9(1), 299-316). Fontanel, J. (1978), Présentations thématiques et formalisées de la Richesse des Nations Revue Economique, Mai 1978 (27 pages). Coulomb, F. (1998), Adam Smith, economist of defence, Defence and Peace Economics, 9(1), 299-316).
[32] Fontanel, J. (2017), Les Etats-Unis, sanctuaire du capitalisme. Un siècle de leardership américain en questions. PSEI, Paix, Sécurité Européenne et Internationale, n°7. Nice.
[33] Fontanel, J., Sushcheva, N. (2019), L’arme économique du droit extraterritorial américain, La menace politique, stratégique et économique du leadership américain sur l’ensemble des économies nationales et des entreprises dans le monde. Hal-02144089. CNRS.