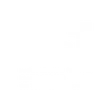Politique(s) et Soft Power indiens en Afrique : une « course inégale » vis-à-vis de la Chine ?
07/06/2019

Par Xavier Auregan, Chercheur affilié au Centre de recherches et d’analyses géopolitiques (CRAG) de l’Institut français de géopolitique (IFG) et associé au Conseil québécois d’études géopolitiques (CQEG) de l’université Laval. Enseignant à l’ILERI.
Depuis les années 1950, une constante caractérise les gouvernements indiens et chinois : ils ont tous deux l’ambition de (re)devenir un acteur prépondérant des relations internationales. Dans les discours officiels respectifs, les politiques extérieures trouvent non pas leur origine, mais leur affirmation sur la scène internationale lors de la Conférence afro-asiatique de Bandung en 1955. Cette réunion est l’occasion de constater les divergences, si ce n’est les antagonismes sino-indiens quant à la politique à mener envers les pays en voie de développement représentés ou non en Indonésie en 1955. Malgré la médiatisation faite de la conférence, un point commun – et d’achoppement également – réside dans les capacités chinoise et indienne à mobiliser, à soutenir et à accompagner les territoires et leaders politiques africains sous domination coloniale avant les années 1960, puis devenus indépendants par la suite. Dans ce cadre, l’Afrique comme le Soft Power font figure de leviers pour accéder au statut de puissance internationale.
Depuis les années 1950, une constante caractérise les gouvernements indiens et chinois : ils ont tous deux l’ambition de (re)devenir un acteur prépondérant des relations internationales. Dans les discours officiels respectifs, les politiques extérieures trouvent non pas leur origine, mais leur affirmation sur la scène internationale lors de la Conférence afro-asiatique de Bandung en 1955. Cette réunion est l’occasion de constater les divergences, si ce n’est les antagonismes sino-indiens quant à la politique à mener envers les pays en voie de développement représentés ou non en Indonésie en 1955. Malgré la médiatisation faite de la conférence, un point commun – et d’achoppement également – réside dans les capacités chinoise et indienne à mobiliser, à soutenir et à accompagner les territoires et leaders politiques africains sous domination coloniale avant les années 1960, puis devenus indépendants par la suite. Dans ce cadre, l’Afrique comme le Soft Power font figure de leviers pour accéder au statut de puissance internationale.
Le décalage politique et historique de l'Inde vis-à-vis de la Chine en Afrique
Après Bandung, de la pénétration militaire chinoise au Ladakh (Jammu-et-Cachemire) jusqu’aux conflits territoriaux de 1962 (Aksaï Chin et Arunachal Pradesh), les relations sino-indiennes ne cessent de se détériorer. Dans le cadre d’une rivalité sino-indo-soviétique pour incarner un certain leadership dans les pays du Tiers-Monde, l’année 1963 incarne une véritable rupture dans la politique supposément multilatérale, basée sur les cinq principes de la Coexistence pacifique entérinés à Bandung, que les gouvernements chinois, indien ou soviétique ont tenté de mettre en œuvre. Le « paradigme de Moshi », du nom de la ville tanzanienne où se déroule, en 1963, la troisième conférence des pays non-alignés, met effectivement en exergue l’opposition sino-indo-soviétique inhérente à la politique qu’il convenait de tenir vis-à-vis des pays du Tiers-Monde (Aurégan, 2016-a, 2019). Objet de la réunion de Moshi, la Conférence afro-asiatique d’Alger de 1694 n’aura jamais lieu, et New Delhi, comme Pékin, développent chacun leur propre politique étrangère bilatérale avec les États africains.
Menée par le ministre des Affaires étrangères Zhou Enlaï entre décembre 1963 et janvier 1964, la première tournée chinoise en Afrique pose alors à Accra et Bamako les bases de la « coopération » sino-africaine. L’Inde lui emboîte le pas dès 1964 en développant à son tour une politique bilatérale incarnée par son programme de coopération économique et technique (
The Indian Technical and Economic Cooperation, ITEC).
Entre 1955 et 1964, année du décès de Nehru, ce premier temps indien en Afrique précède celui… de l’absence de l’Inde sur le continent (1965-2008). Parmi les nombreuses raisons ayant impacté les relations diplomatiques et politiques de l’Inde en Afrique figurent notamment les conflits politiques et les rivalités de pouvoirs internes post-Nehru ; la Révolution verte et la politique nucléaire qui accaparent ressources et budgets ; le refus, par New Delhi, de livrer des armes en Afrique et de soutenir les mouvements de libération nationale (MLN) ; les conflits indo-pakistanais, avec le Bangladesh, le Sri Lanka et les Maldives ; la crise monétaire et les déficits commerciaux ; et finalement les réformes des années 1980 qui amènent à la libéralisation de 1991.
Ainsi, les décennies suivant Moshi vont confirmer l’indigénisation des politiques africaines de New Delhi et de Pékin d’une part, et les replis nationalistes des deux puissances démographiques d’Asie d’autre part, légitimement astreintes à la lutte contre la pauvreté, leurs développements et aux réformes attenantes.
La décennie 1990 est le prélude à la réémergence de la Chine et de l’Inde. À travers des temporalités et des contextes différents, toutes deux impulsent les réformes libérales qui permettent leur internationalisation. La Chine, plus précoce et bénéficiant d’un système centralisé et autoritaire, plus encline à soutenir militairement, économiquement et financièrement ses « partenaires » africains qui alternent entre Taipei et Pékin, est la première à se doter des moyens nécessaires à sa projection à l’international, et en Afrique en particulier (Aurégan, 2019). Intimement liée à la sécurisation de son accès au pétrole à partir de 1993 et à la recherche de – nouveaux – marchés pour ses acteurs économiques domestiques, l’intervention chinoise en Afrique est synthétisée dans les Plans d’action des Forums de coopération Chine-Afrique (FOCAC), dont le premier a été organisé en 2000 (Aurégan, 2015). Pour l’Inde, l’institutionnalisation de sa politique africaine n’intervient qu’en 2008, année du début du troisième temps indien en Afrique. Cette petite décennie de décalage entre FOCAC et India-Africa Summit Forum (IAFS) symbolise le retard pris par New Delhi.
Dans leurs relations à l’Afrique, les deux États asiatiques disposent donc désormais d’instruments respectifs à même de canaliser relations, flux et politiques. Parmi eux, certains peuvent être classés en tant qu’outils du Soft Power tel que défini par Joseph Nye, soit la capacité d’un État à « former les préférences des autres » via l’attrait de ses valeurs, de sa culture et de ses politiques (Nye, 2004).
Menée par le ministre des Affaires étrangères Zhou Enlaï entre décembre 1963 et janvier 1964, la première tournée chinoise en Afrique pose alors à Accra et Bamako les bases de la « coopération » sino-africaine. L’Inde lui emboîte le pas dès 1964 en développant à son tour une politique bilatérale incarnée par son programme de coopération économique et technique (
The Indian Technical and Economic Cooperation, ITEC).
Entre 1955 et 1964, année du décès de Nehru, ce premier temps indien en Afrique précède celui… de l’absence de l’Inde sur le continent (1965-2008). Parmi les nombreuses raisons ayant impacté les relations diplomatiques et politiques de l’Inde en Afrique figurent notamment les conflits politiques et les rivalités de pouvoirs internes post-Nehru ; la Révolution verte et la politique nucléaire qui accaparent ressources et budgets ; le refus, par New Delhi, de livrer des armes en Afrique et de soutenir les mouvements de libération nationale (MLN) ; les conflits indo-pakistanais, avec le Bangladesh, le Sri Lanka et les Maldives ; la crise monétaire et les déficits commerciaux ; et finalement les réformes des années 1980 qui amènent à la libéralisation de 1991.
Ainsi, les décennies suivant Moshi vont confirmer l’indigénisation des politiques africaines de New Delhi et de Pékin d’une part, et les replis nationalistes des deux puissances démographiques d’Asie d’autre part, légitimement astreintes à la lutte contre la pauvreté, leurs développements et aux réformes attenantes.
La décennie 1990 est le prélude à la réémergence de la Chine et de l’Inde. À travers des temporalités et des contextes différents, toutes deux impulsent les réformes libérales qui permettent leur internationalisation. La Chine, plus précoce et bénéficiant d’un système centralisé et autoritaire, plus encline à soutenir militairement, économiquement et financièrement ses « partenaires » africains qui alternent entre Taipei et Pékin, est la première à se doter des moyens nécessaires à sa projection à l’international, et en Afrique en particulier (Aurégan, 2019). Intimement liée à la sécurisation de son accès au pétrole à partir de 1993 et à la recherche de – nouveaux – marchés pour ses acteurs économiques domestiques, l’intervention chinoise en Afrique est synthétisée dans les Plans d’action des Forums de coopération Chine-Afrique (FOCAC), dont le premier a été organisé en 2000 (Aurégan, 2015). Pour l’Inde, l’institutionnalisation de sa politique africaine n’intervient qu’en 2008, année du début du troisième temps indien en Afrique. Cette petite décennie de décalage entre FOCAC et India-Africa Summit Forum (IAFS) symbolise le retard pris par New Delhi.
Dans leurs relations à l’Afrique, les deux États asiatiques disposent donc désormais d’instruments respectifs à même de canaliser relations, flux et politiques. Parmi eux, certains peuvent être classés en tant qu’outils du Soft Power tel que défini par Joseph Nye, soit la capacité d’un État à « former les préférences des autres » via l’attrait de ses valeurs, de sa culture et de ses politiques (Nye, 2004).
La faiblesse des instruments du Soft Power Indien en Afrique
Si l’Inde possède des avantages comparatifs culturels potentiels à travers la pratique du yoga, du bouddhisme, de la littérature ou de son cinéma Bollywood, et plus avérés dans l’agriculture et la santé, la Chine n’est pas en reste et pouvait compter, hier, sur le Petit Livre rouge de Mao, et aujourd’hui sur son rattrapage économique accéléré désormais symbolisé par le « rêve chinois » et les nouvelles routes de la soie (One Belt One Road, devenues Belt and Road Initiative) du Président Xi Jinping. En s’étant tardivement ouverts au capitalisme et mettant en avant le fait d’avoir été colonisés par des puissances occidentales, les deux pays asiatiques peuvent se prévaloir d’incarner une certaine alternative à ces dernières, mais la Chine semble avoir une longueur d’avance dans les représentations africaines et internationales. Ce faisant, cinq facteurs peuvent être mobilisés en vue d’identifier les carences indiennes en termes de Soft Power en Afrique.
Le premier est lié au modèle de développement chinois que d’aucuns nomment Consensus de Pékin (Ramo, 2004) et qui s’applique expressément au continent africain. En témoigne le taux d’approbation global du leadership de la Chine en Afrique qui concurrence celui des États-Unis, avec 50 % d’opinions positives contre 51 % dans les 38 États africains couverts par l’entreprise de sondage Gallup en 2017 (Gallup, 2018). Le fait que l’Inde ne fasse pas l’objet de sondages est révélateur en soi.
Corrélatif, le deuxième facteur concerne l’attrait réel ou supposé de ces deux pays qui accueillent de plus en plus d’étudiants : 50 000 ont choisi la Chine en 2015 (50 000 entrées [1]), deuxième pays récepteur derrière la France (98 000), mais devant les États-Unis (41 000), le Royaume-Uni (35 000) et l’Inde, qui n’en a accueilli que 10 684 (UNESCO, 2018). Entre Chine et Inde, trois autres comparaisons sont envisageables. Elles concernent les diasporas (ou communautés diasporiques), les centres culturels et les réseaux d’ambassades respectifs en Afrique.
Selon le ministère des Affaires étrangères indien[2], 2,8 millions d’Indiens d’outre-mer sont répartis dans les 54 États africains. L’Inde différenciant à raison les « Indiens non-résidents » (8 % du total) des « personnes d’origine indienne », les 92 % restants ne possèdent donc plus la nationalité indienne. Moins réputée que la Chine pour mobiliser sa diaspora, l’Inde en aurait-elle les moyens compte tenu du fait que ces personnes d’origine indienne sont parfois établies depuis plusieurs générations en Afrique de l’Est, en Afrique australe ou à Madagascar ? Fréquemment associés à des formes de communautarisme et à des rivalités locales, les Karana (Fournet-Guérin, 2009 : 554) de Madagascar sont accusés de provoquer des conflits avec les populations autochtones. Le cas de magasins « indiens » pillés, voire incendiés, est symptomatique de ce communautarisme qui peut prendre des proportions racistes en Inde, où deux étudiants africains sont décédés ces dernières années ; de fait, ces faits divers xénophobes attentent à l’image de l’Inde en Afrique. Si les communautés chinoises[3] sont elles aussi associées à des modes de vie communautaristes en Afrique (Aurégan, 2016-b) et critiquées pour leur faible intégration socio-économique (Aurégan, 2013), la relative récence des migrations explique éventuellement l’image plutôt positive des ressortissants chinois en Afrique. Plus certainement, l’agrégation du rôle, des moyens et des réalisations de l’État chinois et de ses entreprises publiques semble jusqu’à présent générer des perceptions bienveillantes chez les populations africaines. C’est du moins à cette conclusion que nous aboutissons à l’issue de plusieurs études de terrain en Afrique de l’Ouest ; conclusion qui semble être étayée par les sondages, bien que contestables, d’instituts tels que Gallup et Pew Research Center (Gallup 2018 ; Pew Research Center, 2018).
L’avant-dernier facteur culturel présenté et pouvant amener à une comparaison entre Chine et Inde est lié aux centres culturels (Carte 1). Le « retard » indien en la matière est patent, New Delhi ayant installé 35 centres au total dans le monde, mais seulement cinq en Afrique, dont deux en Afrique du Sud. Pour la Chine, mi-2019, ce sont 54 Instituts et classes Confucius en Afrique pour un total de 525 répartis à travers le monde.
Les limites affichées dix ans plus tôt par François Lafargue (2007) persistent et pour certaines s’accroissent, bien que les enjeux demeurent : « si, pour l’Afrique, il n’est pas certain que cette sollicitude de l’Inde et de la Chine lui permette de trouver sa place dans la mondialisation, pour New Delhi, la conquête de l’Afrique est une étape obligée de son ambition mondiale » (Lafargue, 2006). Cette « conquête » doit nécessairement s’appuyer sur un dense réseau d’ambassades.
Celui-ci (Carte 1) démontre la puissance et les intentions d’un État à travers le monde. Dans cette perspective, le document suivant met en exergue le retour au premier plan de Pékin dans les affaires internationales. En Afrique, la couverture chinoise quasi parfaite renvoie nécessairement au différentiel de moyens alloués par Pékin, et aux contextes internes comme externes ; la réserve de devises et l’ambition internationale chinoises n’étant pas étrangères à l’essor et à la prorogation de cette politique africaine sinisée. De fait, seul l’Eswatini (ex-Swaziland), qui reconnait encore Taipei, n’est pas couvert. C’est donc un pays de plus que la France qui a délocalisé l’ambassade somalienne au Kenya, et qui n’en dispose ni au Lesotho ni en Eswatini. Si la France et la Chine peuvent être comparées, c’est également le cas du Brésil et de l’Inde, bien que la politique africaine brésilienne soit en berne depuis le départ, en 2011, de Luiz Inácio Lula da Silva. Le Brésil est représenté dans 34 pays africains contre 30 pour l’Inde (44 en comptant les consulats). Perfectible, le réseau des représentations diplomatiques de New Delhi l’est notamment dans les Afriques de l’Ouest et centrale, régions francophones éloignées de l’aire d’influence indienne. Toutefois, pour combler ce retard pris sur Pékin, New Delhi a annoncé la création de 18 nouvelles ambassades d’ici 2021[4]. En lien avec les récentes ambitions gouvernementales, l’agenda de sécurité indien ne peut être oblitéré compte tenu de la base militaire chinoise à Djibouti, de l’avenir géopolitique de l’océan Indien et de l’économie bleue attenante, et enfin de la méfiance indienne, historique, à insérer les facteurs de sécurité et militaires dans les coopérations internationales. Ce qui n’a jamais été le cas des autorités chinoises.
Carte 1 : Les réseaux d’ambassades et de centres culturels chinois et indiens en Afrique
Le premier est lié au modèle de développement chinois que d’aucuns nomment Consensus de Pékin (Ramo, 2004) et qui s’applique expressément au continent africain. En témoigne le taux d’approbation global du leadership de la Chine en Afrique qui concurrence celui des États-Unis, avec 50 % d’opinions positives contre 51 % dans les 38 États africains couverts par l’entreprise de sondage Gallup en 2017 (Gallup, 2018). Le fait que l’Inde ne fasse pas l’objet de sondages est révélateur en soi.
Corrélatif, le deuxième facteur concerne l’attrait réel ou supposé de ces deux pays qui accueillent de plus en plus d’étudiants : 50 000 ont choisi la Chine en 2015 (50 000 entrées [1]), deuxième pays récepteur derrière la France (98 000), mais devant les États-Unis (41 000), le Royaume-Uni (35 000) et l’Inde, qui n’en a accueilli que 10 684 (UNESCO, 2018). Entre Chine et Inde, trois autres comparaisons sont envisageables. Elles concernent les diasporas (ou communautés diasporiques), les centres culturels et les réseaux d’ambassades respectifs en Afrique.
Selon le ministère des Affaires étrangères indien[2], 2,8 millions d’Indiens d’outre-mer sont répartis dans les 54 États africains. L’Inde différenciant à raison les « Indiens non-résidents » (8 % du total) des « personnes d’origine indienne », les 92 % restants ne possèdent donc plus la nationalité indienne. Moins réputée que la Chine pour mobiliser sa diaspora, l’Inde en aurait-elle les moyens compte tenu du fait que ces personnes d’origine indienne sont parfois établies depuis plusieurs générations en Afrique de l’Est, en Afrique australe ou à Madagascar ? Fréquemment associés à des formes de communautarisme et à des rivalités locales, les Karana (Fournet-Guérin, 2009 : 554) de Madagascar sont accusés de provoquer des conflits avec les populations autochtones. Le cas de magasins « indiens » pillés, voire incendiés, est symptomatique de ce communautarisme qui peut prendre des proportions racistes en Inde, où deux étudiants africains sont décédés ces dernières années ; de fait, ces faits divers xénophobes attentent à l’image de l’Inde en Afrique. Si les communautés chinoises[3] sont elles aussi associées à des modes de vie communautaristes en Afrique (Aurégan, 2016-b) et critiquées pour leur faible intégration socio-économique (Aurégan, 2013), la relative récence des migrations explique éventuellement l’image plutôt positive des ressortissants chinois en Afrique. Plus certainement, l’agrégation du rôle, des moyens et des réalisations de l’État chinois et de ses entreprises publiques semble jusqu’à présent générer des perceptions bienveillantes chez les populations africaines. C’est du moins à cette conclusion que nous aboutissons à l’issue de plusieurs études de terrain en Afrique de l’Ouest ; conclusion qui semble être étayée par les sondages, bien que contestables, d’instituts tels que Gallup et Pew Research Center (Gallup 2018 ; Pew Research Center, 2018).
L’avant-dernier facteur culturel présenté et pouvant amener à une comparaison entre Chine et Inde est lié aux centres culturels (Carte 1). Le « retard » indien en la matière est patent, New Delhi ayant installé 35 centres au total dans le monde, mais seulement cinq en Afrique, dont deux en Afrique du Sud. Pour la Chine, mi-2019, ce sont 54 Instituts et classes Confucius en Afrique pour un total de 525 répartis à travers le monde.
Les limites affichées dix ans plus tôt par François Lafargue (2007) persistent et pour certaines s’accroissent, bien que les enjeux demeurent : « si, pour l’Afrique, il n’est pas certain que cette sollicitude de l’Inde et de la Chine lui permette de trouver sa place dans la mondialisation, pour New Delhi, la conquête de l’Afrique est une étape obligée de son ambition mondiale » (Lafargue, 2006). Cette « conquête » doit nécessairement s’appuyer sur un dense réseau d’ambassades.
Celui-ci (Carte 1) démontre la puissance et les intentions d’un État à travers le monde. Dans cette perspective, le document suivant met en exergue le retour au premier plan de Pékin dans les affaires internationales. En Afrique, la couverture chinoise quasi parfaite renvoie nécessairement au différentiel de moyens alloués par Pékin, et aux contextes internes comme externes ; la réserve de devises et l’ambition internationale chinoises n’étant pas étrangères à l’essor et à la prorogation de cette politique africaine sinisée. De fait, seul l’Eswatini (ex-Swaziland), qui reconnait encore Taipei, n’est pas couvert. C’est donc un pays de plus que la France qui a délocalisé l’ambassade somalienne au Kenya, et qui n’en dispose ni au Lesotho ni en Eswatini. Si la France et la Chine peuvent être comparées, c’est également le cas du Brésil et de l’Inde, bien que la politique africaine brésilienne soit en berne depuis le départ, en 2011, de Luiz Inácio Lula da Silva. Le Brésil est représenté dans 34 pays africains contre 30 pour l’Inde (44 en comptant les consulats). Perfectible, le réseau des représentations diplomatiques de New Delhi l’est notamment dans les Afriques de l’Ouest et centrale, régions francophones éloignées de l’aire d’influence indienne. Toutefois, pour combler ce retard pris sur Pékin, New Delhi a annoncé la création de 18 nouvelles ambassades d’ici 2021[4]. En lien avec les récentes ambitions gouvernementales, l’agenda de sécurité indien ne peut être oblitéré compte tenu de la base militaire chinoise à Djibouti, de l’avenir géopolitique de l’océan Indien et de l’économie bleue attenante, et enfin de la méfiance indienne, historique, à insérer les facteurs de sécurité et militaires dans les coopérations internationales. Ce qui n’a jamais été le cas des autorités chinoises.
Carte 1 : Les réseaux d’ambassades et de centres culturels chinois et indiens en Afrique

Conclusion
Le Soft Power se veut consubstantiel à l’affirmation de l’État sur la scène internationale. Ce faisant, cette diplomatie publique et la diffusion de normes, ici chinoises plus qu’indiennes, participent à l’influence de la puissance – économique – mondiale qu’est la Chine, et qui, par conséquent, s’opère également à travers la projection de son cadre normatif dit de « coopération Sud-Sud ». Les Instituts Confucius forment un des leviers actionnés par Pékin afin d’attirer les populations africaines désireuses de se former ou d’appréhender la culture chinoise. Adossés aux médias (CCTV, Radio Chine internationale, Xinhua), ils sont en définitive intégrés dans la vaste stratégie politique de la Chine qui est ici spécifiquement orientée vers le continent africain.
Accusant un retard conséquent, accaparée par des priorités internes et perpétuellement comparée au voisin chinois, à ses moyens ou à sa politique extérieure, New Delhi a définitivement laissé s’échapper Pékin dans cette « course à l’Afrique ». République parlementaire fédérale, l’Inde s’appuie sur un secteur privé atomisé et dynamique qui est à l’initiative de la relation indo-africaine avant les années 2000, mais ne peut compter sur les mêmes atouts que la Chine populaire, soit un système centralisé, autoritaire, qui impulse des politiques suivies par les actes économiques. Malgré les efforts entrepris depuis l’arrivée au pouvoir du Premier ministre Narendra Modi, la faible implication politique et culturelle de l’Inde en Afrique sur le temps long semble ainsi rédhibitoire.
En tout état de cause, les mots du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères risquent de résumer longtemps encore les représentations inhérentes à la relation indo-africaine. Fin juillet 2018, celui-ci déclarait que la Chine, comme l’Inde, étaient « sur la même page » (MFAPRC, 2018b) pour aider l’Afrique dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Comme relevé infra, l’Inde se place dans le sillage chinois. Ne faudrait-il pas plutôt évaluer les interventions de l’Inde en Afrique à partir d’un prisme uniquement indien ? Partant, la confrontation Chine-Inde est-elle réellement viable compte tenu des trajectoires économiques et politiques prises par ces deux puissances asiatiques ? Le développement chinois, basé sur l’industrialisation et les investissements (IDE) occidentaux, et l’indien, adossé à la Révolution verte et les services, ne devraient-ils pas amener l’Inde à se désolidariser de ces discours comparatistes ? Compte tenu des moyens mis en œuvre par New Delhi dans sa relation au continent africain, il semble que non. Cette « même page » participe ainsi au leadership chinois et incarne, en filigrane, le succès de discours et pratiques qui participent non pas à un monde post-occidental, mais à la complexification du lacis de la mondialisation.
AURÉGAN, X., 2019, Les quatre temps de la Chine en Afrique, In : X. Aurégan et S. Wintgens (dir.),
Les dynamiques de la Chine en Afrique et en Amérique latine – Enjeux, défis et perspectives, Louvain-la-Neuve, Academia, p. 33-63.
AURÉGAN, X., 2016-a, « Temps et non-temps des relations sino-africaines », Géoéconomie, n° 81, p. 177-195.
AURÉGAN, X., 2016-b, Géopolitique de la Chine en Côte d’Ivoire, Paris, Riveneuve.
AURÉGAN, X., 2015, « Les enjeux du Forum de coopération Chine-Afrique » [En ligne], Diploweb.
AURÉGAN, X., 2013, « Représentations, “intégrations” et organisations : les enjeux des dynamiques migratoires chinoises à Abidjan (Côte d’Ivoire) », Monde chinois, no 33, p. 55‑66.
FOURNET-GUÉRIN, C., 2009, « Les Chinois de Tananarive (Madagascar) : une minorité citadine inscrite dans des réseaux multiples à toutes les échelles », Annales de géographie, n° 669, p. 543-565.
GALLUP, 2018, Rating World Leaders: 2018. The U.S. vs. Germany, China and Russia [En ligne], Washington, Gallup, 20 p.
LAFARGUE, F., 2007, « La rivalité entre la Chine et l’Inde en Afrique australe », Afrique contemporaine, n° 222, p. 167-179.
LAFARGUE, F., 2006, « L’Inde en Afrique : logiques et limites d’une politique », Afrique contemporaine, n° 219, p. 137-149.mfaprc, 2018, Foreign Ministry Spokesperson Geng Shuang’s Regular Press Conference on July 24, 2018 [En ligne], MFAPRC.
NYE, J. S., 2004, Soft Power. The Means to Success in World Politics, New York, Public Affairs.
PEW RESEARCH CENTER, 2018, Opinion on China (2017) [En ligne].
RAMO, J. C., 2004, The Beijing Consensus, Londres, Foreign Policy Centre.
UNESCO, 2018, Base de données [En ligne], Paris, Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture.
[1] Selon le ministère de l’Éducation chinois : http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201604/t20160414_238263.html.
[2] Voir la page du ministère : http://mea.gov.in/images/attach/NRIs-and-PIOs_1.pdf. Les plus fortes communautés sont en Afrique du Sud (1,5 million), à Maurice (894 500), au Kenya (80 000) et en Tanzanie (60 000). La Réunion compterait par ailleurs 280 250 « Overseas Indians ». Aucune méthodologie n’étant affichée sur le site du ministère, ces chiffres doivent être appréciés avec circonspection.
[3] Il n’existe pas de chiffre fiable du nombre de « Chinois » en Afrique, puisque les estimations vont de 500 000 à 2 millions. Le gouvernement ne publiant – ou n’étant pas en mesure de le faire – les chiffres inhérents aux huaqiao en Afrique, minorer ou majorer leur nombre relève de prises de positions politiques favorables ou contraires à l’État chinois, si ce n’est à l’instrumentalisation de ces migrants temporaires ou non, ou des descendants des coolies pour Afrique australe.
[4] Se reporter, par exemple, au site Internet du média indien Firstpost : https://www.firstpost.com/india/cabinet-approves-opening-of-18-new-indian-missions-in-africa-by-2021-4400093.html
Accusant un retard conséquent, accaparée par des priorités internes et perpétuellement comparée au voisin chinois, à ses moyens ou à sa politique extérieure, New Delhi a définitivement laissé s’échapper Pékin dans cette « course à l’Afrique ». République parlementaire fédérale, l’Inde s’appuie sur un secteur privé atomisé et dynamique qui est à l’initiative de la relation indo-africaine avant les années 2000, mais ne peut compter sur les mêmes atouts que la Chine populaire, soit un système centralisé, autoritaire, qui impulse des politiques suivies par les actes économiques. Malgré les efforts entrepris depuis l’arrivée au pouvoir du Premier ministre Narendra Modi, la faible implication politique et culturelle de l’Inde en Afrique sur le temps long semble ainsi rédhibitoire.
En tout état de cause, les mots du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères risquent de résumer longtemps encore les représentations inhérentes à la relation indo-africaine. Fin juillet 2018, celui-ci déclarait que la Chine, comme l’Inde, étaient « sur la même page » (MFAPRC, 2018b) pour aider l’Afrique dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Comme relevé infra, l’Inde se place dans le sillage chinois. Ne faudrait-il pas plutôt évaluer les interventions de l’Inde en Afrique à partir d’un prisme uniquement indien ? Partant, la confrontation Chine-Inde est-elle réellement viable compte tenu des trajectoires économiques et politiques prises par ces deux puissances asiatiques ? Le développement chinois, basé sur l’industrialisation et les investissements (IDE) occidentaux, et l’indien, adossé à la Révolution verte et les services, ne devraient-ils pas amener l’Inde à se désolidariser de ces discours comparatistes ? Compte tenu des moyens mis en œuvre par New Delhi dans sa relation au continent africain, il semble que non. Cette « même page » participe ainsi au leadership chinois et incarne, en filigrane, le succès de discours et pratiques qui participent non pas à un monde post-occidental, mais à la complexification du lacis de la mondialisation.
AURÉGAN, X., 2019, Les quatre temps de la Chine en Afrique, In : X. Aurégan et S. Wintgens (dir.),
Les dynamiques de la Chine en Afrique et en Amérique latine – Enjeux, défis et perspectives, Louvain-la-Neuve, Academia, p. 33-63.
AURÉGAN, X., 2016-a, « Temps et non-temps des relations sino-africaines », Géoéconomie, n° 81, p. 177-195.
AURÉGAN, X., 2016-b, Géopolitique de la Chine en Côte d’Ivoire, Paris, Riveneuve.
AURÉGAN, X., 2015, « Les enjeux du Forum de coopération Chine-Afrique » [En ligne], Diploweb.
AURÉGAN, X., 2013, « Représentations, “intégrations” et organisations : les enjeux des dynamiques migratoires chinoises à Abidjan (Côte d’Ivoire) », Monde chinois, no 33, p. 55‑66.
FOURNET-GUÉRIN, C., 2009, « Les Chinois de Tananarive (Madagascar) : une minorité citadine inscrite dans des réseaux multiples à toutes les échelles », Annales de géographie, n° 669, p. 543-565.
GALLUP, 2018, Rating World Leaders: 2018. The U.S. vs. Germany, China and Russia [En ligne], Washington, Gallup, 20 p.
LAFARGUE, F., 2007, « La rivalité entre la Chine et l’Inde en Afrique australe », Afrique contemporaine, n° 222, p. 167-179.
LAFARGUE, F., 2006, « L’Inde en Afrique : logiques et limites d’une politique », Afrique contemporaine, n° 219, p. 137-149.mfaprc, 2018, Foreign Ministry Spokesperson Geng Shuang’s Regular Press Conference on July 24, 2018 [En ligne], MFAPRC.
NYE, J. S., 2004, Soft Power. The Means to Success in World Politics, New York, Public Affairs.
PEW RESEARCH CENTER, 2018, Opinion on China (2017) [En ligne].
RAMO, J. C., 2004, The Beijing Consensus, Londres, Foreign Policy Centre.
UNESCO, 2018, Base de données [En ligne], Paris, Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture.
[1] Selon le ministère de l’Éducation chinois : http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201604/t20160414_238263.html.
[2] Voir la page du ministère : http://mea.gov.in/images/attach/NRIs-and-PIOs_1.pdf. Les plus fortes communautés sont en Afrique du Sud (1,5 million), à Maurice (894 500), au Kenya (80 000) et en Tanzanie (60 000). La Réunion compterait par ailleurs 280 250 « Overseas Indians ». Aucune méthodologie n’étant affichée sur le site du ministère, ces chiffres doivent être appréciés avec circonspection.
[3] Il n’existe pas de chiffre fiable du nombre de « Chinois » en Afrique, puisque les estimations vont de 500 000 à 2 millions. Le gouvernement ne publiant – ou n’étant pas en mesure de le faire – les chiffres inhérents aux huaqiao en Afrique, minorer ou majorer leur nombre relève de prises de positions politiques favorables ou contraires à l’État chinois, si ce n’est à l’instrumentalisation de ces migrants temporaires ou non, ou des descendants des coolies pour Afrique australe.
[4] Se reporter, par exemple, au site Internet du média indien Firstpost : https://www.firstpost.com/india/cabinet-approves-opening-of-18-new-indian-missions-in-africa-by-2021-4400093.html